Si le Covid-19 a ralenti le bouclage de sa thèse à Paris, la scientifique de 35 ans ambitionne de faire profiter ses compatriotes du fruit de ses recherches dès 2021.
La science n’aime pas les ruptures. Maha Dahawi non plus. La première femme soudanaise à faire ses recherches à la Pitié-Salpêtrière a pourtant dû se plier aux deux confinements de mars et de novembre. Et avec les restrictions d’accès aux laboratoires de l’hôpital parisien pendant les pics d’épidémie du nouveau coronavirus, son hidjab rose a moins souvent hanté les couloirs entre la zone de recherche en génétique et celle où l’on travaille sur le comportement. Elle a donc dû renoncer à boucler sa thèse en trois ans, véritable crève-cœur, et reculer d’un an son retour au Soudan et la mise à disposition là-bas de ses premiers résultats scientifiques.
Maha Dahawi aurait pu capituler depuis longtemps. Et si elle est encore étudiante à 35 ans, c’est parce qu’elle a refusé de se plier aux diktats du destin. Après six années à la faculté de médecine de Khartoum, une maladie auto-immune la contraint à quitter temporairement l’université. Six années d’invalidité, durant lesquelles elle se refuse à lâcher la science. Au contraire.
Pour « lutter contre la douleur, je voulais comprendre comment les pensées peuvent modifier la chimie du cerveau. C’est ce qui m’a conduite vers les neurosciences », précise la chercheuse, qui puise dans cette expérience intime une part de sa vocation à travailler sur l’épilepsie, un problème de santé publique dans son pays. Son but n’a jamais changé. Après la fin de sa thèse qu’elle bouclera en novembre 2021, Maha Dahawi poursuivra ses travaux à Khartoum et fera tout pour donner envie à d’autres jeunes femmes d’oser.
« Sortir de sa zone de confort »
Car, au Soudan, conjuguer la science au féminin est un vrai défi. La situation est d’autant plus difficile que son pays sort d’une crise politique profonde doublée d’un marasme économique. Que la capacité des populations à maintenir les enfants à l’école y a été fortement affectée ces derniers temps alors que, en 2018 déjà, seulement 60 % des fillettes terminaient leur école primaire, selon les données de l’Unesco. Celles qui sont restées sur les rails doivent donc « y aller », estime la chercheuse.
« Les jeunes femmes doivent oser. Sortir de leur zone de confort. Même si c’est terrifiant au début, cela vaut le coup. Et pour celles qui partiront à l’étranger, il faut s’ouvrir aux nouvelles cultures, développer un réseau. En trois ans, ma vision du monde a changé. Je ne regrette pas un instant, explique-t-elle alors que son départ n’est pas allé de soi. Dans les milieux conservateurs, les gens pensent traditionnellement qu’un homme réussira mieux qu’une femme à l’étranger. »
Une petite musique qui perdure même si les choses bougent. Maha Dahawi raconte par exemple avoir reçu un soutien de l’université de Khartoum, grâce à laquelle elle a pu venir étudier en France. La chercheuse aime comparer son parcours à une voiture lancée dans la nuit noire. « Les phares éclairent la route quelques mètres devant, mais plus loin, c’est l’obscurité totale. Et le seul moyen de savoir ce qu’il y a, c’est d’avancer. Alors il faut oser ! »
« Personne n’est indépassable »
A l’université de Khartoum, lorsqu’elle donne des cours de physiologie, des jeunes filles lui confient déjà vouloir lui ressembler. Maha Dahawi est devenue un modèle et en a conscience, sans que cela n’entrave sa modestie. « J’ai juste fait du mieux que j’ai pu, avec mes propres moyens et mes aspirations. Quand leur tour viendra, d’autres filles feront mieux que moi, j’en suis sûre. Personne n’est indépassable. » Un propos que relativise une de ses collègues de la Pitié qui tient à rappeler « le nombre incroyable de difficultés auxquelles Maha a dû faire face, en gardant toujours la tête haute ».
Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L’Oréal, ajoute : « Les femmes scientifiques africaines choisissent des sujets de thèse ou des travaux de recherche qui ont un lien avec les problématiques auxquelles le continent africain fait face. Elles servent toujours une cause plus grande qu’elles. ».
Depuis toujours, Maha Dahawi veut aider son pays. C’est aussi la raison pour laquelle elle a choisi de se pencher sur la génétique et la psychopathologie de l’épilepsie, car cette affection neurologique fait des ravages au Soudan. C’est même l’un des pays les plus touchés d’Afrique avec 6,5 cas pour 1 000 habitants. Celle qui a deux membres de sa famille atteints par cette maladie rappelle que le combat doit être mené tous azimuts.
« Des études récentes ont montré qu’elle est aggravée par une forte consanguinité, explique-t-elle. Or, au Soudan, plus de 40 % des mariages se font au sein d’une même famille. » Tout cela la pousse, lors de ses séjours subsahariens, à se rendre avec ses collègues de l’université dans les zones rurales où elle veut « faire comprendre qu’un mariage consanguin affecte non seulement la santé des enfants, mais aussi celle de toutes les générations à venir ».
« Travailleuse et curieuse »
Un message difficile à faire passer dans les communautés conservatrices où l’épilepsie est encore souvent considérée comme une tare, en particulier lorsqu’elle touche les jeunes filles. « Certaines familles tentent même de cacher la maladie, regrette la généticienne. J’essaie alors de leur expliquer qu’elle est génétique, qu’elles ne devraient pas en avoir honte. » Un long processus que cette sensibilisation, même si Maha Dahawi estime qu’être femme lui facilite le contact avec les mères et les jeunes filles.
Demain, elle espère bien contribuer à sa mesure, à changer les mœurs au Soudan. Mais surtout, elle compte faire avancer la recherche de traitements. Dans son laboratoire parisien, elle travaille sur le ver C.elegans (pour Caenorhabditis elegans), un petit organisme d’un millimètre très prometteur en génétique. Son objectif est de développer un modèle des conséquences cellulaires de l’épilepsie et de l’exporter au Soudan. Un projet de thèse « très ambitieux », reconnaît Eric Le Guern, chef de l’équipe « génétique et physiologie des épilepsies » de la Pitié-Salpêtrière.
Mais, aux yeux du professeur, Maha a toutes les qualités que nécessite la recherche, « travailleuse et curieuse, avec un esprit ouvert ». D’ailleurs, elle vient d’être choisie pour faire partie des Jeunes Talents récompensées par le prix Afrique subsaharienne 2020 L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science.
Une curiosité que la jeune femme exerce aussi dans ses rares moments libres. Quand elle évoque ses amis parisiens, ses yeux soulignés de khôl scintillent à l’idée des soirées en cité universitaire « avec des gens de tous les pays. Le soir, après le travail, on cuisine nos plats traditionnels et on partage ». Une autre facette de cette ouverture au monde pour laquelle elle se bat et à laquelle elle espère bien convertir d’autres Soudanaises.
Cette série a été réalisée en partenariat avec Cartier Philanthropy, la Fondation L’Oréal et l’association Res Publica dans le cadre de son projet Les Dynamiques.


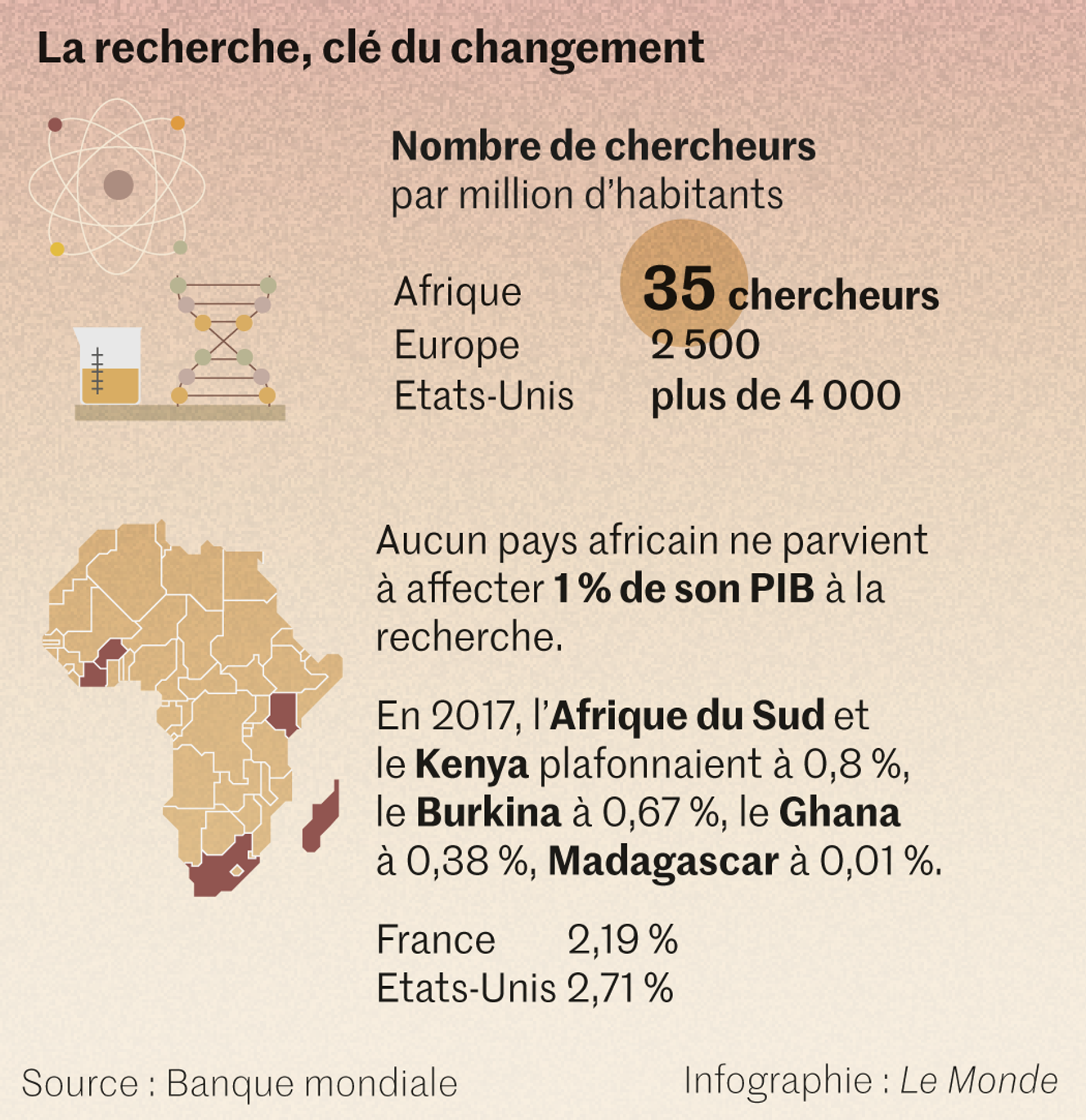

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire