Appelés aussi « millennials », ils sont nés entre 1980 et 2000. Et sont un concept à eux seuls, affublés de moult caractéristiques : narcissiques, connectés, instables, nomades… Dans un livre à paraître, le journaliste Vincent Cocquebert détricote ces clichés, dénonçant une vision générationnelle de la marche du monde.
Autocentrés, inconstants, narcissiques… Estimés en France à 16 millions d’individus, les millennials (appelés aussi « génération Y ») sont ces jeunes nés entre 1980 et 2000 auxquels est accolé un catalogue de stéréotypes.
Vincent Cocquebert, 36 ans, rédacteur en chef du site d’information, d’humeur et d’analyse Twenty (fait « par et pour les 16-25 ans ») a acquis, par la fréquentation quotidienne de cette génération, la certitude que ces jeunes ne correspondaient en rien à la caricature qui est faite d’eux. Le journaliste en a tiré un ouvrage passionnant, à paraître le 15 février : Millennial burn-out. X, Y, Z… Comment l’arnaque des “générations” consume la jeunesse (Editions Arkhê, 216 p.).
On présente toujours les millennials comme accros à Instagram, professionnellement instables et portant des Stan Smith. Se ressemblent-ils tous à ce point ?
On parle des millennials comme on parlerait de la famille Suricate. On applique à la jeunesse les codes narratifs du documentaire animalier. On les décrit, par exemple, comme accros au porno, alors que nombre d’entre eux ont un rapport très pudibond à la sexualité.
Pour bien comprendre ce qui se joue là, il faut revenir à la genèse du concept. La première référence à cette tranche d’âge apparaît en 1993, dans un édito non signé du magazine américain Advertising Age, sous le nom de « génération Y ». L’objectif de cette publication marketing à prétention sociologisante n’est pas de décrire la jeunesse telle qu’elle est, mais de créer le portrait-robot désirable d’un néoconsommateur éthique, qui aime les marques, l’engagement et croit au message publicitaire.
C’est le triomphe de la « génération » comme grille de lecture sociétale…
Oui. Cette vision générationnelle de la marche du monde doit aussi beaucoup aux travaux des historiens William Strauss et Neil Howe – avec leur livre Generations : The History of America’s Future, 1584 to 2069 [William Morrow Paperback, 1991, non traduit] –, qui envisagent la dynamique sociale comme une succession de sociotypes – les « artistes », les « prophètes », les « nomades », les « héros ».
Ce sont eux qui ont forgé le concept de millennials. Même si leur méthode a été décriée par certains de leurs pairs, leur vision a fini par s’imposer.
En réalité, les millennials n’existent pas. Il s’agit d’une génération dont les traits caractéristiques ont été définis a priori. Alors qu’ils n’étaient encore que préadolescents, ils étaient déjà décrits comme zappeurs, multitâches, professionnellement infidèles, experts en informatique. Ils ont été essentialisés avant même d’avoir vécu et parfois de manière très négative. Un des reproches qui leur sont adressés est lié à leur prétendu narcissisme, comme si les adolescents des générations précédentes ne l’étaient pas…
Est-ce la première fois qu’on définit ainsi une génération a priori ?
La guerre de 1914-1918 a permis l’émergence du concept de génération, mais elle était caractérisée a posteriori, au travers d’un événement tragique fédérateur.
Avec Mai-68, on verra apparaître les premiers discours médiatiques sur la jeunesse où l’approche fantasmatique prend le pas sur le réel. On idéalise alors une jeunesse révolutionnaire par essence, susceptible d’impulser des mutations décisives, sur laquelle va se focaliser abusivement toute l’attention. Alors qu’on avait affaire à une grève générale, Mai-68 sera finalement réduit à une « commune juvénile ». C’est aussi à cette époque que les conflits de générations commencent à se substituer aux conflits de classes. Depuis, on n’a eu de cesse d’opposer une génération à une autre.
Cette thématique du clash des générations est omniprésente. Le millennial est souvent présenté comme un nomade connecté et sans attache qui s’opposerait au baby-boomer repu, jouisseur…
Ce n’est pas une idée nouvelle, puisqu’elle renvoie au conflit des « anciens contre les modernes ». Mais alors que ce discours se basait jusqu’ici sur une opposition de valeurs, il a pris au début des années 1990 un tournant économique.
A partir de là ont germé des récits mettant en scène ce pseudo-conflit entre la génération prétendument profiteuse des baby-boomers et celle des millennials, qui seraient les grands perdants de l’histoire. Cette scénographie est un moyen efficace pour évacuer les véritables rapports de force, les rapports de classe.
Par ailleurs, cette guerre entre les jeunes et les vieux doit être largement relativisée, puisqu’il n’y a jamais eu autant de solidarité économique entre générations. En 2018, 80 % des 18-24 ans recevaient une aide financière de leurs parents.
Quand tout le monde surfe sur sa tablette et regarde « Sex Education » sur Netflix, cette focalisation sur l’âge a-t-elle encore un sens ?
De nombreuses études ont souligné l’absence de fracture entre les X, les Y, et même les baby-boomers. L’âge n’est plus un marqueur de distinction très pertinent. Aujourd’hui, on peut avoir plus de 60 ans, rouler en trottinette et être favorable au mariage pour tous.
Et, à l’inverse, être jeune et réac ?
Oui. On a toujours l’image d’une jeunesse progressiste, antiraciste, mais ça aussi c’est un cliché. Il y a cette anecdote que je trouve assez signifiante : au moment de la dernière élection présidentielle, la star française de l’électro Laurent Garnier a cru bon de passer dans un de ses concerts le titre Porcherie, des Béruriers noirs. Il pensait que le refrain de la chanson – « La jeunesse emmerde le Front national » – allait faire l’unanimité. Mais à sa grande surprise, il a reçu de nombreux messages hostiles sur Facebook, sur le thème : « J’écoute de l’électro et je vote FN. Ça vous dérange ? ! » Lors de l’élection présidentielle 2017, 51 % des 18-24 ans ont voté pour un parti antisystème au premier tour.
On aurait donc affaire à une jeunesse complexe, multiforme ?
En réalité, elle n’a jamais été aussi diverse, éclatée. Le problème de l’étiquette millennial, c’est qu’elle a fait disparaître les vraies lignes de fracture, entre la ville et la campagne, les riches et les pauvres, ceux qui ont fait des études et ceux qui, au nombre de 100 000 chaque année, sortent du système scolaire sans diplôme. Le millennial dont on entend parler tous les jours, celui qui correspond véritablement à sa caricature, qui écrit des lignes de code et mange du quinoa bio, ne représente que 5 % de la génération Y. L’Observatoire société et consommation les nomme « le nectar des millennials ».
C’est peut-être dans l’entreprise que le discours sur les millennials est le plus utilisé. Pourquoi ?
Le management s’est rapidement emparé de ce concept pour justifier des changements structurels, les mettre en scène au travers d’une incarnation, qu’il s’agisse du désengagement des entreprises dans la gestion des carrières, de la nouvelle organisation de l’espace, de l’informatisation ou de la normalisation des contrats précaires. La figure du slasher, cet individu qui accumule joyeusement plusieurs jobs, a, par exemple, permis de présenter de manière positive l’ubérisation à marche forcée de la société.
Si on a mis des canapés dans les open spaces, c’est donc parce que les millennials sont plus créatifs quand ils sont allongés, c’est ça ?
C’est un peu ça. Le jeune doit à la fois faire rêver, mais aussi tenir lieu de guide et d’inventeur du monde de demain. En réalité, on sous-traite aujourd’hui à la jeunesse un mythe du progrès auquel on ne croit plus. C’est pour ça qu’on a même instauré dans certaines entreprises ce que l’on appelle le « reverse mentoring », le fait que les jeunes deviennent les tuteurs de salariés plus âgés.
Où est le problème ?
Là aussi, on baigne en pleine légende urbaine. En réalité, on n’a pas du tout affaire à une génération de petits génies de l’informatique, comme on nous le répète. Pour reprendre la formule du spécialiste du numérique Jean-Noël Lafargue, je dirais que les millennials sont plus « digital naïves » que digital natives. S’ils maîtrisent Internet, les réseaux sociaux et le traitement de texte, ils ne sont pas tous codeurs dans l’âme.
Mais à force d’être répétée, cette caricature ne finit-elle pas par avoir des effets dans le réel ?
Au niveau du monde du travail, ces stéréotypes dévastateurs fonctionnent effectivement comme une prophétie autoréalisatrice. Certains manageurs, qui considèrent les millennials comme des mercenaires narcissiques, seront moins enclins à leur transmettre des connaissances. En réalité, avec plus de 20 % de chômeurs dans leurs rangs, les millennials ne sont pas les zappeurs inconséquents que l’on décrit, mais des jeunes angoissés par le manque de perspective professionnelle, qui rêvent simplement de stabilité.
Si les clichés sur les millennials sont à ce point infondés, pourquoi continue-t-on à les répéter comme des mantras ?
A titre individuel, le discours sur les générations, c’est un peu comme l’horoscope. On sait que ce n’est pas scientifique, mais on se laisse quand même prendre, parce que c’est divertissant. Ces stéréotypes flattent notre processus inconscient d’« avarice cognitive » : on préfère en général les analyses les plus simples, les raisonnements qui confirment nos préjugés. C’est pour ça que les discours complexes des sociologues et des anthropologues ont été éclipsés par de prétendus spécialistes en millennialogie.
Ils facturent jusqu’à 20 000 euros la conférence pour expliquer que le millennial veut une salle de sieste au bureau et des beignets le matin. Ce sont des affirmations qui ne reposent sur rien ou, au mieux, sur des études très discutables. Ce marché du consulting générationnel est si florissant qu’il touche désormais la génération Z (nés à partir de 1995), sur laquelle sont racontées tout autant d’inepties.
Comment ces jeunes réagissent-ils face à cette caricature ?
Ils commencent à comprendre qu’ils sont victimes d’une vraie violence psychique. Alors qu’on ne se permettrait jamais de tenir ce genre de discours avec un groupe racial, on martèle les pires horreurs sur les générations sans que personne ne s’en offusque.
Il y a peu, Hasbro a lancé un Monopoly spécial millennials dont le concept est incroyablement cynique : on remplace les achats immobiliers – « Vous n’avez pas les moyens de toute façon », précise le slogan du jeu – par des « expériences ». Bref, on ricane sur l’impossibilité de l’accès à la propriété des plus jeunes. Ce jeu a été très critiqué sur les réseaux sociaux.
Dans votre livre, vous parlez de « burn-out » générationnel. Ce n’est pas un peu fort ?
Ce poids symbolique énorme, en plus d’être générateur d’angoisse et de déception, pèse sur les jeunes d’aujourd’hui qui finissent par intégrer ces grands traits comportementaux comme s’ils étaient devenus performatifs, selon le principe de la prophétie auto-réalisatrice. Ils en viennent à porter un regard haineux sur leur propre génération. Aujourd’hui, le terme « millennial » est même devenu une insulte à l’intérieur de la génération Y.
A part sur le moral des principaux intéressés, cette fiction a-t-elle d’autres effets négatifs ?
Cette image « packagée » nous empêche de prendre conscience de ruptures plus profondes et plus inquiétantes, comme le mouvement de déconsolidation démocratique qui affecte cette jeunesse.
A ce stade, dois-je abandonner absolument toutes mes croyances sur les millennials ?
Il y a toujours un côté déceptif quand la réalité ne correspond pas aux attentes que les stéréotypes ont suscitées. Mais je vous rassure sur un point, les jeunes regardent quand même des vidéos de chats.
Le bazar des générations ou le ras-le-bolennial
En 1978, Le Nouvel Observateur diagnostique l’émergence d’une « bof génération », vierge de tout événement historique et à l’engagement politique soi-disant superficiel. A partir de là, la fabrique médiatique du discours générationnel se révélera incroyablement prolifique, accolant le terme « génération » à des films, des événements, des attitudes, censés en révéler l’essence : on aura ainsi vu apparaître des générations – aussi définitives qu’évanescentes – « Black-blanc-beur », « Erasmus », « Star Wars », « Canal+ »… Aujourd’hui accolé indistinctement à un événement tragique (génération Bataclan), à un produit en vogue (génération iPhone) ou à une névrose narcissique (génération Moi Moi Moi), le gimmick générationnel à la sauce millennial confirme le règne envahissant d’une sociologie de comptoir qui repose sur pas grand-chose.
D’après un décompte de la chambre de commerce des Etats-Unis datant de 2012, on dénombre pour la génération Y plus de vingt et une fourchettes temporelles différentes, ce qui suffit à résumer l’absence de scientificité du discours en question.
Devenue marché à catégoriser, chaque génération se trimballe désormais avec son petit bagage de qualificatifs caricaturaux et sa cohorte de dénominations alternatives (pour les Y, on dit aussi Next Gen, Yers, etc.). Ce bazar conceptuel s’est encore intensifié avec la volonté de nommer des moments de la vie au travers du prisme générationnel (le « parrennial » est ce millenial qui accède à la paternité) et de faire émerger des micro-générations intermédiaires (le terme « xennial » caractérise cet individu qui, assis le cul entre deux groupes d’âges, serait né entre 1977 et 1983). Vous en avez ras-le-bolennial de tous ces sociotypes faisandés ? Nous aussi !

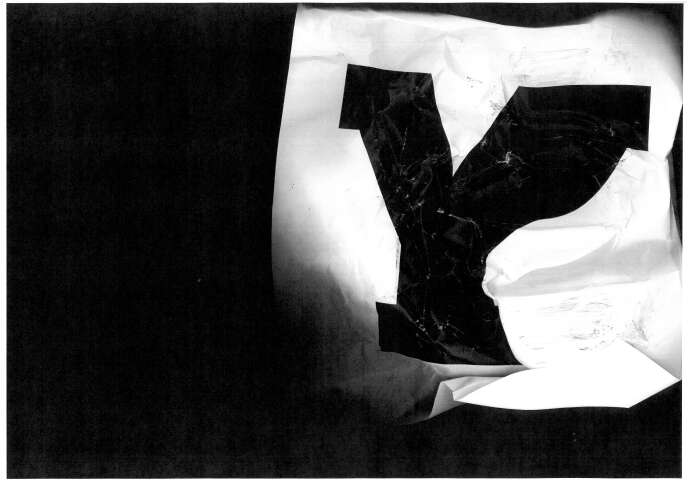



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire