Publié le 05 janvier 2024
Par Nicolas Truong
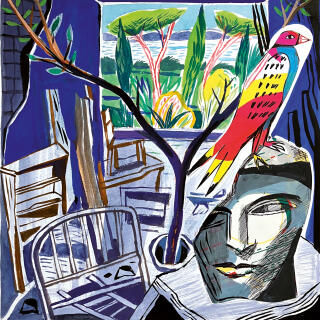
Partout, l’horizon semble obstrué. Et l’avenir fracassé. La prégnance des guerres accentue la sensation de dévastation planétaire. A tel point que l’inquiétude géopolitique semble reléguer à l’arrière-plan l’urgence écologique. Alertés par les rapports sur le réchauffement climatique, la pollution des espaces et la diminution du nombre d’espèces, les contemporains cherchent moins à transformer le monde qu’à le réparer ou à le conserver.
Savants et intellectuels sont moins nombreux à défendre l’idée de progrès. La révolution semble désormais appartenir davantage au lexique technologique, avec l’entrée de l’humanité dans la nouvelle condition numérique, qu’au vocabulaire politique. La crise de l’avenir pèse sur toutes les consciences. Et la résilience, cette capacité à surmonter une épreuve, apparaît comme l’une des rares modalités actuelles de l’espérance. D’où la nécessité de reformuler la célèbre question posée par Emmanuel Kant (1724-1804) : « Que nous est-il permis d’espérer ? »
Dans Critique de la raison pure (1781), le philosophe allemand posait les trois problématiques majeures de la philosophie dans leur dimension spéculative et pratique : « Que puis-je savoir ? », interrogation à laquelle répond, selon lui, la métaphysique ; « Que dois-je faire ? », qui relève de la morale ; et « Que m’est-il permis d’espérer ? », dont la réponse appartient notamment au domaine de la religion.
C’était au moment où l’esprit des Lumières s’étendait en Europe, une époque où il fallait, enjoignait-il, avoir le courage de se servir de son propre entendement, loin du dogmatisme, de l’obscurantisme et de l’arbitraire des monarchies. Un moment où il fallait oser sortir de l’état de minorité dont l’homme est lui-même responsable, un temps où il n’était pas déraisonnable, comme il le fit en 1795, de forger un projet de « paix perpétuelle ».
« Nouvelle condition ontologique »
A bien des égards, cette période semble appartenir aux temps préhistoriques. Les déflagrations des guerres mondiales du XXe siècle, dont Auschwitz et Hiroshima sont devenus la métonymie, ont grevé pour longtemps l’idée que l’humanité serait embarquée sur le chemin tracé d’un progrès social et moral inéluctable. Après 1945, la construction européenne s’accomplit sur le serment du « plus jamais ça ».
Les décolonisations, les révolutions sociales et scientifiques portent l’espoir d’une humanité réconciliée. Les Européens savent toutefois que la civilisation ne préserve en rien de la barbarie. Et même, avec le philosophe Walter Benjamin (1892-1940), qu’« il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie ». Le désespoir n’est plus une idée neuve en Europe.
Mais la catastrophe qui menace aujourd’hui ne repose pas uniquement sur la brutalité impérialiste et la résurgence des totalitarismes. « Un phénomène nouveau est apparu, lié à deux causes aux effets théoriques identiques : l’ère atomique et la catastrophe écologique, relève le philosophe Vincent Delecroix. L’extinction globale est désormais envisageable, sinon assurée, en sorte qu’il y a désormais un horizon apocalyptique crédible, une espèce de mur infranchissable qui, au loin – ou même, dans la situation atomique, à tout instant –, clôt le temps. »
Après une modernité accrochée à la conception d’un univers illimité aux ressources infinies, l’avènement d’un monde limité et même la conscience de la fin des temps historiques modifient profondément notre rapport à l’espérance. « Voilà la nouvelle condition ontologique de notre désespoir », résume l’auteur d’Apprendre à perdre (Rivages, 2019).
« Sensation claustrophobique »
La condition sociologique de notre désespérance est à présent documentée. Les chocs de la pandémie du Covid-19 et de l’inflation ont percuté les populations déjà paupérisées, mais aussi fragilisé les classes moyennes des démocraties libérales où l’on assiste à « une très forte concentration des richesses, des dérives oligarchiques et une généralisation de l’insécurité sociale », explique Nicolas Duvoux, président du comité scientifique du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Jusqu’aux années 1970-1980, la classe ouvrière était portée par l’idée d’une amélioration de ses conditions matérielles d’existence, mais aussi par la perspective d’une société émancipée.
Les classes diplômées étaient fortement travaillées par les utopies progressistes, dont Mai 68 fut l’une des manifestations. Certes, « seuls ceux qui ont assez de ressources et de réserves peuvent envisager de conquérir l’avenir », constate Nicolas Duvoux. Mais si certaines inégalités ont reflué, la capacité à se projeter s’est enrayée et touche désormais l’ensemble du corps social : « Le pessimisme est devenu une condition de masse », poursuit l’auteur de L’Avenir confisqué. Inégalités de temps vécu, classes sociales et patrimoine (Presses universitaires de France, 2023).
Sur le plan sociétal, des libertés sont régulièrement menacées. Et l’obsession du contrôle et de la sécurité propage une « sensation claustrophobique », estime l’essayiste Gaspard Kœnig. « L’inflation normative et le nudge algorithmique rognent insensiblement l’espace dont nous avons besoin pour créer, pour respirer, pour errer », décrit l’auteur de Notre vagabonde liberté (L’Observatoire, 2021).
Autorisations, homologations, certificats, attestations, codes et mots de passe « hantent notre quotidien », déplore le philosophe libéral, agacé par l’inscription de nos patronymes sur les billets de train – parce qu’« on ne peut plus se déplacer sans être tracé » –, mais également révulsé par la conditionnalité du revenu de solidarité active car « il faut laisser tranquilles ceux qui n’ont qu’un petit pécule », dit-il.
« Nous nous plions en quatre pour rentrer dans des cases qui se transforment en prisons. De quoi nous faire douter de l’Etat de droit, et alimenter le rejet du “système” », poursuit Gaspard Kœnig, lecteur des classiques du libéralisme politique que sont Alexis de Tocqueville (1805-1859) et John Stuart Mill (1806-1873), mais aussi l’anthropologue anarchiste David Graeber (1961-2020), qui a notamment su « mettre au jour l’emprise de la bureaucratie sur nos vies ».
« Sentinelles »
D’autant que tout se déroule « comme si nous avions abandonné nos rêves à un temps révolu », écrit le philosophe Michaël Fœssel dans une lettre adressée, par-delà le siècle, à l’écrivain Stefan Zweig (1881-1942). Dans Le Monde d’hier, son dernier ouvrage publié à titre posthume en 1943, le romancier viennois et intellectuel cosmopolite européen avait dépeint avec nostalgie le monde d’avant la première guerre mondiale. Un monde fait de stabilité, un « âge d’or de la sécurité », disait-il, au cœur duquel une myriade de nationalités cohabitaient et où la croyance dans la « route rectiligne du progrès » était communément partagée.
« Pour nous aussi, rien n’a marché comme prévu », poursuit Michaël Fœssel dans Les Nouvelles Lettres persanes (sous la direction de Blaise Mao et Elisa Thévenet, éditions Usbek et Rica, 2023). Les révolutions arabes ont échoué et la guerre est revenue par ces régions où l’Europe s’est disloquée au XXe siècle.
« Nous aurions dû, nous aussi, nous méfier des espérances de l’après-1989 », apparues avec la chute du mur de Berlin, observe Michaël Fœssel, alors que « sur les ruines de l’âge d’or de la sécurité s’édifie l’âge sécuritaire ». Le terrorisme et les guerres, les sociétés de surveillance du capitalisme autoritaire, les assauts idéologiques des partis et des médias identitaires, mais plus encore le mur climatique, créent une « atmosphère d’apocalypse », analyse-t-il. Ainsi, « la nostalgie pour le monde d’hier est d’autant plus grande qu’il n’est plus du tout sûr que, demain, un monde existera encore. »
Comment sortir de cette dépression individuelle et collective ? Tout d’abord en prenant au sérieux le désespoir. En le traversant de part en part. Notamment lorsqu’il a partie liée à la crise écologique. Toutes celles et tous ceux qui sont affectés par l’état de la planète et particulièrement atteints par ce que l’on appelle l’écoanxiété « témoignent d’une formidable capacité à s’ouvrir aux autres vivants et à vouloir habiter la Terre autrement », assure la philosophe Corine Pelluchon, autrice de L’Espérance, ou la traversée de l’impossible (Rivages, 2023). Il ne s’agit pas de penser que cet état d’abattement est un mal pour un bien mais d’être attentif à ce qu’il signifie.
Elle-même touchée par ce type d’anxiété, Corine Pelluchon s’attache à « montrer que la dépression climatique est une étape indispensable liée à la prise de conscience de la possibilité d’un effondrement, dit-elle. Une dépression qu’il est possible de surmonter quand on comprend que l’amour du monde, et non la haine de soi et de la vie, en est la cause. »L’écoanxiété se distingue à ce sujet du désespoir lié à des déceptions personnelles. Mais elle peut, elle aussi, aveugler, être un enfermement dans lequel « l’enfer me ment », observe-t-elle, puisque, dans la dépression, le sujet ne perçoit rien d’autre que sa douleur et voit la réalité à travers ce seul prisme.
Pourtant, la traversée du négatif est une manière de mesurer la gravité de la situation et de la déshumanisation en cours. Elle peut être un levier, non pas en raison d’une disposition à la résilience universellement partagée, mais parce que les jeunes et plus âgés écoanxieux sont des « sentinelles » qui alertent.
Réensauvagement
D’autant que les lanceurs d’avenir sont inventifs. Car le nouveau monde a déjà commencé. Des « pionniers de l’âge du vivant » s’installent à l’ombre des politiques publiques et de la plupart des focales médiatiques, remarque Corine Pelluchon. Jeunes diplômés ou cadres retraités, anciens professeurs ou nouveaux agriculteurs, ils réparent sans bruit le monde, s’immisçant dans une multitude d’interstices, communautés, écolieux ou habitats partagés. « Une vie souterraine d’initiatives se déploie à l’écart des chemins balisés, notamment autour de l’agroécologie », atteste Gaspard Kœnig. Dans son dernier roman, Humus (L’Observatoire, 2023), il met en scène les parcours croisés de deux jeunes agronomes soucieux de régénérer les sols.
De nouvelles pratiques s’inventent dans des lieux alternatifs qui ne sont plus si marginaux. « Les biomaraîchers ou les maçons de l’écoconstruction ne sont plus perçus comme des olibrius », observe la sociologue Geneviève Pruvost, autrice de Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance (La Découverte, 2021).
A l’instar des communautés du socialisme utopique qui, au XIXe siècle, inventèrent les crèches et les mutuelles, des projets de vie solidaires s’élaborent dans des oasis et des contre-sociétés où s’expérimente notamment une sécurité sociale alimentaire. « Les gens qui sont dans le “faire” continuent de penser que le monde est transformable puisqu’ils le transforment, analyse Geneviève Pruvost, et c’est pourquoi l’espérance est motrice chez ces réfractaires qui s’opposent à de nombreux projets “écocidaires.” »
L’espoir reprend lorsque les citoyens agissent, mais également parce que la vie renaît. Les partisans de ces forêts et terrains rachetés pour être laissés en libre évolution ou exploités de manière sobre et raisonnée le constatent : chaque recul de l’extractivisme est marqué par un regain de biodiversité. Comme le remarquent les naturalistes Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, auteurs de L’Europe réensauvagée (Actes Sud, 2020), l’effacement des barrages permet la circulation des sédiments depuis les sommets jusqu’à l’océan et la remontée des poissons de mer aux montagnes.
L’interruption de la pêche pendant quelques années offre aux océans la possibilité de se régénérer. Non seulement certaines espèces iconiques reviennent, comme le loup, le phoque gris, la cigogne noire ou la spatule blanche, mais le réensauvagement – le maintien de la vie sauvage rendu possible par l’action humaine – permet de réintroduire des espèces qui étaient en voie de disparition tels le bouquetin, le lynx, le gypaète et le vautour moine.
Réenchantement
Cette approche du vivant dessine également un « autre humanisme », explique le philosophe Baptiste Morizot, voisin de celui auquel l’anthropologue Claude Lévi-Strauss (1908-2009) aspirait dans Le Regard éloigné (Plon, 1983) : un « humanisme sagement conçu qui ne commence pas par soi-même, mais fait à l’homme une place raisonnable dans la nature au lieu qu’il ne s’en institue le maître et la saccage, sans même avoir égard aux intérêts les plus évidents de ceux qui viendront après lui ».
C’est en ce sens que le réensauvagement peut être un réenchantement. Car notre monde reste largement inexploré, fait remarquer Baptiste Morizot. « Nous cherchons une vie intelligente dans l’Univers, alors qu’elle existe de manière prodigieuse sur Terre », écrit-il dans L’Inexploré (Wildproject, 2023).
Toutes ces conversions du regard et initiatives ne conduisent cependant pas à un optimisme béat. « Je suis un optimiste. Mais j’ajoute : un optimiste pour… le XXIIe siècle », disait le philosophe de l’écologie Arne Næss (1912-2009), conscient qu’il faudra « traverser un très mauvais temps » qui « frappera même les pays riches ». Un propos qui pourrait s’accorder avec le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté formulés par le philosophe italien Antonio Gramsci (1891-1937).
Mais, afin d’éviter d’alterner les séquences d’enthousiasme et d’élans presque immanquablement suivies d’accablement et de déceptions, peut-être convient-il de sortir des binarités auxquelles la modernité est restée accrochée, comme celle entre l’optimisme et le pessimisme, mais aussi l’espoir et le désespoir. Car les mots font ou défont les choses. C’est pourquoi une partie importante de la philosophie invite à se débarrasser de notre rapport illusoire à l’espoir. La crainte du malheur, de l’échec et de la mort nous fait espérer un bonheur qui, le plus souvent, ne dépend pas de nous. « Il n’y a pas d’espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir », disait Spinoza (1632-1677). Et Pascal (1623-1662) d’ajouter : « Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous le soyons jamais. »
Mondes meilleurs
C’est pourquoi, depuis son premier ouvrage, Traité du désespoir et de la béatitude (Presses universitaires de France, 1984-1988), le philosophe André Comte-Sponville invite à « vivre désespérément ». Il ne s’agit pas de mener son existence en étant triste ou malheureux, mais, au contraire, accompagné d’un « gai désespoir » – qui est « une apologie de la volonté » – de désirer sans illusion.
Au fond, « il ne s’agit pas d’espérer, mais d’agir. Et la vraie question n’est pas morale, mais politique », poursuit l’auteur de La Clé des champs (Presses universitaires de France, 2023). S’impose ainsi la nécessité d’opérer une distinction entre espoir et espérance. L’espoir est « une attente très souvent liée à un désir personnel », relève Corine Pelluchon, alors que « l’espérance concerne le collectif et naît paradoxalement lorsque l’on a perdu ses illusions et faux espoirs ». L’espérance serait même « le contraire de l’optimisme », cette forme de « déni du réel ». En résumé, dit-elle en citant Georges Bernanos (1888-1948), « l’espérance, c’est le désespoir surmonté ».
Cette critique de l’espoir débouche ainsi sur une pensée de l’action. « L’horizon est bouché ? Soyons réalistes ! », lance André Comte-Sponville, qui se méfie de l’utopie, « cette religion des athées », dit-il. « Soyons utopistes », répond, au contraire, Vincent Delecroix. Car « l’utopie n’est pas construite pour être réalisée, mais pour guider et même pour analyser, poursuit l’auteur de Naufrage (Gallimard, 2023). On lui reproche son irréalisme ; mais qu’est-ce que le réalisme, sinon du conservatisme plus ou moins déguisé ? Comme si “les choses sont ainsi, il faut se faire une raison” était le dernier mot de la connaissance et de la raison elle-même. Le caractère “irréaliste” de l’espérance, pour autant qu’elle n’est pas un simple délire consolant, a une double fonction, à la fois critique et constructive. »

C’est précisément l’entreprise qui fut menée par le philosophe allemand Ernst Bloch (1885-1977) au moment où l’Europe était aux prises avec la barbarie nazie. Ecrit entre 1938 et 1947, Le Principe espérance (Gallimard, 1976) inventorie les rêves de mondes meilleurs et les images de bonheur, les projets d’utopies libertaires et égalitaires, et mobilise ce qu’il appelle la « conscience anticipante » afin de, précisera-t-il plus tard, réaliser une « utopie concrète ». Ernst Bloch renverse la perspective, non pas en raison d’un optimisme forcené ou d’une foi en l’avenir inconsidérée mais parce que « la fonction essentielle de l’utopie est la critique de l’ordre existant ». C’est parce que « quelque chose cloche » ou que « quelque chose manque », dit Ernst Bloch, qu’« il s’agit d’apprendre à espérer ». Ainsi, commente Vincent Delecroix, « l’irréalisme supposé de l’utopie est finalement un réalisme plus lucide ».
« Esprit de frugalité »
Le Principe espérance s’est heurté à de vives critiques qui n’ont pas toutes perdu de leur actualité. Soucieux de fonder une éthique face au « progrès monstrueux de la technique », le philosophe allemand Hans Jonas (1903-1993) a préféré forger Le Principe responsabilité (1979). Une manière de promouvoir un « esprit de frugalité » afin de prendre en compte le sort les générations futures touchées par les catastrophes écologiques.
« La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise », écrivait-il. Et le penseur allemand Günther Anders (1902-1992) d’ajouter dans Le Temps de la fin (L’Herne, 2007) : « Nous ne sommes “apocalypticiens” que pour avoir tort. Que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d’être là, ridicules mais toujours debout. » C’est à travers la lecture critique de ces deux pensées que l’ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuy a formulé le concept de « catastrophisme éclairé ».
Ce n’était pas mieux avant, même si le présent est particulièrement préoccupant. Et Le pire n’est pas certain (Premier parallèle, 2023), comme l’affirment Catherine et Raphaël Larrère dans une critique de « l’aveuglement catastrophiste ». D’autant que « des progrès sont notables », notamment en matière de médecine ou de droit des femmes, tient à souligner André Comte-Sponville, qui avoue toutefois n’avoir « jamais connu de situation géopolitique plus préoccupante » depuis la guerre froide.
Peut-être faudrait-il alors déplacer son regard et « cesser de regarder l’histoire comme une espèce de roman d’éducation, qui raconte essentiellement la perte des illusions de jeunesse et la conquête d’une maturité résignée et modeste, analyse Vincent Delecroix. L’humanité rêvait à ses débuts, elle espérait ; elle est désormais vieille et résignée, elle n’espère plus et même regarde avec une certaine condescendance ses illusions de jeunesse, ses grandes espérances ; elle a maintenant du plomb dans la tête, comme on dit très à propos ». Or le principe espérance ne vieillit pas, soutient-il.
« Number one de la création »
Ainsi il faudrait plutôt « regarder l’histoire comme une suite discontinue de bouffées explosives d’espérance, qu’elles se confondent ou non avec une tradition révolutionnaire », écrit Vincent Delecroix, car la raison et l’imagination produisent « des images qui transcendent, traversent le présent et l’ordre actuel du monde ». Il importe donc de se remémorer les moments heureux durant lesquels, au cours de l’histoire, des « joies anticonformistes » ont été vécues, car « la seule nostalgie qui vaille est celle qui trace un chemin d’avenir », prolonge Michaël Fœssel.
Les raisons d’espérer ne proviennent pas uniquement des marges de la société. Et des mesures concrètes prises par les pouvoirs publics pourraient modifier le rapport de la société à son avenir. La construction massive de nouveaux logements sociaux permettrait de « soulager les classes les plus impactées par les inégalités et les aider à se projeter vers le futur », assure Nicolas Duvoux. II en va de même en matière de santé avec « la grande inquiétude devant l’accès aux soins ».
Le « grand soir » n’a pas laissé la place aux petites mesures, mais la sociologie rappelle simplement que les conditions matérielles d’existence déterminent la conscience. Les grandes réformes ne sont pas oubliées au profit d’une politique des petits pas. Mais « il n’est ni ridicule ni égoïste de cultiver son jardin », explique Gaspard Kœnig, qui revendique une forme de syncrétisme, manifestant aussi bien son intérêt pour le collectif Les Soulèvements de la Terre que pour la « finance régénérative ».
Les grands changements ne sont pas forcément des ébranlements. « La fin d’un monde, ce n’est pas la fin du monde », analyse Corine Pelluchon, qui appelle à une « révolution anthropologique » puisque « l’homme n’est pas le number onede la création ». L’espérance est, comme dans Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1912), un poème de Charles Péguy (1873-1914), une petite fille qui entraîne ses deux sœurs, les deux autres vertus de la théologie chrétienne, la foi et la charité, et leur donne de l’énergie, parce qu’elle « voit ce qui n’est pas encore et qui sera ».
Elle n’est pas spectaculaire ni héroïque, commente Corine Pelluchon, « elle ne fait pas de bruit dans ce monde de haut-parleurs ». Mais « son amour de la vie et sa confiance en l’avenir » permettent de « prendre ses distances avec le mal qui fascine » et d’éviter les conséquences du déni, comme l’addiction à la consommation, le présentisme, la mégalomanie. Cependant, fait observer la philosophe, pour transformer ces idées en action, il faudrait que les partisans des « Lumières à l’âge du vivant » soient plus solidaires, car « les réactionnaires font front, alors que les progressistes se tirent souvent dans les pattes ».
C’est pourquoi, en cette nouvelle année particulièrement marquée par le tragique, il peut être utile d’accompagner toutes les pensées et actions qui résistent à la résignation. Et qui, face à un présent souvent terrible, rouvrent l’espace des possibles.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire