Par Henri Seckel Publié le 30 janvier 2023
Euthanasie, suicide assisté… de telles affaires finissent rarement devant les tribunaux. Souvent, quand un proche aide une personne victime d’une maladie incurable et désireuse d’en finir, la compassion s’impose face au droit.
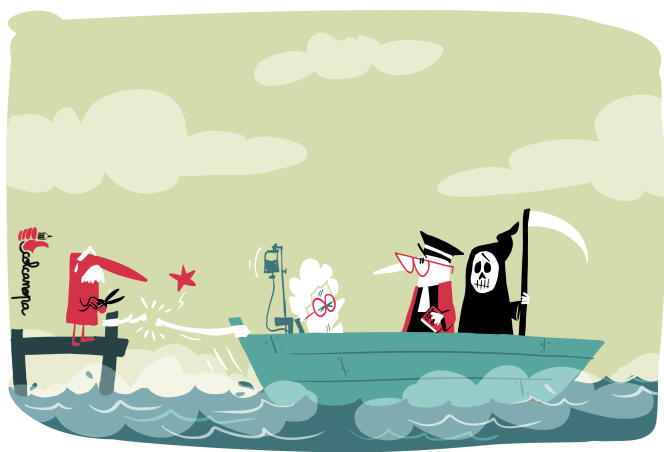
Morten Jensen et Emmanuelle Hubault sont tombés amoureux pendant la Coupe du monde de football, à Nantes, en 1998. Elle était coiffeuse, il était photographe et couvrait la compétition pour un quotidien danois, ils se sont mariés en 2000 et ont eu un petit garçon. A la fin de cette année-là, un cancer du sein a été diagnostiqué chez la jeune femme, qui s’est généralisé deux ans plus tard. Morten a alors tout quitté pour rester jour et nuit à son chevet à l’hôpital d’Angers, faisant preuve d’un dévouement qui a impressionné l’équipe médicale.
La jeune femme agonisante s’était alors confiée à sa sœur : « Je veux partir. » « Je veux mourir. » Le 11 janvier 2003, alors qu’elle avait sombré dans un coma profond, Morten a fermé la porte de la chambre. Il a disposé des pétales de rose sur le lit, s’est allongé à côté d’elle, lui a dit « je t’aime », et a pressé la seringue de Tranxene, injectant en quelques secondes la dose prévue pour vingt-quatre heures, avant de confesser son geste aux médecins. Emmanuelle avait 29 ans.
Morten Jensen a été acquitté par la cour d’assises du Maine-et-Loire en 2006. « Mon geste est un geste d’amour et de compassion, pas celui d’un meurtrier », avait-il dit à la barre. « Un crime d’amour est un crime, même s’il est animé des meilleurs sentiments du monde », avait rétorqué l’avocat général, Thierry Phélippeau, qui avait requis deux ans de prison avec sursis, au motif qu’« acquitter, ce serait dépénaliser l’euthanasie active ». Il n’y avait pas de partie civile à l’audience, il n’y en a quasiment jamais dans ces procès, les proches du défunt se rangeant souvent aux côtés de l’accusé. « Lorsqu’un père et une mère qui ont perdu leur fille bien-aimée sont capables de pardonner à mon fils pour cet acte, est-ce que des hommes ou une loi faite par des hommes peuvent le condamner ? », avait demandé le père de Morten Jensen. Après une demi-heure de délibération, son fils était acquitté sous un tonnerre d’applaudissements.
Euthanasies, suicides assistés… Régulièrement, des cas concernant des malades en fin de vie, souffrant de pathologies incurables et désireux de mourir plus rapidement, ont ainsi fini devant les tribunaux. En France, nul n’a le droit d’ôter la vie, même à la demande d’une personne, et le suicide assisté est proscrit. Des tabous qu’ont levés d’autres pays, comme la Belgique – en assortissant cependant toujours cette légalisation ou dépénalisation de conditions très précises.
« Tact particulier »
Le cadre français doit-il évoluer ? Emmanuel Macron a rouvert le débat, en septembre 2022, en confiant notamment la réflexion à 150 Français tirés au sort pour participer à une convention citoyenne. La feuille de route de cette assemblée, lancée en décembre 2022, a été formulée en une question par la première ministre, Elisabeth Borne : « Le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? » Les mots d’euthanasie et de suicide assisté ne sont pas prononcés. Mais ils sont dans toutes les têtes.
Combien de litiges arrivent devant la justice ? Les procédures sont rares – il n’existe pas de statistiques –, mais elles contraignent les juges à s’aventurer dans la zone grise tragique de la fin de vie, à trancher des cas particuliers ultrasensibles. Dans une circulaire de 2011 toujours en vigueur, le ministère de la justice appelle les magistrats à « un discernement et un tact particuliers » dans ces affaires si complexes.
En droit français, l’euthanasie est assimilable à un « homicide volontaire », qu’elle soit le fait d’un soignant ou d’un proche. Des centaines d’euthanasies clandestines seraient pratiquées chaque année, résultat d’un accord entre un médecin et un malade ou sa famille. Si poursuites judiciaires il y a, c’est que l’auteur s’est dénoncé ou l’a été par un membre de l’entourage ou de l’équipe médicale en désaccord avec son geste. Le plus souvent, la justice se montre clémente, voire détourne le regard pour éviter les procès.
Bernard Senet, ancien membre de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, ne l’a jamais caché : depuis les années 1980, ce médecin généraliste retraité du Vaucluse a aidé à mourir, à leur demande, des dizaines de personnes, s’assurant à chaque fois que l’entourage était informé, avant de fournir ou d’injecter le médicament létal, puis de remplir un certificat de décès classique : « Evolution terminale d’une maladie grave ».
Bernard Senet n’a jamais été poursuivi pour homicide volontaire, ni aucun praticien assumant publiquement avoir aidé des patients à mourir à leur demande. Le docteur à la retraite se remémore un échange avec le procureur du Vaucluse, dans les années 1990 : « Il m’avait dit : “Vous, vous aimeriez bien que je vous inculpe pour ce que vous faites pour les personnes en fin de vie.” J’avais répondu que oui, ça ferait un beau procès, qui pourrait faire avancer les choses. Il m’avait dit : “Justement, j’ai interdiction de vous poursuivre, pour ne pas relancer le débat.” »
« Peines symboliques »
Les cas qui finissent dans les tribunaux, en réalité, sont ceux où l’euthanasie supposée n’en est pas vraiment une, lorsque la volonté de la victime de mourir fait débat ou franchement défaut. Quand une peine de prison ferme est prononcée, c’est qu’un doute existe sur la sincérité de l’accusé.
Ainsi, Philippe Rialland, jugé en 2016 devant les assises des Deux-Sèvres pour avoir tué sa mère de 85 ans fortement diminuée par la maladie et glissant vers la démence, avant de tenter de se suicider, avait été puni de cinq ans ferme. L’avocate générale était parvenue à instiller dans l’esprit des jurés l’idée que l’accusé – qui s’en défendait – n’avait pas réellement voulu se suicider, juste se débarrasser du fardeau que représentait sa mère, pour pouvoir partir vivre en Thaïlande avec sa compagne. En 2017, l’aide-soignante Ludivine Chambet avait été condamnée à vingt-cinq ans de réclusion par les assises de la Savoie pour avoir donné la mort, en prétendant les « apaiser », à dix résidents de son Ehpad. Dix victimes âgées, certes, mais qui n’étaient ni mourantes ni désireuses d’en finir.
Nicolas Bonnemaison, qui comparaissait devant la cour d’assises du Maine-et-Loire en 2014, avait eu droit à davantage de mansuétude. Ce médecin urgentiste à l’hôpital de Bayonne avait mis fin aux jours de sept patients âgés, malades et en fin de vie, par des injections létales, sans prévenir quiconque. « J’aurais voulu que vous m’en parliez et qu’on décide ensemble », lui avait reproché le fils d’une victime. Les autres familles étaient venues à l’audience pour soutenir le docteur. Nicolas Bonnemaison avait été acquitté – avant d’être condamné à deux ans avec sursis en appel et radié de l’ordre des médecins. Dans ces affaires, les décisions des jurés reflètent parfois l’état de la société plus que celui du droit.
Concernant les affaires d’euthanasie, le député de Charente-Maritime Olivier Falorni (MoDem), partisan de l’aide active à mourir et qui dirige actuellement une mission d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti – sur l’accès aux soins palliatifs –, fait ce parallèle : « On sait qu’il y a des euthanasies clandestines dans ce pays, on voit des Français partir à l’étranger pour en bénéficier, comme pour les avortements avant la loi Veil [1975]. Cette situation hypocrite se transfère dans les tribunaux, où la réalité fait que la justice ne peut pas condamner, ou alors à des peines symboliques, tout comme Gisèle Halimi obtenait des non-lieux ou des acquittements malgré un droit très sévère sur l’avortement. »
Raisonnements juridiques originaux
La même clémence s’applique lors des procès dans des affaires d’aide au suicide, que la justice française poursuit sous d’autres qualifications, puisque l’aide au suicide n’est pas une infraction – l’incitation au suicide en est une, mais elle implique d’avoir donné à autrui l’idée de se suicider, pas de l’avoir simplement épaulé dans son projet. Jean Mercier, 83 ans, pour avoir tendu en 2011 à son épouse Josanne, fatiguée et qui souhaitait en finir, un cocktail de médicaments ayant entraîné sa mort, avait comparu pour « non-assistance à personne en péril ». A Angers, un vétérinaire ayant aidé, en 2019, un ami atteint de la maladie de Charcot à mourir – en lui fournissant des ordonnances pour un animal imaginaire, ce qui lui avait permis de se procurer des substances létales –, a été jugé pour… « faux » et « usage de faux ».
Ces deux prévenus ont été relaxés, grâce à des raisonnements juridiques originaux : les juges de Jean Mercier ont argué que seule la qualification de « meurtre » lui aurait été applicable – et un non-lieu définitif concernant cette qualification avait été prononcé à l’instruction. Ceux du vétérinaire angevin – qui sera rejugé, le parquet ayant fait appel – ont retenu l’état de nécessité, qui permet d’enfreindre la loi pour éviter un dommage plus grand que si on ne le fait pas, ce dommage étant, en l’occurrence, la dégénérescence mortifère de son ami.
« A chaque affaire de très grande souffrance, quand un proche aide quelqu’un à mourir, on veut une action en justice, l’institution veut dire au public “ça ne se fait pas”, pour éviter d’autres dérapages. En revanche, les jurés, qui écoutent les souffrances de la personne qui a donné la mort, vont souvent essayer de ne pas condamner, ou alors à des peines symboliques », constate Aline Cheynet de Beaupré, professeur en droit privé à l’université d’Orléans.
Par cette espèce de mansuétude, la justice corrige sans le vouloir l’un des angles morts de la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui autorise la « sédation profonde et continue » pour le patient souffrant d’un mal incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme – quelques jours – mais n’offre aucune solution à celui qui, condamné à plus long terme – dans les cas, par exemple, de cancer ou des maladies de Charcot et d’Alzheimer – souhaiterait s’épargner la dégradation et les souffrances qui l’attendent.
La philosophie de cette loi Claeys-Leonetti, qui repose sur les soins palliatifs, est d’éviter le recours à l’euthanasie, tout en luttant contre l’acharnement thérapeutique. Elle s’appuie notamment, pour ce faire, sur l’expression des « directives anticipées », qui permettent à chacun d’exprimer sa volonté quant à sa prise en charge en fin de vie au cas où il ne serait plus en état de le faire le moment venu. Ces directives « s’imposent au médecin », dit la loi, « sauf lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées à la situation médicale ». Ce bémol a ouvert la voie à d’autres affaires concernant la fin de vie, qui s’achèvent aussi, parfois, devant les tribunaux – un contentieux rare, là encore.
« Aucune loi ne résoudra tout »
Le 19 mai 2022, un homme de 43 ans était admis au centre hospitalier de Valenciennes (Nord) en arrêt cardiorespiratoire, après avoir été écrasé par le camion qu’il réparait. Deux semaines de coma plus tard, face à une situation qu’ils estimaient irrécupérable, les médecins ont décidé d’arrêter les traitements, qui relevaient, selon eux, de « l’obstination déraisonnable ». Les proches du patient ont alors saisi le tribunal administratif de Lille en urgence et présenté ses directives anticipées, un courrier rédigé deux ans plus tôt dans lequel il disait vouloir être maintenu en vie, « même artificiellement », en cas de coma jugé irréversible. L’affaire est montée jusqu’au Conseil d’Etat. La plus haute juridiction administrative du pays a tranché, fin novembre 2022, en faveur des médecins. L’avis collégial des médecins, qui doit parfois être conforté par des contre-expertises, l’emporte sur les directives anticipées du patient.
Le cas de Jean-Claude Seknagi, un homme de 70 ans à la santé fragile, illustre – à l’extrême – le poids que peut avoir la décision d’un juge. Hospitalisé depuis décembre 2021 pour de multiples infections, il était décrit comme un cas désespéré. Avant de tomber dans le coma, il avait eu le temps d’exprimer clairement, dans une vidéo filmée par son fils sur son lit d’hôpital, son désir de continuer à vivre. Jugeant inutile de s’acharner, les médecins de l’hôpital Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), avaient annoncé qu’ils procéderaient à une limitation des soins en cas de complications. La famille Seknagi, persuadée que le père pouvait s’en tirer, avait saisi la justice. En avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil ordonnait la poursuite des soins. En mai, Jean-Claude Seknagi était extubé et retrouvait l’usage de la parole. En août, après huit mois en réanimation, il était autorisé à rentrer chez lui, bien vivant.
Le cas Seknagi est atypique, mais quel cas ne l’est pas ? « Aucune affaire de fin de vie ne ressemble à une autre », disait Jean Leonetti dans un entretien au Monde en 2006. L’ancien député prévenait : « Aucune loi ne résoudra tout. »
De fait, même si elle a probablement limité le nombre d’euthanasies, « la loi Claeys-Leonetti de 2016 n’a pas “vidé” le contentieux de la fin de vie devant les juges, constate Aline Cheynet de Beaupré. Mais, au fil des avancées de la loi – demande d’arrêt des traitements par le patient et refus de l’obstination déraisonnable par les soignants en 2005, sédation profonde et continue, directives anticipées, collégialité de la décision médicale en 2016 –, de nombreux cas se règlent dans la satisfaction du patient, du soignant et dans le respect des principes essentiels de la société. » Il conviendra aux membres de la convention citoyenne, et éventuellement au législateur ensuite, de décider si le cadre de la fin de vie doit à nouveau être modifié.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire