Propos recueillis par Jean-Michel Normand Publié le 16 février 2022
L’historien François Hartog analyse l’urgence et le « présentisme », qui dictent notre rapport au temps depuis le début de l’épidémie de Covid-19.
Depuis deux ans, la crise sanitaire a introduit une expérience inédite dans notre appréhension du temps. Selon François Hartog, auteur de Chronos, l’Occident aux prises avec le temps (Gallimard, 2020), nous vivons une forme de « souffrance temporelle » qui aggrave l’incapacité collective à se projeter au-delà de l’immédiateté. Spécialiste du rapport des civilisations au temps, l’historien observe aussi l’émergence de nouveaux comportements individuels face aux maux liés à ce « présentisme ».
En quoi la crise sanitaire a-t-elle perturbé notre rapport au temps ?
Le confinement de début 2020 qui intervient à l’échelle mondiale nous a fait entrer dans un temps absolument singulier dont personne n’avait l’expérience. C’est un moment d’intense désorientation : le temps est suspendu, il n’y a plus que du présent, et ce présent n’en finit pas. Avoir l’impression de vivre sans cesse la même journée, c’est quand même compliqué.
Avec ce temps suspendu, inédit, on retrouve probablement ce que les gens ont pu ressentir pendant des périodes de guerre, en particulier lors de la première guerre mondiale. Avec une espèce de fatigue épouvantable liée au fait d’espérer sans cesse le bout du tunnel sans pour autant en apercevoir l’issue.
Vous faites l’analyse que les sociétés occidentales sont incapables de se défaire du « présentisme », une vision du monde où seule compte l’immédiateté, loin du culte du passé comme de l’espérance du lendemain, qui prévalaient jusqu’au milieu des années 1970.
L’obsession du just in time est la traduction de ce présentisme qui s’étend à tous les domaines de la vie. La crise due au Covid-19 a eu des effets ambivalents. Elle a consacré le triomphe des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) qui, dans ce temps suspendu, permettaient à l’individu connecté d’avoir accès à tout, instantanément. Dans le même temps, la situation sanitaire a poussé à la remise en question de la dictature du présent en créant une forme d’enfermement difficile à supporter. Vivre en permanence sous le coup de l’urgence est générateur d’angoisse et de stress.
L’urgence, c’est le maître-mot ?
Depuis deux ans, on n’en a jamais autant parlé, comme s’il s’agissait du seul horizon envisageable. On ne peut plus penser autrement une situation qu’à travers le concept d’urgence. Ce qui pose de redoutables problèmes car si tout est urgent, alors rien ne l’est. Il devient impossible d’opérer une hiérarchie.
La problématique du réchauffement climatique s’est trouvée posée à travers ce prisme de l’urgence, autrement dit, du présentisme. Or, une telle question ne peut se régler en quelques clics. D’où les conflits de temporalité très aigus car la même urgence est invoquée de tous les côtés, ce qui empêche de penser la durée. Quand Greta Thunberg dit « vous nous privez d’avenir », c’est un comportement présentiste, car cette phrase sous-entend que du jour au lendemain on pourrait lui rendre cet avenir.
Ce malaise lié à une forme d’enfermement dans le présent renforce-t-il la conviction que « c’était mieux avant » ? Sur le plan politique, accrédite-t-il aussi l’idée que l’on peut rembobiner le cours de l’histoire, restaurer un ordre ancien ?
Il est probable que ce dernier point a été exacerbé par la crise sanitaire. Eric Zemmour n’a pas eu besoin du Covid-19 pour exister mais, plus largement, l’idée du « tout fout le camp » s’en est trouvée renforcée, sans aucun doute.
Voyez ces milliardaires qui ont fait fortune dans le numérique – autrement dit, l’immédiateté – et qui veulent partir pour Mars. Ils tentent de remettre en marche l’ancien-futur de la conquête spatiale.
Avec la crise sanitaire, personne n’est plus maître du temps ?
La médecine n’y comprend rien. Elle ne sait pas jusqu’à quand tout cela peut durer. Les politiques croient qu’ils vont pouvoir reprendre le contrôle mais à chaque fois, le Covid-19 leur échappe car un nouveau variant surgit, ou alors on change de saison.
Le sentiment dominant, plutôt fondé, que le virus dispose toujours d’un temps d’avance, hystérise encore plus les polémiques et le procès récurrent intenté pour absence d’anticipation. Mais comment peut-on anticiper dans une société qui considère depuis des décennies que la réponse est le just in time ?
La pandémie peut-elle amener à reconsidérer notre rapport au temps long ?
Le monde d’avant qui céderait la place au monde d’après, c’est une idée qui n’a fonctionné que le temps du premier confinement ! L’expérience du Covid-19 nous a au moins amenés à rouvrir la longue histoire des épidémies.
On pourrait aussi envisager cette crise comme un tout petit moment dans l’histoire de l’évolution. L’humanité peut disparaître, les virus perdureront. Un tel renversement de perspectives obligerait à reconsidérer la place de l’humanité dans l’ensemble du vivant, à prendre conscience que notre passé existe et qu’il a toujours des effets. Et comme il est sûr qu’il y aura d’autres épidémies compte tenu de l’activité humaine, il faudrait également prendre en compte ce futur-là, même s’il n’est pas très exaltant. Mais je ne suis pas franchement optimiste, car le présentisme dominant en est incapable.
Le présentisme est-il une spécialité occidentale ?
La société chinoise est extrêmement présentiste, mais ses dirigeants nourrissent une vision du futur qui n’a pas changé avec la pandémie : devenir la première puissance mondiale. La Chine comme l’Inde sont présentistes car c’est une forme de modernité, mais elles ne scandent pas le temps de la même manière que nous. L’Occident reste marqué par le temps limité, de l’Incarnation à l’Apocalypse et au Jugement dernier. Les Chinois comme les Indiens doivent nous regarder avec beaucoup de perplexité ; cette perspective d’une fin des temps n’a pas de sens pour eux.
Vivent-ils ce moment mieux que nous ?
Je n’en sais rien. En revanche, je pense qu’ils ont un rapport au présent qui n’est pas le même que le nôtre. Lors des discussions engagées lors des conférences sur le climat (COP), on a vu émerger des conflits de temporalité que la diplomatie ne peut pas résoudre.
Aux pays occidentaux qui veulent abaisser de manière drastique les émissions de CO2, les économies émergentes rétorquent : « Nous avons bien le droit, nous aussi, de profiter de ce futur dont vous Occidentaux avez usé et abusé ».
Vous pointez l’apparition de nouveaux comportements individuels que vous assimilez à autant de « petites sécessions silencieuses ». Ce serait notamment le cas de ceux qui prennent la décision de quitter les grandes agglomérations.
Ce mouvement s’est accentué avec la crise sanitaire. Il s’agit d’une manière d’échapper au présentisme ou de négocier – c’est le cas du télétravail, par exemple – une mise à l’écart partielle du monde connecté. Tout cela rejoint aussi les prises de conscience climatiques qui plaident pour des modes de vie plus sobres.
Ces sécessions peuvent-elles avoir une traduction politique ou est-ce simplement un prolongement de l’individualisme ? Y a-t-il une agrégation possible ? Ces phénomènes vont-ils durer ? Il est encore trop tôt pour le dire.

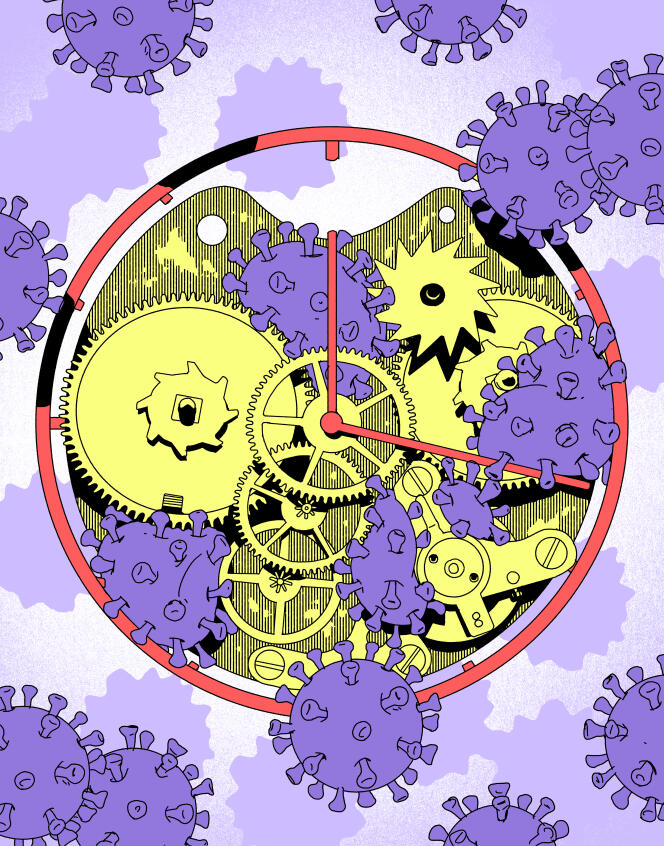

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire