Par Magali Cartigny Publié le 1 avril 2024
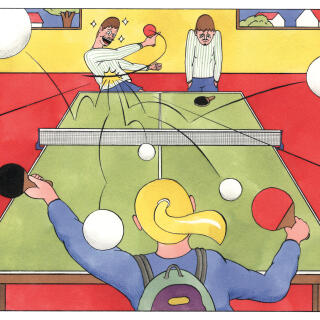
Enquête Entre les phases d’euphorie et les périodes de dépression sévère, les enfants doivent en permanence s’adapter à l’« humeur » de leur parent souffrant de troubles bipolaires. Et parfois prendre la place de l’aidant. Avec des répercussions à l’âge adulte.
Quand il entend Eve, lève-toi à la radio, Julien Carpentier a une bouffée d’angoisse. Rien à voir avec les envolées lyriques de Julie Pietri. Simplement, cela lui rappelle sa mère, qui, pendant ses crises maniaques, se prenait pour Eve, et dansait donc avec la vie. Dit comme ça, certains pourraient trouver ça drôle. Ce souvenir douloureux, le réalisateur s’en est affranchi en le recréant dans une scène de La Vie de ma mère, sorti le 6 mars, film multiprimé qui s’inspire de sa propre histoire. Soit un trentenaire qui voit redébarquer dans sa vie sa mère bipolaire, échappée en douce de l’hôpital psychiatrique et qu’il n’a pas revue depuis deux ans.
Cette femme (interprétée par Agnès Jaoui), à la fois solaire et malaisante, bardée de bijoux aussi clinquants que son trench rouge, a arrêté son traitement et démarre sa phase maniaque. « Là, ça va encore, mais tu sais comment ça se termine », lance le jeune homme à sa mamie, chez laquelle sa mère s’est réfugiée et où elle s’est lancée avec perte et fracas dans un couscous d’anthologie. Face à cette quinqua joyeuse et fantasque, le regard noir de l’acteur William Lebghil et son langage corporel, tel un animal à l’affût, disent tout. Chez les proches de bipolaires, on ne se réjouit pas impunément de la jovialité de son parent. Elle est la première secousse du tremblement de terre à venir.
Julien Carpentier était un de ces enfants invisibles. Intranquilles et silencieux. Qui doivent s’adapter en permanence à « l’humeur » de leur parent. « Des enfants qu’on oublie et qui s’oublient », selon la formule de Thierry Baubet, chef de service en pédopsychiatrie à l’hôpital Avicenne (Bobigny). Ils sont les dommages collatéraux de la maladie mentale. Mais pour comprendre les effets sur les proches, encore faut-il savoir de quoi on parle et casser les fantasmes sur la « folie », ambiance Vol au-dessus d’un nid de coucou. Mais aussi proscrire l’instrumentalisation du terme (non, avoir des hauts et des bas ne fait pas de vous un bipolaire).
En France, de 1 % à 2,5 % de personnes souffrent de troubles bipolaires chroniques, selon la Fondation FondaMental. Si plusieurs types existent, cette maladie psychique se caractérise par des périodes d’hyperactivité et d’exaltation, mues par un sentiment de toute-puissance. Ces phases maniaques (hypomanie), qui peuvent durer quelques mois, alternent avec des phases dépressives sévères tout aussi longues, menant parfois au suicide (le taux se situe entre 10 et 20 % dans le monde, selon l’OMS). Plus on est monté haut dans la phase maniaque, plus dure sera la chute. Avec des répercussions sérieuses notamment sur les plans financier (achats compulsifs, crédits à la consommation, versements à des tiers) et professionnel (abandon des études, démission, mise à pied, poursuite de projets irréalistes).
Si, pour la moitié des patients, les symptômes se manifestent avant l’âge de 20 ans, poser un diagnostic peut prendre plusieurs années, entre huit et quinze ans selon les études. Une errance thérapeutique qui contribue à faire passer cette maladie sous les radars et retarde une prise en charge médicale salutaire. Un test sanguin, myEDIT-B, fiable à 80 %, est commercialisé depuis début avril par le laboratoire Synlab, mais il n’est pas suffisant pour poser un diagnostic. En moyenne, les patients ont une réduction de leur espérance de vie de vingt ans, en raison des addictions entraînant des comorbidités, des conduites à risque lors des phases aiguës mais aussi des effets secondaires des traitements sur le long terme.
Lever le tabou
Depuis quelques années, des malades et leurs proches ont pris la parole sur les réseaux et dans les médias pour dénoncer l’incompréhension autour de ces troubles mais aussi l’impact dévastateur sur les familles. Maxime Perez Zitvogel est cofondateur de l’association La Maison perchée, à Paris, créée en 2020 pour accompagner les jeunes adultes en souffrance psychique et leurs proches. La même année, il témoignait dans Brut, avec sa mère Valérie. Alors que son fils vivait à l’étranger, ses amis alertent cette dernière. Maxime « se baladait à poil », la figure peinte en bleu, avait arrêté les études, voulait épouser un mannequin qu’il venait de rencontrer, avait créé quatre boîtes. Il est hospitalisé de force et le diagnostic tombe. « Vivre avec un bipolaire, c’est apprendre à danser sous la pluie quand c’est l’orage, et c’est l’orage tout le temps », résumait ainsi sa mère dans cette vidéo vue plus d’un million de fois.
Maxime Perez Zitvogel est aujourd’hui stabilisé et vient d’avoir un bébé. Car, si on ne guérit pas de la bipolarité, on peut vivre avec, si l’on trouve le bon traitement (des régulateurs d’humeur comme le lithium, la kétamine en administration intranasale, etc.), qui peut être combiné à d’autres approches thérapeutiques (neuromodulation, sismothérapie, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, etc.).
Des artistes ont aussi permis de lever ce tabou. Dans Rien ne s’oppose à la nuit (JC Lattès, 2011), Delphine de Vigan nous plongeait dans l’histoire de sa mère bipolaire, qui s’était suicidée trois ans plus tôt. Le 31 mars, dans nos colonnes (« Je ne serais pas arrivé là si… »), le chanteur Raphael évoquait pudiquement la bipolarité de sa mère, et « les fantômes » de sa famille : « Mon grand-père s’est suicidé, mon oncle s’est suicidé, mon cousin germain s’est suicidé. » L’humoriste Mahaut Drama raconte quant à elle, dans son spectacle Drama Queen, comment son père, en pleine phase maniaque, les a tout simplement oubliés, elle et son frère, dans un aéroport en Thaïlande. Il a pris l’avion sans eux.
La « parentification »
Des tentatives de suicide aux périodes d’euphorie, du parent zombie traînant en robe de chambre aux crises de délire et de colère dans le huis clos familial (ou pire en public), comment grandit-on dans cette confusion des émotions, avec cette responsabilité qu’on s’assigne de « sauver » papa ou maman de ses démons intérieurs ? Quelles sont les conséquences sur la vie d’adulte ? Et comment aider les générations présentes et futures à surmonter les traumatismes pour éviter la répétition ?
Dans un article de la revue Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence publié en 2021, le chercheur et psychiatre Michel Maziade (université Laval, au Québec) rappelait que, dans la population générale, environ 20 % des mineurs ont un parent affecté par une maladie psychiatrique majeure : « Les enfants et adolescents nés d’un parent atteint de schizophrénie, d’une maladie bipolaire ou de dépression majeure récidivante se comptent par millions, mais ne font l’objet d’aucune priorité sociosanitaire. » Selon le médecin, la moitié d’entre eux présente, durant l’enfance, des troubles du développement ou du comportement nécessitant des soins.
« Les enfants pensent qu’ils n’en font jamais assez, que leur parent a rechuté parce qu’ils n’ont pas été assez sages »,explique Hélène Davtian Valcke, chargée de mission proches et parentalité à l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam). La psychologue clinicienne a mis en place une consultation consacrée aux malades, à leur conjoint et ex-conjoint, pour prendre en compte les effets de la bipolarité sur la parentalité, trouver les bons mots face aux enfants en fonction de leur âge et organiser leur accueil pendant et après l’hospitalisation. Elle a aussi cofondé JEFpsy en 2020, plate-forme d’aide pour les enfants, frères et sœurs de malades bipolaires.

Hélène Davtian Valcke déplore les ravages de la « parentification », quand les rôles sont inversés au sein du foyer. « Ces enfants prennent souvent la place de l’aidant car nos institutions sont défaillantes. » Or, il devient d’autant plus urgent de tenir compte de leur présence que le système de soins a beaucoup évolué, notamment avec le virage ambulatoire et sa doctrine : le domicile doit être la règle et l’hôpital l’exception. Les familles ont donc désormais une place majeure dans ces dispositifs. « Or, un enfant n’est pas là pour soutenir. Tous veulent “sauver” leurs parents, mais c’est autre chose de les pousser dans cette posture », poursuit la psychologue. Un constat que partage Lila Mekaoui, psychiatre spécialisée au GHU Paris : « Les enfants ont tendance à se culpabiliser et se questionnent sur leur responsabilité. Il faut les informer, les écouter et faire en sorte qu’ils restent à leur place d’enfant. »
Aujourd’hui, l’hôpital et les psychiatres prennent davantage en considération l’entourage familial, mais le système est à l’agonie. Et les places sont chères. « La pédopsy est saturée. Et, en libéral, les prix des consultations sont trop élevés pour certaines familles », constate Lila Mekaoui, pour qui l’enjeu relève certes des moyens, mais aussi d’une standardisation nécessaire de l’offre de soins pour les proches. Grâce aux groupes de parole et à la pair-aidance – entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert de la même maladie –, les associations, comme l’Unafam, Argos 2001 et La Maison perchée, pallient comme elles le peuvent les défaillances du service public et contribuent à changer le regard stigmatisant de la société sur ces troubles mal connus.
La loi du silence
« Je n’arrive pas vraiment à me souvenir de quand j’ai compris que quelque chose clochait chez ma mère, comme si cela avait toujours été là », témoigne Julien Carpentier. Le réalisateur se remémore néanmoins cet épisode, dans la voiture, quand sa mère disait voir un pied sur le capot. Il avait 6 ans, ne voyait rien, mais il croyait sa mère et ne comprenait pas l’absence de réaction de son père. « Jamais mon père n’a posé les mots. Je n’ai pas non plus souvenir d’avoir parlé à un médecin, qui m’aurait demandé comment je le vivais. Jamais. On ne m’a rien expliqué, j’ai juste dû encaisser. » Le réalisateur n’en parlait pas à ses amis.
Le cinéaste belge Joachim Lafosse, lui, se rappelle que son père a été diagnostiqué lorsqu’il avait 8 ans. Dans son film Les Intranquilles, sorti en 2021 – en référence à L’Intranquille, l’autobiographie de Gérard Garouste (L’Iconoclaste, 2009) –, l’enfant est le témoin silencieux de la descente aux enfers de sa mère, impuissante face à ce mari qui a, une fois de plus, perdu pied avec la réalité. Le garçon a vite compris qu’il devait prendre la place de l’aidant, celui qui doit amener ses médicaments à papa, et qui épie ses faits et gestes, dans l’attente du signal, du basculement. Sans poser de questions et en se faisant tout petit. « Il n’y a personne qui parle, personne qui explique, pas un rendez-vous avec le psychiatre de mon père ni avec un autre thérapeute », se souvient Joachim Lafosse.
« On ne reconnaît plus nos parents »
Dans le podcast « La Perche » de La Maison perchée, Lison, Clémence et Clara, entre 25 et 35 ans, témoignent de cette enfance hors norme : « J’ai compris vers 13 ans, dit Clara. Quand on se réveille et qu’on a une maman qui parle à peine, qui ne sort plus de sa chambre et ne s’occupe plus de rien et que, du jour au lendemain, elle débarque avec six paires de chaussures de six couleurs différentes, on voit bien qu’un truc ne va pas. »
« Le problème, c’est qu’on ne reconnaît plus nos parents », témoigne Laure Mollier, chanteuse et comédienne. Sa grand-mère maternelle s’est suicidée en se jetant dans la Seine quand sa mère avait 10 ans. Ses trois tantes sont bipolaires. A l’âge de 12 ans, Laure quitte Djibouti avec sa famille pour rentrer en France. Un changement de vie trop radical. « Ma mère s’est effondrée et mon père, qui souffrait de son côté d’un trouble de la personnalité non spécifié, s’est mis à boire. »
Tentatives de suicide, hospitalisation, énorme prise de poids en raison des médicaments… Sa mère, institutrice passionnée qui a dû quitter son travail, se transforme sous ses yeux. Elle ne se nourrit pas, ne se lave plus, dort toute la journée ou pas du tout, reste pendant des semaines dans sa chambre les volets fermés. « Avec mon frère, on subissait et on ne comprenait pas. La phase maniaque, ça paraît mieux, mais on sait que c’est reparti : elle faisait du repassage la nuit entière en mettant la musique à fond. Elle dépensait tout l’argent. Les phases stables, elles, ne duraient pas longtemps, quelques mois au mieux. » Sa mère arrête le traitement, le reprend. Et à chaque rechute, c’est de plus en plus violent. Elle tentera de se tuer à de nombreuses reprises, par défenestration ou overdose de médicaments, souvent en présence de ses enfants.
La honte
Dans Les Intranquilles, le père, artiste peintre, débarque, devant l’instituteur médusé, dans la classe de primaire de son petit garçon pour distribuer des gâteaux. Les enfants rient, le fils est mortifié. Il sait que cette honte ne le lâchera pas, le lendemain, quand il devra retourner à l’école. Cette scène, le réalisateur Joachim Lafosse l’a vécue. Dans La Vie de ma mère, Agnès Jaoui danse sensuellement avec tous les gars du bar devant son fils, que le malaise asphyxie.
Eliane Melon, membre bénévole depuis vingt ans de l’association Argos 2001, insiste aussi sur l’humiliation pour les malades : « Quand quelqu’un se balade tout nu dans sa rue en se prenant pour un lion, quand il va mieux et qu’il rentre chez lui, il doit supporter le regard des autres. » Même scène dans le film La Forêt de mon père (2019), de Vero Cratzborn, dont le père était bipolaire : en pleine crise maniaque, il sort nu du supermarché, sans payer, avec son chariot qui déborde… Il se croit invisible sans ses vêtements. Ses trois enfants, qui l’attendaient sur le parking, voient leur père se faire embarquer par les pompiers.
La honte, c’est ce qui revient dans tous les témoignages, comme une couche de crasse invisible dont on ne peut se défaire. « La honte, c’est hyperprésent, c’est lié à la culpabilité. On a ensuite honte d’avoir honte. C’est très dur à gérer au quotidien », témoigne Julien Carpentier. De son côté, Lison raconte, dans le podcast « La Perche », que son père ne laissait aucun de ses amis indifférents : « C’était soit “ton père, il est incroyable”, soit “il est bizarre”. La plupart du temps, c’était gênant. Quand je le leur présentais, je m’agrippais à la table et je serrais les dents. » Laure Mollier, elle, a déménagé près de vingt fois, au gré des phases de sa mère, de ses placements en famille d’accueil ou chez ses grands-parents. Difficile donc de se faire des amis. « De toute façon, je n’invitais personne, j’avais honte. » Elle refuse que sa mère vienne la chercher au lycée : « Je ne savais pas dans quel état elle serait. »
L’hypervigilance
Ce que la majorité des enfants, devenus adultes, décrivent, c’est l’hypervigilance et la suradaptation qui ont forgé leur personnalité. « J’avais peur, car je ne savais pas comment j’allais trouver mon père en rentrant, témoigne Lison. S’il n’allait pas bien, j’essayais de ne pas prendre trop de place. S’il était en colère, je me cachais, littéralement. Et s’il était content, je répondais par de la joie. » Joachim Lafosse, lui, explique qu’il est encore souvent sur la défensive, en contrôle.
« C’est moi ou mon frère qui appelions le SAMU, on a vécu avec le cerveau en urgence. On ne savait pas en rentrant de l’école si elle serait vivante ou non », raconte Laure Mollier. Même chose pour Julien Carpentier : « Quand il y a la phase stable, on a peur du moment où ça va basculer. Quand ça bascule, on se demande à quel moment on doit hospitaliser. Et après, on a peur du suicide. Ça développe une telle hypervigilance qu’un simple regard suffit à déterminer dans quel état est la personne. On est à l’affût de ce regard-là. » Même dans sa relation avec les autres.
« Ces enfants ne sont pas sereins, beaucoup finissent par être épuisés. On parle aussi de contamination psychique », défend Hélène Davtian Valcke, la psychologue clinicienne de l’Unafam. Une instabilité qui pose aussi la question de l’égalité scolaire. Comment rester concentré en classe quand on veille son parent toute la nuit, comment faire ses devoirs quand un « fantôme » erre dans le salon familial. « Certains subissent aussi les effets des nombreux déménagements, voire des placements en famille d’accueil, du jour au lendemain, quand survient l’hospitalisation », souligne la spécialiste.
Les visites à l’hôpital psychiatrique
Nombre de ces enfants ont arpenté, dans les hôpitaux psychiatriques, les allées des parcs à la verdoyance déconcertante et les couloirs dont on ne voit jamais le bout. La visite au parent malade, sans accompagnement ni préparation, a été une épreuve. Un traumatisme qui a pu retarder la nécessaire consultation, une fois adulte. « Quand j’allais voir ma mère en HP, c’était violent, se souvient le cinéaste Julien Carpentier. Tous les malades sont mélangés, avec des cas vraiment sévères. On ne m’a jamais dit qu’elle allait guérir ni le contraire, on ne m’a juste rien dit. Du coup, on pense que ça va passer mais ça ne passe pas. Et ça recommence. Résultat, pendant longtemps, j’ai rejeté le milieu de la psychiatrie. »
Laure Mollier aussi a passé pas mal de dimanches en HP. « J’ai vu ma mère intubée, en contention, attachée nue sur son lit… Ça, on ne s’en remet pas. Et puis, il y a ces affreux couloirs verdâtres où l’on entend des patients hurler. » Sans parler des repas à la cantine de l’hôpital. Laure n’a pas oublié sa voisine de table, atteinte d’un autre maladie psychique sévère, qui avait perdu l’usage de la parole après avoir réalisé qu’elle avait mangé… des chatons. « Aucun médecin ne venait nous parler, même juste nous dire bonjour, on était transparents. »
C’est mon tour
Selon l’Inserm, les facteurs génétiques contribuent pour 60 % à l’apparition de cette maladie, en interaction avec des facteurs psychologiques et environnementaux (maltraitance, abus émotionnels, agressions sexuelles, etc.), parfois couplés à des problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie ou de troubles alimentaires. Quand les deux parents sont atteints, le risque que l’enfant développe la maladie est de 50 %. Tous les témoins interrogés ont donc eu peur d’être à leur tour malades, ont scruté le moindre signe avant-coureur dans leur comportement.
« Il faut faire attention à ce que ces enfants oubliés ne deviennent pas des enfants fléchés », alerte cependant Hélène Davtian Valcke, de l’Unafam. S’ils ont besoin d’exprimer leur ressenti et d’être accompagnés, il ne faut pas tomber dans le surdiagnostic, avertit-elle. « La prise en charge psychiatrique des enfants peut avoir des effets délétères en les plaçant comme futur malade probable. Or ils ont tous peur de devenir comme leurs parents, c’est une grande source d’angoisse pour eux. » Gare, donc, aux prophéties autoréalisatrices.
Lison, elle, a été diagnostiquée bipolaire – « on ne peut pas gagner sur tout », plaisante-t-elle. Tout comme Laure. « Ça s’est déclenché quatre ans après la naissance de mon premier fils. » Pendant cinq ans, elle refuse de voir un psychiatre. « Pour moi, c’était les médicaments qui avaient rendu ma mère malade, et comme on ne m’avait jamais expliqué le traitement… » Laure consulte des guérisseurs, des acupuncteurs. « J’attendais un miracle… » A la sortie d’un séjour dans un centre de méditation, grâce auquel elle a pu reprendre des forces, c’est la dégringolade. « J’ai essayé de me mettre des coups de fourchette dans le ventre et on m’a hospitalisée, dans le même lieu où avait été internée ma mère. » La malédiction. A la sortie, elle et sa famille sont hébergées par ses beaux-parents, qui pensent qu’elle joue la comédie. « Ma belle-mère disait à mes enfants que j’étais une mauvaise mère. »
Du rejet à la résilience
Comment pardonner à son parent lorsqu’on ne peut dissocier ce qui est de l’ordre symptomatique de ce qui fait partie de sa personnalité ? Comment ne pas rompre les liens ? Car la maladie psychique sépare. Elle dissout les couples, éloigne les enfants. Cet angle mort, ce silence autour de la maladie, que certains proches s’imposent à eux-mêmes, se transforme en colère. Et provoque du rejet. « Je ne me disais pas : ma mère est malade. Je lui en voulais. Point barre, résume Julien Carpentier. Le plus dur, c’est de passer de l’espoir au désespoir. C’est un renouvellement incessant qui épuise. Il y a des moments où on se met à distance, parce qu’on en a marre. » Pour Laure Mollier, qui se décrit comme infecte avec sa mère à l’adolescence, « on le comprend vraiment quand soi-même on l’a » : « Tu souffres dans ton corps et ton esprit, et tu souffres d’être incapable de pouvoir t’occuper de tes enfants. C’est la double peine. »
Tous expliquent la difficulté de réussir à se remettre au premier plan. « On a tellement l’habitude d’être en soutien, que nos propres besoins, nos envies sont relégués. Il faut une vraie révolution intérieure pour récupérer de l’amour-propre », analyse Julien Carpentier. Comme Laure Mollier et Joachim Lafosse, le réalisateur affirme que ce vécu l’a rendu malgré tout plus sensible, plus empathique. « Ça nous permet de ne pas être manichéens. C’est douloureux dans une société polarisée, mais on est tellement conscients des zones grises que cela rend plus tolérant. » Parfois, plus solide face à l’adversité. Et aussi, plus créatif.
Laure Mollier, qui pendant longtemps s’est sentie « hors service, comme un truc qui ne marche plus et ne sert à rien dans la société », est stable depuis une dizaine d’années et a décidé de porter la poésie dans la plaie. Il y a six ans, elle a monté un spectacle pour raconter son histoire en chansons, en reprenant certains des textes qu’elle avait écrits à l’hôpital. Son album est en préparation. « C’est mon héritage et mon cadeau », dit-elle dans un sourire. Elle se produit dans les théâtres, musées et structures de soins. « J’ai même joué à Sainte-Anne ! » Comme le chante Oxmo Puccino dans Toucher l’horizon : plus on est de fous, plus on évite la camisole.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire