Les termes et identités « gender fluid » ou « non binaires » commencent à prendre leur place dans la société et dérangent, plusieurs décennies après l’apparition des études du genre, un ordre « naturel » hétéronormé.
Enquête. Une vague, ou une déferlante ? En février, sous le titre « Mode, beauté, nouvelle identité… l’éclat unisexe », illustré par une photo de la très androgyne top-modèle Erika Linder, le magazine Vogue Paris consacre un dossier à ce « phénomène de société ». Un mois plus tard, dans son numéro du 27 mars, l’hebdomadaire L’Obs fait sa « une » sur le thème « Ni fille ni garçon ». L’enquête s’accompagne d’un éditorial intitulé « 50 nuances de genre », dans lequel Dominique Nora, directrice de la rédaction, souligne que « les “non-binaires” forment l’avant-garde d’un combat sociétal ». Dans les médias, sur les réseaux sociaux, au détour des couloirs des collèges et des lycées, un terme émerge avec insistance : « fluidité du genre ». Mais de quoi parle-t-on ?
La fluidité du genre ne désigne pas les personnes intersexes, nées avec une ambiguïté des organes génitaux, sur lesquelles le Sénat s’est penché récemment pour s’émouvoir d’opérations chirurgicales trop précoces. Pas plus que les gays et lesbiennes, dont l’orientation sexuelle sort du cadre hétéronormé dominant. Dérivé de l’anglais gender fluid, le terme englobe en revanche tous ceux qui, dans leur identité de genre, ne se sentent ni tout à fait homme ni tout à fait femme, ou à la fois homme et femme, ou encore homme né dans un corps de femme ou inversement, bref, tout ce qui ne correspond pas strictement à notre catégorisation binaire entre masculin et féminin.
Après l’affaire Weinstein, la parole libérée
« La question de la fluidité du genre n’est pas seulement travaillée par les médias, observe Marlène Coulomb-Gully, professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université Toulouse II-Jean-Jaurès. Cela fait trente ans que j’enseigne à l’université, quinze ans que ce que j’enseigne est en lien avec le genre, mais cela fait deux ans seulement que des étudiants viennent me voir pour me faire part de leur impossibilité ou de leur refus de se voir assigné à un genre. » Comment expliquer cette soudaine libération de la parole ? Cette spécialiste des représentations du genre dans les médias y voit notamment une des retombées de l’affaire Weinstein, qui a largement rendu publique, à travers le harcèlement sexuel, la question du genre. Elle souligne également que les questions de genre sont maintenant enseignées au lycée, voire à l’école primaire. « Cela fait donc un certain nombre d’années que les jeunes sont capables de mettre des mots sur les phénomènes et les ressentis dans ce domaine. »
Masculin, féminin : si l’assignation à l’un de ces deux genres fait de plus en plus débat, si un nombre croissant de personnes réclament que le « M » ou le « F » puisse être remplacé par un « X » (pour « neutre ») sur leur certificat de naissance, comme l’autorise la ville de New York depuis début 2019, cette évolution sort en droite ligne des études de genre.
Dès les années 1960, le concept de genre est repris par les féministes, qui s’en emparent pour interroger la domination masculine et revendiquer l’égalité des droits entre hommes et femmes
Apparu il y a plusieurs décennies, aux Etats-Unis d’abord, en Europe ensuite, ce vaste champ interdisciplinaire, qui regroupe tous les pans des sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, géographie, anthropologie, économie, sciences politiques, etc.), est fondé sur un postulat simple : le sexe biologique ne suffit pas à faire un homme ou une femme, les normes sociales y participent grandement. D’où la différence entre « sexe » et « genre ».
En révélant les codes sociaux qui façonnent le masculin et le féminin, les études de genre troublent l’ordre « naturel » entre les sexes. Elles démontrent que l’identité de genre (la perception d’être masculin ou féminin) ne se construit pas seulement sur notre sexe biologique, mais aussi en intégrant, souvent de façon implicite, les valeurs et les rôles assignés par la société à cette appartenance. En dissociant intellectuellement le culturel et le biologique, le concept de genre interroge les clichés liés au sexe. Celui selon lequel, par exemple, les femmes seraient naturellement plus enclines à s’atteler aux tâches domestiques que les hommes : il s’agit là, affirment les gender studies, d’une construction sociale et historique, et non pas du fait que la femme est dotée d’un vagin et d’ovaires.
Le concept de genre apparaît pour la première fois dans les années 1950, sous la plume du psycho-sexologue américain John Money, qui utilise l’expression « gender role » pour distinguer le statut social de l’homme et de la femme de leur sexe anatomique. Une dizaine d’années plus tard, le psychiatre américain Robert Stoller forge quant à lui la notion de « gender identity » pour étudier les personnes trans, qui ne se reconnaissent pas dans le sexe assigné à leur naissance. Dès les années 1960, cette idée neuve est reprise par les féministes, qui s’en emparent pour interroger la domination masculine et revendiquer l’égalité des droits entre hommes et femmes. Très vite, la question irrigue les sciences sociales américaines, puis européennes.
L’émergence de la théorie « queer »
En s’interrogeant sur la « fabrique » quotidienne du masculin et du féminin, les études de genre revisitent à nouveaux frais l’apport de l’anthropologue Margaret Mead, qui affirmait, dans l’Amérique puritaine des années 1930, que les caractères des hommes et des femmes étaient conditionnés par le groupe dans lequel ils évoluaient. Mais aussi les travaux de défricheurs comme Simone de Beauvoir (« On ne naît pas femme, on le devient »), Michel Foucault ou Pierre Bourdieu.
Dans les années 1990, nouveau tournant : les études féministes commencent à fusionner aux Etats-Unis avec les gay et lesbian studies, qui questionnent l’homosexualité. C’est l’époque où émerge la théorie queer (bizarre, étrange), portée par la philosophe Judith Butler. Son ouvrage phare, Gender trouble (1990), traduit en français en 2006 (Trouble dans le genre, La Découverte), se démarque du féminisme traditionnel en remettant en cause la bipolarisation entre homme et femme.
Les filles ne sont plus tenues de jouer les midinettes, ni les garçons les fiers-à-bras. Les rôles peuvent même s’inverser, l’entre-deux s’expérimenter. Tout devient possible. Le genre devient fluide
Quoi d’étonnant, dès lors, si les frontières se brouillent ? En déconstruisant les différences de sexe, puis la catégorisation homme/femme à l’aune de la construction sociale, les études de genre ont ouvert en grand les portes d’un univers inexploré. L’éternel féminin en a pris un coup, tout comme la maxime hippocratique tota mulier in utero (« toute la femme est dans son utérus »), qui l’enfermait dans son corps. A mesure que les modèles de la féminité se démultiplient, les canons de la virilité, à leur tour, se complexifient. Les filles ne sont plus tenues de jouer les midinettes, ni les garçons les fiers-à-bras. Les rôles peuvent même s’inverser, l’entre-deux s’expérimenter. Tout peut s’inventer, tout devient possible. Le genre devient fluide.
« Il ne s’agit pas simplement d’une mode, d’un épiphénomène urbain, estime le philosophe des sciences naturelles Thierry Hoquet. Des éléments nouveaux sont apparus récemment, qui font que le cadre normatif s’est globalement élargi vis-à-vis des questions de genre. Au plan technique, par exemple, la prise d’hormones pour un changement de sexe est plus facile à obtenir qu’auparavant. » Au plan juridique, le contexte s’est également assoupli : en mai 2016, un amendement au projet de loi de modernisation de la justice (promulguée en novembre 2016) a grandement simplifié le changement d’état civil pour les personnes trans, qui n’ont plus à apporter la preuve « irréversible et médicale d’une transformation physique » pour obtenir une modification de leur sexe à l’état civil.
Pour ce philosophe, auteur de Sexus nullus, ou l’égalité (iXe, 2015) – un savoureux conte philosophique dans lequel un candidat à l’élection présidentielle propose la suppression de toute mention du sexe à l’état civil –, le monde binaire est aujourd’hui travaillé par des « forces épicènes », qui rendent possibles des devenirs différents. Un mot épicène (du grec epíkoinos, « possédé en commun ») est un mot désignant un être animé, qui peut être employé au masculin et au féminin sans variation de forme : « élève » ou « enfant », par exemple. « Ou encore le prénom Charlie, qui est à la fois celui de ma voisine et celui de mon oncle », illustre Thierry Hoquet. L’épicène, précise-t-il, se distingue du neutre.« Quand on entend “neutre”, on pense déni ou effacement des sexes. Ce que dit la notion d’épicène, ou de fluidité, ce n’est pas une négation : c’est une richesse de potentialités. Il est essentiel de laisser nos enfants s’épanouir dans différentes directions sans les contraindre au nom de la biologie. »
Eddy de Pretto, Chris, Bilal Hassani…
Tout le monde, tant s’en faut, n’est pas devenu familier avec la fluidité. Mais la question, dans les villes plus que dans les campagnes, travaille les jeunes générations. Selon une étude YouGov réalisée pour L’Obs début 2019, 14 % des 18-44 ans se considèrent comme « non binaires » (6 % ont répondu « oui tout à fait », 8 % « oui plutôt »). Divers phénomènes de la culture pop – Chris (ex-Christine and the Queens), le chanteur Eddy de Pretto, les acteurs et musiciens Jaden Smith et Ezra Miller – flirtent ouvertement avec le queer : pour Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue Paris, ils constituent les « étendards éclatants d’une nouvelle identité », et sont « décidés à rendre visibles aux yeux des autres leur vérité, aussi trouble soit-elle, et leur singularité ». Les arènes artistiques permettant aux minorités de genre de s’exprimer sont de plus en plus visibles, telle la scène drag queen parisienne. Sans parler de Bilal Hassani, candidat français à l’Eurovison 2019, dont la chanson Roi reflète le vécu – « Je suis le même depuis tout petit et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris (…). Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. »
Serait-on entré dans un nouveau monde où ceux qui souhaitent s’émanciper du genre peuvent prendre la parole et la lumière ? La réalité n’est pas si simple. Car cette évolution suscite en retour une opposition très forte, comme le montre un peu partout en Europe l’ampleur des campagnes antigenre. « Le principe est newtonien : plus on avance d’un côté, plus la réaction est forte de l’autre. Pour l’instant, dans ce domaine, la parole est encore du côté des progressistes. Mais jusqu’à quand ? », s’interroge Marlène Coulomb-Gully.
Estimant que l’on touche à « quelque chose d’absolument fondamental en termes d’identité personnelle », la professeure en sciences de l’information et de la communication craint que la parole libérée par « les populismes de tout crin » touche aussi les questions de genre. Si les actes homophobes se multiplient ici et là, si les forces réactionnaires menacent les droits LGBT dans un nombre croissant de pays, ce n’est évidemment pas un hasard. La binarité des sexes a longtemps mené le monde, et avec elle, la « norme hétérosexuelle ». Leur déconstruction éveille donc de profonds fantasmes de peur, sur lesquels le Vatican, qui dénonce de longue date cette pensée « relativiste », a beau jeu de s’appuyer.
Mais l’angoisse de la confusion des genres ne touche pas que l’Eglise. « La réappropriation par chacun de son apparence de genre peut être considérée comme une volonté de s’émanciper de la nature, souligne le philosophe Thierry Hoquet. Pour certains, ces décisions individuelles remettent en question quelque chose de fondamental dans la définition de notre vivre-ensemble. Elles semblent engager la définition de la société dans laquelle on vit, et plus globalement remettre en question l’héritage biologique de l’humain. »
« Toute une frange de la société craint l’éclatement des formes familiales et parentales qui pourrait découler d’une “fluidité” des genres, et elle s’accroche aux stéréotypes de sexe », Marie Duru-Bellat, sociologue
Le genre au risque de la négation du corps : c’est ce que dénonce par exemple le philosophe Jean-François Braunstein, dans La Philosophie devenue folle (Grasset, 2018). « Il faut désormais affirmer que le genre doit être totalement découplé de l’anatomie », écrit-il, en fustigeant le « nouvel idéal » que serait la fluidité des genres. « Les corps ne comptent plus, seules comptent les consciences, le sentiment que nous avons d’être ceci ou cela. » Dans son dernier ouvrage, Qui a peur de la théorie queer ? (Les Presses de Sciences Po, 2018), Bruno Perreau, spécialiste des questions de genre et professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT, Etats-Unis), analyse l’origine des peurs suscitées par la déconstruction des genres. Il s’attache notamment à démontrer que l’un de ses moteurs est la crainte de la propagation de l’homosexualité. « Indifférente à la différence des sexes, la “théorie du genre” fabriquerait une société transgenre où l’hétérosexualité serait contrainte d’abdiquer son hégémonie et où l’homosexualité ne serait plus contenue par rien d’autre qu’elle-même », écrit-il, en qualifiant cette crainte de « fable épistémologique ».
C’est « parce que toute une frange de la société craint l’éclatement des formes familiales et parentales qui pourrait découler d’une “fluidité” des genres qu’elle s’accroche aux stéréotypes de sexe », renchérit la sociologue Marie Duru-Bellat, qui a analysé des décennies durant la manière dont se construisent les inégalités hommes-femmes, notamment dans le système scolaire. Et de souligner, dans La Tyrannie du genre (Presses de Sciences Po, 2017), cet étrange paradoxe : les controverses récurrentes sur le genre ont conduit ces dernières années à une célébration croissante des différences entre les hommes et les femmes, construisant, jour après jour, de nouvelles formes de domination masculine.
Que dire à ceux qui craignent que la marche vers l’égalité aboutisse à une forme d’indifférenciation des sexes ? A la confusion des genres ? En conclusion d’un petit livre écrit en 1993 (Les Cinq Sexes, Payot & Rivages), l’Américaine Anne Fausto-Sterling, professeure de biologie et d’études de genre à l’Université Brown, répondait ceci : « Il arrive parfois que des gens me demandent, non sans horreur, si je ne milite pas pour un monde couleur pastel, dans lequel l’androgynie serait reine et où hommes et femmes seraient exactement les mêmes. A mes yeux, pastel et couleurs vives cohabitent. Il existe et existera toujours des personnes extrêmement masculines. Simplement, certaines sont des femmes. Et dans mon entourage, certaines personnes des plus féminines sont bel et bien des hommes. » Cela ne rassurera pas tout le monde.

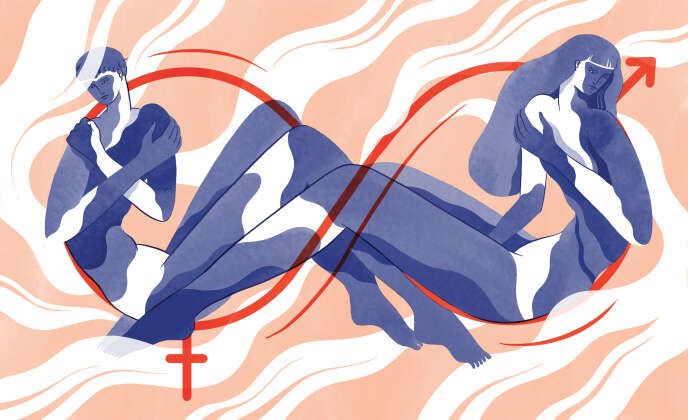

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire