Par Laure Belot Publié le 15 mai 2023
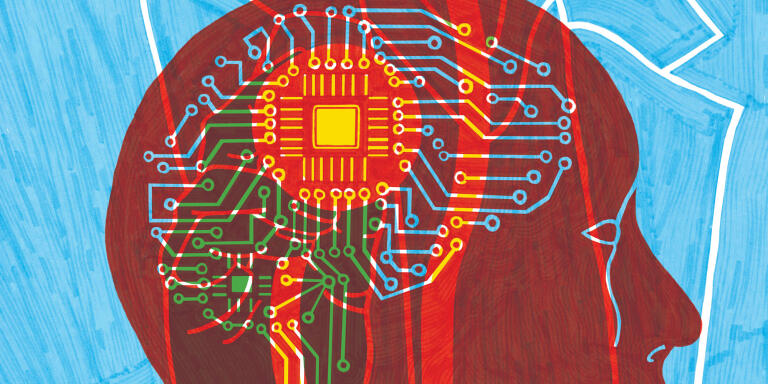
Ils sont anesthésiste, chirurgien, obstétricien… Certains ont terminé leurs dix ans d’études supérieures depuis peu, d’autres ont des années de pratique. Mais tous ont plongé sans l’avoir anticipé dans le monde des start-up pour une même finalité : répondre à un besoin médical dans leur spécialité à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle (IA).
Qu’il s’agisse d’une application conçue par une chirurgienne afin d’utiliser une photo prise par un smartphone pour analyser la compatibilité d’un greffon de foie ou d’un examen de sang pour mieux évaluer les risques postopératoires d’un patient mis au point par un anesthésiste, ces innovations viennent du terrain. Elles sont « bottom-up », comme le disent les Anglo-Saxons, et, de fait, « à l’opposé de certaines démarches opportunistes pensées par des ingénieurs à partir des données de santé, sans savoir s’il existe un besoin médical précis ou si celui-ci est une priorité. De nombreux projets d’IA sont encore rendus possibles uniquement par l’écosystème financier », constate le radiologue spécialisé en oncologie Antoine Iannessi, cofondateur, en 2013, de la start-up Therapixel.
Les projets de ces médecins entrepreneurs utilisent différents types d’IA, de l’apprentissage machine (dit aussi « machine learning ») aux réseaux de neurones (dits « deep learning ») en passant par la plus récente, l’IA dite « générative » (comme le très médiatique agent conversationnel ChatGPT, lancé en novembre 2022).
Tandis que Geoffrey Hinton, un des pionniers de l’IA moderne, vient de démissionner de son poste chez Googlepour pouvoir s’exprimer librement sur le développement fulgurant de cette technologie dont « les futures versions pourraient être un risque pour l’humanité », dit-il, et que certains acteurs de la société et des sciences plaident pour une pause dans les recherches, ces médecins entrepreneurs mettent simplement en avant leur objectif de mieux soigner. Le neuroradiologue Arnaud Attyé, cofondateur de GeodAIsics, ajoute même que son statut de start-upeur est une façon d’amener « la déontologie médicale et le serment d’Hippocrate dans le milieu de l’entreprise ».
En se lançant, ces spécialistes peuvent être conduits à quitter partiellement leur pratique et s’entourent de compétences complémentaires, notamment d’ingénieurs. Un brassage de cultures « rendu désormais plus facile en France », constate Antoine Iannessi. « Ce peut être lié à un changement générationnel, mais cela vient également de la place du monde des données, devenu central dans la santé, estime-t-il. La médecine est de plus en plus biotechnologique et voit arriver des formations mixtes pour répondre à ces besoins. Les ingénieurs vont vers la santé, et vice versa. »
Les premières applications concrètes de l’IA utilisées en routine dans des lieux de soins étant apparues en radiologie, quelques spécialistes français ont déjà créé des start-up en 2018, tels Nor-eddine Regnard (fondateur de Gleamer) ou Alexandre Parpaleix (fondateur de Milvue). « Je les ai vus passer à l’hôpital Cochin [à Paris] en formation clinique »,explique le professeur de radiologie ostéoarticulaire Antoine Feydy, directeur pédagogique du diplôme d’études spécialisées de radiologie d’Ile-de-France de 2017 à 2022. Désormais, d’autres spécialités médicales rejoignent cette aventure, avec des projets encore en phase d’évaluation et souvent en recherche de financement.
« Même si la tendance correspond à une proportion infime de médecins, cette envie entrepreneuriale est un phénomène positif », estime le mathématicien et ancien député de l’Essonne Cédric Villani. « Face à un système universitaire qui a toujours son rythme, cela reflète une volonté de saisir de nouvelles occasions pour se développer avec agilité. Et même si elles n’existent qu’en petit nombre, ces structures peuvent générer un effet d’entraînement et d’inspiration. » Une impulsion que confirme le médecin Clément Goehrs, fondateur de Synapse Medicine à Bordeaux (92 salariés), qui accueille depuis 2022 des internes en stage de six mois pour s’acculturer à l’IA, ou plus si affinité. Phénomène similaire chez Owkin, start-up emblématique franco-américaine cofondée en 2016 par l’hématologue Thomas Clozel, et employant désormais 300 salariés.
De Marseille, Paris, Grenoble, Palo Alto (Californie) ou encore New York, voici sept histoires de médecins devenus entrepreneurs pour répondre, avec l’IA, à des besoins concrets de leur spécialité médicale.
Prédire si un foie peut être greffé à l’aide d’une photo
Avion Paris-Colmar, le 13 juillet 2013, à minuit. Manuela Cesaretti, 29 ans, interne en chirurgie, s’endort « de stress » sur son siège, se rappelle-t-elle. Une heure auparavant, le chirurgien de garde de l’hôpital Beaujon (Saint-Ouen, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP) lui a demandé en urgence de se rendre seule en Alsace pour analyser un greffon de foie. Habituellement, ces déplacements se font à deux, un interne et un jeune chirurgien. Sur place, il lui faut estimer le taux de stéatose hépatique (pourcentage graisseux), car, si celui-ci est trop important, la greffe est proscrite.
Arrivée à Colmar, comme le veut la procédure, Manuela presse le foie du donneur avec son doigt afin de chronométrer la rémanence de la trace blanche laissée. C’est l’indicateur le plus utilisé et l’organe lui semble compatible. Pour une double lecture, elle décide cependant d’envoyer des photos au chirurgien qui, à distance, regarde les bordures du foie, ses couleurs, ses marbrures, puis lui envoie un SMS de confirmation. Le retour de l’organe s’organise comme prévu. A partir de ce jour, Manuela Cesaretti ne cessera de repenser à ce simple smartphone qui a aidé à valider sa décision.
Dix ans plus tard, désormais chirurgienne senior à l’hôpital Beaujon, elle a cocréé e-Stella, une application utilisant une intelligence artificielle pour mesurer le taux de stéatose hépatique à partir de photos. Une démarche pour laquelle elle a dû elle-même se former au code informatique. « J’ai passé une thèse de bio-ingénierie et robotique à distance, en Italie, tout en continuant ma pratique chirurgicale à Paris, explique-t-elle. Je partais de tellement loin que cela m’a pris six ans ! »Malgré les trois articles scientifiques publiés durant cette période, « je me suis rendu compte que j’avais besoin d’aide. J’avais eu une idée, j’avais désormais un projet, mais toujours pas de produit ».
Par un ami d’ami, elle rencontre alors Clément Labiche, datascientist et ancien start-upeur, avec qui elle fonde, en juin 2019, Stella Surgical. Un prix obtenu par l’Agence de la biomédecine plus tard, la start-up est désormais en pleine étude clinique, « avec les trois établissements de l’AP-HP proposant des greffes hépatiques, l’hôpital Beaujon, la Pitié-Salpêtrière et l’hôpital Paul-Brousse », dit-elle. L’algorithme d’apprentissage machine, entraîné par une méthode statistique sur des centaines de photos de foie annotées, « a pour l’instant une précision de 88 % pour donner le taux de stéatose », précise Manuela Cesaretti. Stella Surgical, qui emploie douze salariés, occupe la moitié de son temps. Le reste est consacré à sa passion, la chirurgie.
Identifier les risques d’anomalies cardiaques d’un fœtus
Plus de 2 500 bébés mis au monde ! L’obstétricien Edwin Quarello, chef de service de gynécologie à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, est spécialisé depuis trente ans sur les grossesses à risque. Très tôt, dit-il, il a préféré « [sa] liberté et la mise en pratique de [ses] idées » à une carrière strictement académique.
Après quatre-vingt-treize publications scientifiques et une thèse de biologie sur l’élastographie du fœtus de babouin (une étude des propriétés viscoélastiques des tissus mous), ce scientifique va explorer l’IA fortuitement, en 2018, à l’aide d’un jeune papa, le mathématicien ukrainien Ivan Voznyuk. « Ivan m’a demandé quels étaient les besoins non résolus dans ma pratique, se souvient Edwin Quarello. Je lui ai d’emblée parlé des malformations cardiaques, qui touchent huit bébés sur 1 000 et sont associées, dans 30 % des cas, à des maladies plus ou moins complexes. » Un problème sur lequel ils décident de travailler ensemble.
Le défi est de taille. « Lors d’une échographie, le fœtus et le ventre de la maman bougent », explique l’obstétricien. « La procédure veut que nous réalisions cinq images, des coupes du cœur très formalisées, A pour situs abdominal, B pour quatre cavités, C pour voie d’éjection gauche, D, E… », énumère-t-il. « J’ai expliqué à Ivan que la machine de mes rêves serait celle qui m’indiquerait en direct par un code couleur simple, vert, orange ou rouge, les risques d’anomalies cardiaques décelés dans chacune de ces coupes. »
Pour ce faire, Edwin Quarello va annoter plus de 5 000 images de coupes A, B, C, D, E. Il définit quarante-sept repères anatomiques à regarder pour les cinq coupes et leur attribue un caractère binaire « présent » ou « absent ». « Cela m’a pris huit mois de ma vie, les nuits et les week-ends parallèlement à ma pratique », se souvient-il.
Autant de données qui nourrissent l’algorithme d’IA conçu par Ivan pour « objectiver de façon quantitative la qualité de l’examen échographique ». Leur premier résultat, la coupe C lue par IA, présenté en octobre 2021 au Congrès de médecine fœtale de Montpellier, « fait sensation », se souvient Edwin Quarello. « Ce programme est une ceinture de sécurité pour nos pratiques », car la qualité de l’échographie est très liée à l’opérateur. Depuis, l’algorithme fonctionne sur les cinq coupes, avec une précision de 93 % à 96 % pour la reconnaissance des différents critères. La start-up Diagnoly, qu’ils ont cofondée, salarie désormais sept personnes, et Edwin Quarello continue à exercer.
Diagnostiquer plus efficacement les cellules cancéreuses
En avril 2017, lors d’un banal déjeuner familial, la vie professionnelle de Marie Sockeel prend un virage inattendu. Cette trentenaire, médecin anatomopathologiste qui analyse quotidiennement au microscope des lames constituées de cellules pour repérer des pathologies, explique se trouver souvent « très seule » pour poser des diagnostics de cancer.
D’autres décisions peuvent être compliquées à prendre, relate-t-elle : sur de mêmes polypes digestifs, deux médecins ont des diagnostics dont la précision diffère dans 40 % des cas. Elle raconte aussi ses longues heures à compter, avec une calculette posée près du microscope, le nombre de mitoses – les divisions d’une cellule mère en deux cellules filles génétiquement identiques – pour estimer la virulence d’une pathologie, un exercice répétitif sans grande valeur ajoutée. « Appliquer une IA à ma discipline serait génial », lance-t-elle, au cours de ce déjeuner.
« Je ne pensais pas que cette discussion irait plus loin », reconnaît-elle aujourd’hui. Mais Fanny, sa sœur aînée consultante, et Stéphane, son cousin mathématicien, embrayent sur le sujet. A tel point qu’en quelques mois Primaa, start-up familiale, se crée avec pour ambition de diagnostiquer plus efficacement les cancers.
Le premier défi va être d’obtenir des lames numérisées pour entraîner un algorithme d’IA. « Une lame numérisée, sur laquelle on doit pouvoir zoomer jusqu’au contour du noyau d’une cellule, prend 1 gigaoctet de capacité de stockage, dix fois plus qu’un cliché d’IRM. Et un prélèvement d’un patient peut générer jusqu’à cinquante lames, explique-t-elle.C’est ce coût de stockage qui explique que peu de start-up soient sur le créneau. » Par son réseau médical, Primaa réussit à se constituer une base de 20 000 lames.
Second défi de taille, annoter ce matériau pour apprendre à l’algorithme à faire le lien entre critères annotés et diagnostic. « Une centaine de pathologistes rémunérés nous a aidés », précise-t-elle. Six ans plus tard, Cleo Breast, leur logiciel qui diagnostique un cancer du sein infiltrant (potentiellement le plus grave) « avec une précision de 99,3 % », est utilisé en routine à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre et est testé dans d’autres centres spécialisés tels l’Institut Curie, l’Institut Gustave-Roussy, l’Institut Bergonié, l’ICM de Montpellier, l’hôpital Saint-Joseph… « Les cas que l’algorithme rate sont habituellement décelés par le pathologiste, ce qui le rend très complémentaire », explique-t-elle. Leur nouveau logiciel, Cleo Skin, qui diagnostique 80 % des cancers de la peau (mélanome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde), est actuellement testé chez Medipath, un réseau privé de médecins pathologistes avec lequel il a été développé.

Mieux préparer les patients à la chirurgie
Fils et frère d’anesthésiste, Yassine Moussali n’a pas vraiment hésité pour choisir sa voie. Après un externat de médecine à Lyon, il enchaîne ses stages d’internat en anesthésie à l’Institut Curie, à Gustave-Roussy, à l’hôpital Guy & Saint-Thomas à Londres… Des services de chirurgie pédiatrique, cancérologique, cardiaque où il constate une similarité : « Les médecins n’étaient en rien responsables, mais un volume bien trop important d’informations était transmis sur papier sans un minimum d’automatisation. Cela entraînait des problèmes d’efficacité et de sécurité », se rappelle-t-il.
Geek dans l’âme, Yassine Moussali choisit comme sujet de thèse « L’Amélioration de la préparation des patients à la chirurgie ». Il souligne dans ce travail que, par manque de tri, les anesthésistes perdent du temps avec les « ASA1 » (personne sans problème de santé), au détriment des autres. Il y suggère aussi que l’IA pourrait augmenter, à effectif d’anesthésistes constant, la sécurité des actes chirurgicaux. Présent dans le jury de thèse, un professeur de l’hôpital Foch discute avec lui, intéressé. Sans que Yassine Moussali en soit réellement conscient, l’aventure de Hoopcare est lancée.
Quatre ans plus tard, la start-up compte une dizaine de salariés entre New York et Paris, dont la moitié d’ingénieurs. Le premier produit de l’entreprise, un algorithme d’IA symbolique utilisant un arbre décisionnel basé sur soixante-dix questions posées aux futurs opérés, est utilisé en routine à l’hôpital Foch.
Leur seconde proposition est un algorithme d’apprentissage machine, dont la tâche est d’identifier les problèmes biologiques des futurs opérés. Ce programme prédit un « score » de préparation d’un patient et envoie aux médecins des préconisations (traiter les carences en fer, sevrage tabagique…) à optimiser avant l’intervention. Entraîné sur les données biologiques de 25 000 personnes, cet algorithme est en étude clinique à l’hôpital Foch et au Delaware Christiana Care, aux Etats-Unis.
Prédire le risque de complication postopératoire par une prise de sang
A 10 ans, Brice Gaudillière se souvient recopier avec fascination la phrase « le corps est composé de milliards de cellules » d’un livre de science qu’on lui avait offert. Trente-cinq ans plus tard le voici médecin chercheur, responsable d’un laboratoire de quinze personnes à l’université californienne Stanford et cofondateur de Surge.
Cette start-up veut répondre, en étudiant ces milliards de cellules, à une préoccupation mondiale : prédire le risque de complications postopératoires. Ces problèmes « concernent environ 20 % des opérations aux Etats-Unis et en Europe »,explique-t-il. La start-up franco-américaine qu’il a fondée avec l’ingénieur Julien Hédou, son PDG, propose d’évaluer ce risque avec une précision de 85 %, à l’aide d’une IA et à partir d’une prise de sang. Ce chiffre atteint même « 90 % si on rajoute des informations cliniques (âge, sexe…) du patient », précise-t-il. « Jusqu’à présent les protocoles de prédiction avaient des scores de 65 % à 70 % et n’étaient donc pas utilisés. »
Pour arriver à ce résultat, Brice Gaudillière s’est nourri de son parcours scientifique transdisciplinaire. Après l’Ecole polytechnique, il bifurque pour faire sur la côte est des Etats-Unis une thèse de biologie moléculaire couplée à des études de médecine à Harvard-MIT, suivies d’une spécialisation en anesthésie. Son travail se focalise sur les réponses du système immunitaire à des stress, notamment chirurgicaux.
Puis, lors de son postdoctorat en 2011 à l’université Stanford dans le laboratoire de Garry Nolan, il vit, dit-il, « un moment historique : la découverte de la cytométrie de masse ». Cette approche, qui permet d’analyser « l’information protéomique[la fonction des protéines] » à l’échelle d’une seule cellule, « est une révolution équivalant à celle de l’IRM dans le domaine de la radiographie, explique-t-il. A partir de cette date, on a pu prendre l’empreinte digitale du système immunitaire d’un patient ».
Une fois à la tête de son propre laboratoire, Brice Gaudillière va rassembler ces deux axes de recherche, le stress immunitaire et cette nouvelle mesure à l’échelle cellulaire. « A partir du sang, nous avons réalisé une stimulation biologique qui reproduit le stress chirurgical et avons pu voir quels patients développaient une complication. » Pour arriver informatiquement à ce résultat, l’algorithme d’IA a été entraîné sur « plus de 2 500 caractéristiques mesurées sur des millions de cellules pour les réduire à une dizaine de biomarqueurs caractérisant le risque postopératoire », explique-t-il. Parmi ces biomarqueurs, par exemple, « la concentration de la cytokine IL-1β et le signal p-STAT3 dans les neutrophiles », illustre-t-il.
Deux études cliniques ont été réalisées à Stanford, respectivement sur 45 et 96 patients. Une troisième, menée par Surge sur 250 patients, est en cours à l’hôpital Foch et dans des établissements de l’AP-HP. Pour créer cette start-up qui compte une dizaine de salariés, « j’ai eu un réflexe de médecin. Je me suis dit qu’il fallait apporter cette technologie au lit du patient », explique-t-il.
Créer un « jumeau numérique » des patients pour mieux soigner
Passionné d’informatique et de médecine, le jeune trentenaire Arnaud Attyé trouve en Grenoble la ville multidisciplinaire idéale pour se spécialiser en neuroradiologie. Son projet, en 2011, est alors de poursuivre au CHU une activité mixte de recherche et de pratique hospitalière. C’est de ce poste que cet ardent défenseur du service public découvre, quelque peu dépité, une nouvelle réalité. « Alors que pendant vingt ans les grandes publications scientifiques dans ma discipline étaient issues d’équipes académiques, les suivantes sont venues de collaborations avec des start-up, les académiques amenant au mieux leur savoir-faire scientifique et technique, au pire juste leurs patients ! »
Un doctorat en biotechnologie et un postdoctorat d’intelligence artificielle en Australie plus tard, le neuroradiologue devient pragmatique. « Je suis revenu d’Australie avec des idées non réalisables au CHU, reconnaît-il. Impossible de retenir les meilleurs codeurs formés à l’hôpital. Le système actuel d’innovation favorise un écosystème de start-up. Nous sommes perdants en y restant extérieurs. » A 42 ans, le voici donc devenu fondateur de GeodAIsics, avec Félix Renard, Pierre Heudel et Arnaud Jean, respectivement ingénieur, oncologue et biologiste.
Leur projet médical ? « Entraîner une IA afin qu’elle puisse identifier des anomalies non décelables par des médecins experts, explique-t-il. Par exemple, si deux patients présentent cliniquement la même maladie d’Alzheimer, il s’agit d’identifier leurs différents profils d’atteintes cérébrales issus des données d’IRM mais non perceptibles par leradiologue. Ceci, afin de pouvoir appliquer des traitements plus personnalisés. »
Dans leur approche, les données de santé du patient (prises de sang, IRM cérébrale… ) sont comparées à celles d’un jumeau numérique, créé lui-même par une intelligence générative à l’aide d’une base d’apprentissage de milliers de ces mêmes types d’informations non annotées. La comparaison fine de cet « être synthétique » et du patient « sera un moyen de détecter plus précocement et de mieux soigner les maladies », dit-il. « Puisque ce n’est pas une boîte noire, car nous n’utilisons pas de réseaux de neurones pour identifier les maladies, cette démarche permettra aussi de rester compréhensible et de crédibiliser les soins thérapeutiques proposés. »
Première application, l’algorithme Bio d’AIsics, entraîné sur des centaines de milliers de prises de sang et à destination des biologistes, doit être commercialisé d’ici à fin 2023.
Mieux lire les pathologies avec le « GPT4 » de la radiographie
En 2015, l’étudiant Paul Hérent est une exception dans sa promotion de médecine. Alors interne en radiologie, il prend deux années de césure, la première pour suivre un master de sciences cognitives à l’Ecole normale supérieure afin d’apprendre les bases théoriques de l’intelligence artificielle, la deuxième pour appliquer celle-ci dans la start-up Owkin, tout juste créée. « C’est là que j’ai passé ma thèse, explique-t-il. Elle s’intitulait “Prédire l’âge cérébral à partir de données d’IRM”, et était la première en France utilisant des réseaux de neurones. »
De retour à l’hôpital pour terminer ses stages d’internat, Paul Hérent constate la forte inertie du système de santé. « Je voulais innover, mais l’IA évoluait bien plus vite que les hôpitaux, regrette-t-il. De plus, le temps clinique était trop important par rapport à celui réservé à la recherche. » Ce constat lui fait refuser un clinicat de neuroradiologie pour un CDI chez Owkin.
Trois ans plus tard, Paul Hérent a créé la start-up Raidium, avec l’ingénieur Pierre Manceron, rencontré chez Owkin. Leur objectif est de construire « un assistant radiologue qui aura appris la connaissance associée à l’anatomie normale et pathologique d’un humain ». Dans l’idéal, cet outil, qui puisera sa connaissance de clichés radiologiques, mais aussi de comptes rendus médicaux, de publication et littérature scientifique… pourra désigner, pour un patient donné, « des biomarqueurs de diagnostic, de pronostic, de réponse au traitement pour la recherche ou même la pratique clinique ».
Pour y parvenir, les scientifiques veulent « créer le premier modèle de fondation (ou le “GPT4”) de la radiologie, explique Paul Hérent. Jusqu’à présent, les images radiographiques étaient annotées pour apprendre à un algorithme à reconnaître les détails importants d’une pathologie ». Désormais, poursuit-il, « les algorithmes peuvent apprendre d’eux-mêmes, de façon autonome ». Pour l’instant, « cela prend beaucoup plus de volume d’informations, on ne comprend pas totalement comment cela fonctionne [cette IA utilise des réseaux de neurones], mais ces algorithmes ont un apprentissage qui se rapproche de celui d’un petit enfant qui observe et se construit un modèle du monde sans la supervision continuelle des parents. »
Pour la réalisation du premier prototype de ce programme, les deux scientifiques et leurs désormais quatre collègues ingénieurs ont constitué une cohorte rétrospective de « plusieurs centaines de milliers de clichés radiographiques de toutes les parties du corps », avec comme partenaire le centre d’imagerie du Nord à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La première version, qui va tourner, taille oblige, sur le supercalculateur Jean-Zay (le plus puissant de France), est annoncée « pour la fin d’année 2023 ».


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire