Par Youness Bousenna Publié le 12 novembre 2021
ENQUÊTE Le christianisme nous aurait-il coupés de la nature ? Le débat est vif depuis que l’interprétation occidentale de cette religion a été dénoncée, dans les années 1960, comme la « matrice » de la modernité et de l’exploitation brutale des ressources de la planète.
Certains dialogues se nouent sur des décennies, parfois des siècles. En 2015, les initiés n’ont pas seulement lu Laudato si ( « Loué sois-tu ») comme une encyclique révolutionnaire, la première jamais consacrée à l’écologie par un pape. Ils ont aussi compris que François entendait affronter l’une des plus graves mises en cause intellectuelles de l’Eglise, formulée un demi-siècle plus tôt. L’historien américain Lynn Townsend White (1907-1987), lui-même presbytérien, n’était pourtant pas un ennemi du christianisme. Mais, en publiant dans la grande revue américaine Science l’article « Les racines historiques de notre crise écologique », en mars 1967, ce médiéviste spécialisé dans l’histoire des techniques allait ouvrir une controverse qui, aujourd’hui encore, reste vive.
Dans ce texte, issu d’une conférence prononcée en décembre 1966, Lynn White émet une thèse particulièrement subversive : la crise écologique a été rendue possible par l’émergence, au cours du Moyen Age européen, d’une interprétation du christianisme qui en a fait « la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue ». De cette « matrice chrétienne » est issue toute notre modernité, affirme Lynn White, et en particulier la science, qui a offert à l’Europe sa supériorité technique sur le reste du monde et créé un rapport à la nature fait d’exploitation et de brutalité.
En soutenant une telle affirmation, l’historien allait déclencher une querelle philosophique, historique et théologique d’une intensité inédite, au point que son article est désormais l’un des plus commentés de ces dernières décennies – il totalise, à ce jour, près de 8 200 citations, selon Google Scholar (le service de Google permettant la recherche d’articles et de publications).
Vision « despotique »
Le cœur de la controverse porte sur la Genèse. Certains versets du premier texte de l’Ancien Testament, qui constitue le socle des trois monothéismes (le judaïsme, le christianisme et l’islam), placent l’homme en surplomb de la nature. Il y est écrit que Dieu « créa l’homme à son image » et lui dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la Terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la Terre. » C’est cette vision « despotique » qui s’est imposée jusqu’à notre modernité, selon Lynn White, et c’est à elle que répond Laudato si, cinquante ans plus tard. Bien entendu, le pape François ne nomme jamais l’historien américain ni ne mentionne son article. Mais le philosophe Dominique Bourg l’assure : « Le chapitre théologique de l’encyclique est évidemment une réponse à Lynn White. »
En invitant à chercher l’origine de la crise écologique en amont de la modernité, Lynn White attaque de front deux fondements de l’Occident : la science et la religion chrétienne
Référence incontournable du débat depuis 1967, Lynn White n’est pas le premier à dénoncer les racines chrétiennes médiévales de notre modernité industrielle, généralement considérée comme une rupture radicale avec le passé. L’ampleur prise par son article ne se comprend qu’à l’aune de son contexte : il intervient dans une décennie marquée, aux Etats-Unis, par les grandes contestations pacifiques et civiques, et l’émergence d’une contre-culture critiquant les fondements mêmes de la civilisation occidentale.
Sa parution, en 1967, le place à équidistance de deux dates capitales de la naissance du mouvement écologiste : en 1962, Printemps silencieux, de la biologiste américaine Rachel Carson, est le premier ouvrage à documenter la destruction du vivant par l’usage massif des pesticides, tandis qu’en 1972 paraît le rapport du Club de Rome « Les limites de la croissance », qui modélise, pour la première fois, l’incompatibilité entre la croissance économique et les ressources de la Terre. En invitant à chercher l’origine de la crise écologique en amont de la modernité, Lynn White participe à cette effervescence, en attaquant de front deux fondements de l’Occident : la science et la religion chrétienne.
La célébration de la Création
L’historien fut évidemment attaqué : ses détracteurs lui reprochent des raccourcis et des anachronismes. Les traditions chrétiennes n’ont d’abord pas toutes développé la même lecture de la Bible, à l’instar du courant orthodoxe qui porte « une vision terrestre de la Création : la nature est un espace de communion avec le Créateur [et] sa protection, un acte de foi », soulignent les chercheurs Bertrand Sajaloli et Etienne Grésillon (Dictionnaire critique de l’anthropocène,CNRS Editions, 2020). Il existe au cœur du christianisme une tradition marquée par la célébration de la Création, qui en irrigue toutes les branches. Dans sa Lettre aux Colossiens, saint Paul lui-même n’écrit-il pas : « C’est en Christ qu’ont été créées toutes choses, en Lui que tous les êtres ont été réconciliés par le sang de sa croix » ?
Pionnier de la pensée chrétienne en écologie, Jean Bastaire (1927-2013) voit dans ce corpus une vision cosmique du Christ. Cette « exaltation amoureuse » de la Création sera portée aux nues par la grande figure écologique du christianisme, saint François d’Assise (1182-1226), officiellement proclamé « saint patron des écologistes » par Jean Paul II, en 1979. C’est lui qui a inspiré à Jorge Mario Bergoglio son nom de pontife lors de son élection en 2013.
Son Cantique des créatures (1224-1225), dont les premiers mots ont donné son titre à Laudato si (« Loué sois-tu »), porte un chant d’amour d’une rare puissance poétique à l’égard de la nature : François y célèbre « notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes ». Ainsi, écrivait Jean Bastaire dans la revue jésuite Etudes, en 2005 : « L’Ecriture n’apprend rien sur le réchauffement climatique ou la disparition des espèces. Mais elle dit tout sur l’amour qui, selon Dante, “meut le ciel et les étoiles” et toute créature ici-bas. »
S’il reconnaît à Lynn White un propos valable pour l’époque moderne, il lui reproche d’étendre une vision de l’homme tyran sur un Moyen Age qui en était, selon lui, exempt. Cette position est aussi celle du philosophe Rémi Brague, professeur émérite à la Sorbonne, qui relève que cette domination despotique a pu être niée dès l’Ancien Testament – « La supériorité de l’homme sur la bête est nulle, car tout est vanité », dit, par exemple, l’Ecclésiaste (livre de l’Ancien Testament).
Dans Modérément moderne (Flammarion, 2014), Rémi Brague ironise sur un christianisme jadis considéré comme une pesanteur face aux avancées de la science et des techniques, et tenu aujourd’hui pour responsable de leurs avancées excessives : « Le christianisme réussit donc, quant au progrès comme ailleurs, cette prouesse d’avoir toujours tout faux. »
Une « dynamique occidentale »
Les défenseurs de Lynn White eux-mêmes admettent certains de ces raccourcis : « Les Racines historiques de notre crise écologique » se veut un texte d’engagement, à rebours d’une œuvre académique (non traduite en français) qui fait référence dans la discipline.
Car, sur le fond, l’historien met le doigt sur un bouleversement aujourd’hui exhumé par de nombreux travaux, lesquels rendent compte d’évolutions majeures entre les XIe et XIIIe siècles. « Lynn White a raison de cibler une “interprétation” issue du Moyen Age qui a puissamment contribué à la genèse de la modernité, et non le christianisme tout entier », estime Dominique Bourg, qui vient de publier Primauté du vivant (coécrit avec Sophie Swaton, PUF, 336 pages, 22 euros). Le médiéviste Sylvain Piron abonde : « Quand on remonte aux XIe et XIIe siècles, on constate que quelque chose commence. »
l’époque carolingienne (VIIIe-Xe siècles), qui naît sur les décombres de l’Empire romain, se dessinent une croissance agricole, des innovations techniques et une renaissance progressive de villes, désormais tenues par les marchands, qui fécondent une « dynamique occidentale », explique Sylvain Piron.
Ces siècles sont aussi marqués par un mouvement diffus, mais que l’historien considère comme « la bifurcation la plus fondamentale » du christianisme occidental : l’importance croissante donnée à l’humanité souffrante du Christ, témoignant d’une envie nouvelle de matérialiser la présence divine. Cette évolution constituerait « le moteur secret de l’investissement dans le monde et de l’installation dans l’espace » qui s’épanouira dans le projet moderne d’épuisement du réel par la science et les techniques.
« La “révolution papale” opère la rencontre de la matrice chrétienne et de l’héritage juridique romain, et nous a offert deux produits dérivés : l’État et l’entreprise » – Pierre Musso, philosophe
Cet univers mental né durant l’ère carolingienne est le préalable à des évolutions majeures qui fleuriront entre le XIeet le XIIIe siècle. La plus emblématique d’entre elles est connue sous le nom de « révolution papale ». Si ce processus d’affirmation du pouvoir de l’Eglise s’étend sur plusieurs pontificats, son moment crucial intervient sous le règne de Grégoire VII (1015-1085). En 1075, il édicte le Dictatus papae,un ensemble de vingt-sept propositions constituant une affirmation inédite du pouvoir du pape sur un clergé alors morcelé : ce bouleversement juridique et politique est aujourd’hui considéré comme la genèse du concept de souveraineté. « La révolution papale marque le big bang de la vision occidentale, car elle opère la rencontre de la matrice chrétienne et de l’héritage juridique romain, et nous a offert deux produits dérivés : l’Etat et l’entreprise », explique le philosophe Pierre Musso. Soit deux institutions modernes qui, de l’entreprise coloniale à l’actuelle extraction massive des ressources, jouent un rôle-clé dans la domination humaine sur la Terre.
En proposant une vaste généalogie de l’industrie dans La Religion industrielle (Fayard, 2017), Pierre Musso a explicité le lien entre conception religieuse et exploitation du monde. Car cette religion industrielle reposerait sur « le grand mystère de la chrétienté » qu’est l’Incarnation : « Si Dieu est devenu un homme, l’homme est aussi un dieu : comment doit-il poursuivre le travail de création divin ici-bas ? »
Dans son étude, Pierre Musso identifie trois bifurcations majeures. Il y a d’abord celle, fondatrice, de la révolution papale, qui va s’institutionnaliser dans les monastères des XIIe et XIIIe siècles ; puis la naissance de la science moderne à partir de 1600, associée à « un programme rationnel de domination de la nature », d’où naît la manufacture ; enfin, à partir du XIXe siècle, la formulation d’une religion industrielle comme « foi dans le progrès technoscientifique »,dont émane l’usine, et qui se caractérise par le culte des machines.
« La critique du ciel a bouleversé la Terre »
Monastère, manufacture, usine : les racines généalogiques identifiées par Pierre Musso convergent donc avec la thèse de Lynn White. Mais ce professeur honoraire en communication à l’université Rennes-II récuse pourtant l’approche du médiéviste américain : « Il faut lier la crise écologique à la rencontre de l’industrie, de la science et des techniques, qui intervient seulement vers 1800. » Et donc pas avant, car ce serait plaquer notre perception actuelle de la nature sur une époque où celle-ci n’était qu’une « idée vague », comme la définissait encore l’Encyclopédie au XVIIIe siècle.
Dans Par-delà nature et culture (2005), Philippe Descola date d’ailleurs le naturalisme, qui se caractérise par une coupure entre l’homme et son environnement, de l’émergence de la modernité occidentale. Mais l’anthropologue attribue, lui aussi, au christianisme ce « grand partage » : pour que cette conception inédite émerge, « il fallait que les humains deviennent extérieurs et supérieurs à la nature », et c’est au christianisme que l’on doit ce « bouleversement, avec sa double idée d’une transcendance de l’homme et d’un Univers tiré du néant par la volonté divine ».
Le Moyen Age a ainsi, écrit Philippe Descola, réuni « toutes les pièces du dispositif » pour donner naissance à la conception naturaliste. Demeure un paradoxe : cette réduction à une vision mécanique émerge avec la modernité, qui marque pourtant le déclin du christianisme dans nos sociétés. Comment penser ces derniers siècles fécondés par la matrice chrétienne et qui ont pourtant coïncidé avec un recul du christianisme ?
Le jeune philosophe Mohamad Amer Meziane a récemment proposé une thèse stimulante et iconoclaste dans Des empires sous la terre (La Découverte, 352 pages, 22 euros). Selon cet enseignant à l’université Columbia de New York, l’Occident est travaillé par un impérialisme initialement exprimé par le christianisme, en particulier avec la révolution papale. La sécularisation moderne ne constitue pas la mortdu christianisme, mais opère un transfert de cette souveraineté religieuse en mission terrestre, avec l’entreprise coloniale et l’exploitation massive de la Terre. « La critique du ciel a bouleversé la Terre », résume Mohamad Amer Meziane – qui nomme « sécularocène » cette mise en œuvre concrète d’un impérialisme consistant à « réaliser le christianisme sur la Terre ».
Approche rationnelle de la théologie
Ainsi le médiéviste Sylvain Piron récuse tout anachronisme de Lynn White : « Le problème, quand on commence au XIXe siècle, c’est de ne pas comprendre pourquoi tout démarre là. » Une intuition a décidé de la carrière de cet historien, qui s’est plongé dans l’étude du Moyen Age par « traumatisme »face au déferlement du néolibéralisme dans les années 1980 : ce directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales est convaincu qu’il existe une dynamique profonde qui relie tout le deuxième millénaire de l’Occident. Avec L’Occupation du monde et Généalogie de la morale économique (Zones sensibles, 2018 et 2020), il consacre actuellement son œuvre à dégager l’« impensé théologique »qui façonne, selon lui, notre rationalité économique responsable de la destruction de la planète.
« Les principaux dogmes de la théologie économique contemporaine ne sont que des reformulations de propositions doctrinales énoncées au cours de l’histoire chrétienne » – Sylvain Piron, médiéviste
Cette rationalité trouve son « noyau initial » au XIIIe siècle avec les scolastiques qui, avec saint Thomas d’Aquin et revendiquant l’héritage d’Aristote, mettent en avant une approche rationnelle de la théologie. Ils occupent les universités naissantes et vont définir, pour la première fois, toutes les grandes notions au cœur de notre économie contemporaine, comme « risque », « valeur » ou « capital ».
Plus largement, ce moment correspond, selon Sylvain Piron, à la genèse de mentalités qui résonnent avec l’actuel« épanouissement sans frein de l’idéologie néolibérale » : rapports sociaux fondés sur des choix rationnels, certitude que les humains sont guidés par l’égoïsme du fait du péché originel, croyance en une providentielle « main invisible »pour réguler l’ensemble des décisions individuelles, ou encore obsession du travail comme « seule activité sociale valide ». L’historien perçoit ainsi une « ligne directe » entre les cadres contemporains drogués au travail et les moines égyptiens du IVe siècle tressant jour et nuit des nattes en attendant le retour du Messie.
Formulation de l’idéologie propriétaire
« Les principaux dogmes de la théologie économique contemporaine ne sont que des reformulations, sous d’autres habits, de propositions doctrinales énoncées au cours de l’histoire chrétienne », récapitule Sylvain Piron. D’autant qu’à cette généalogie de la morale économique s’en ajoute une autre, juridique : la conception libérale de la propriété privée, qui permet l’appropriation du monde.
Dans son Second Traité du gouvernement civil (1690), le philosophe anglais John Locke (1632-1704) offre la première« formulation pure » de l’idéologie propriétaire, explique le philosophe Pierre Crétois : « Cette conception est celle d’un absolutisme propriétaire, qui consiste à pouvoir faire ce qu’on veut avec ce qui nous appartient. » Cette approche, qui fonde le droit moderne, est doublement problématique, puisqu’elle conduit à une privatisation des ressources tout en niant les dégâts causés par l’usage d’un bien, comme les pollutions.
L’approche de John Locke trouve, elle aussi, sa justification dans une lecture de la Genèse. Le péché originel conduit l’homme à devoir travailler à la sueur de son front. Alors,« l’être humain ne vit plus dans une situation d’abondance qui lui permet de vivre sans travailler, mais doit au contraire travailler pour vivre », explique Pierre Crétois, auteur de La Part commune. Critique de la propriété privée (Amsterdam-Multitudes, 2020), essai dans lequel il défend une proposition de « copossession » du monde.
Pour Locke, c’est donc le travail qui offre un droit naturel à s’approprier les choses. Avec ce « lien puissant entre travail et appropriation », le philosophe critique ainsi les Amérindiens, qui ne produisent pas et négligent donc une nature confiée par Dieu : cela justifie de les déloger d’un territoire qu’ils sont inaptes à faire fructifier. Ainsi, des croisades à la colonisation, la pulsion impérialiste de l’Occident se réalise dans une « occupation du monde » diagnostiquée par Sylvain Piron comme la matrice d’une appropriation des terres puis de leur exploitation économique.
« Laudato si » et l’écologie intégrale
Fallait-il un pape venant de l’hémisphère Sud pour briser cet héritage millénaire ? Avec Laudato si, l’actuel pontife, natif de Buenos Aires, « rompt avec toute la mue ontologique entamée par la chrétienté médiévale », affirme Dominique Bourg. Cette encyclique, parue deux ans après l’élection de François, dote l’Eglise d’une doctrine nouvelle, l’écologie intégrale, et appelle les fidèles à une « conversion écologique ». Sa portée révolutionnaire se résume en une formule, répétée une dizaine de fois : « Tout est lié. »
Cette nouvelle approche s’appuie sur une lecture renouvelée de la Genèse : François condamne l’interprétation « despotique » au profit d’une autre, dite « de l’intendance »,selon laquelle l’homme n’est pas là pour maîtriser la nature, mais pour prendre soin d’un jardin qui lui a été confié. Elle se justifie par d’autres versets, selon lesquels Dieu a modelé« l’homme avec la poussière du sol » et l’a placé dans le jardin d’Eden « pour qu’il le travaille et le garde ». Surtout, le verset « Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon »change la perspective : toute la Création est bonne en soi, et mérite donc un égard pour elle-même.
« Laudato si est la meilleure réponse donnée à Lynn White », soutient Dominique Bourg. Bruno Latour, lui-même de confession catholique, a reçu l’encyclique avec un enthousiasme débordant : le philosophe, figure mondiale de la pensée écologique, la qualifie d’« innovation prophétique »par la façon dont elle lie la question écologique et la question sociale. « En associant le cri des pauvres au cri de la Terre, le pape François ne se contente pas de suivre la mode de l’anthropocène, il en détourne le concept en le rattachant à la longue histoire de l’Eglise prenant parti pour les pauvres », se réjouissait-il dans la revue Recherches de science religieuseen 2019, lui qui reprochait au christianisme occidental d’avoir jusque-là « largement délaiss[é] la question de la matière »pour se réfugier dans la seule sphère du spirituel.
L’élan donné par Laudato si se traduit aussi par une impulsion théologique inédite. Haut lieu français de la réflexion chrétienne, le Collège des bernardins a lancé, en 2020, en collaboration avec Bruno Latour, la chaire « Laudato si. Pour une nouvelle exploration de la Terre ». Ses travaux s’étaleront jusqu’en 2023 autour de cycles transdisciplinaires, où interviennent certains des plus prestigieux intellectuels. Le directeur du pôle de recherche du Collège, Olric de Gélis, a lui aussi reçu l’encyclique comme un choc : « La conjonction entre souci écologique et social a ébranlé mon cœur de chrétien. »
L’intendance proposée par François est, pour ce théologien, la « clé de voûte d’un nouveau mode d’être » : elle invite à une charité encore plus intense à l’égard des humains, une gratitude à l’égard de toute la Création et, enfin, une action de grâce renouvelée à Dieu pour ces trésors. Car, considère Olric de Gélis, « la question écologique pose, au fond, celle de savoir si Dieu peut habiter le monde ». Libérateur, le geste théologique de François ouvre les chrétiens à un nouveau regard sur notre temps. Un temps bouleversé par une catastrophe écologique qui met en cause jusqu’à l’architecture millénaire qui tenait la civilisation occidentale.

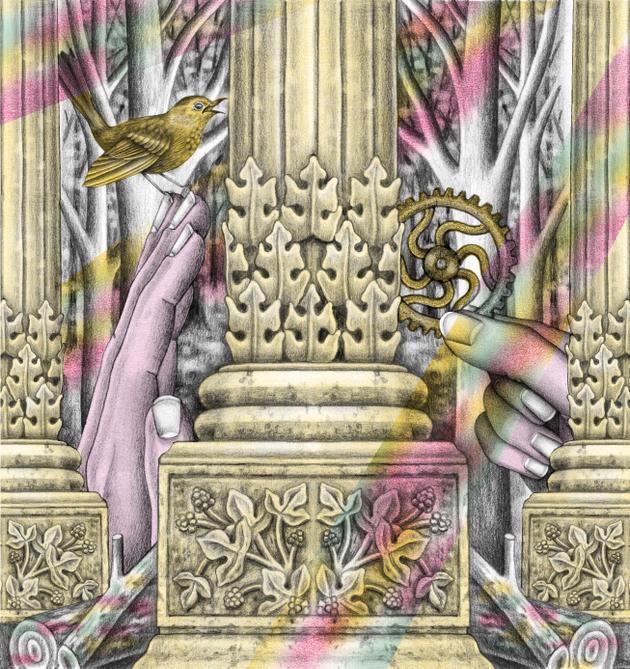

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire