Par Corine Lesnes Publié le 9 mars 2023
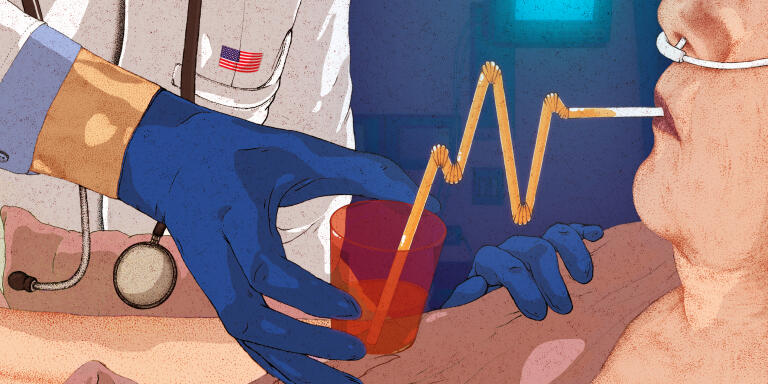
REPORTAGE Le suicide médicalement assisté est pratiqué depuis plus de vingt-cinq ans dans cet Etat, le premier à avoir légalisé la « mort dans la dignité » aux Etats-Unis, où la pratique reste encore marginale dans le pays.
La Willamette scintille sous l’éclaircie matinale, mais le docteur Blanke ne songe pas à admirer la rivière emblématique de Portland (Oregon). Oncologue, spécialiste du pancréas, le professeur Charles Blanke est un praticien reconnu. Il préside le SWOG Cancer Research Network, un réseau de chercheurs fort de 12 000 membres dans 47 Etats américains. En 2015, il a escaladé le Kilimandjaro avec un confrère, afin de lever des fonds pour améliorer la détection précoce de ce cancer particulièrement meurtrier.
Au fil des années, à force de traiter des patients au pronostic désespéré, le docteur Blanke est devenu spécialiste de l’aide médicale à la mort. Chaque année, il rédige plus de prescriptions létales que tout autre médecin de l’Oregon : 60 en 2022, 70 l’année précédente, soit environ 20 % des ordonnances qui permettent aux malades en phase terminale de s’éteindre au moment de leur choix. L’Oregon a été le premier Etat américain à légaliser la « mort dans la dignité », selon l’intitulé de la loi entrée en vigueur le 27 octobre 1997.
Son téléphone le réclame, mais l’oncologue ignore les sollicitations. Installé à la cafétéria de l’Oregon Health & Sciences University, il entend prendre « le temps qu’il faut » pour expliquer pourquoi l’aide médicale à mourir lui tient autant à cœur. Charles Blanke n’utilise pas le terme de « suicide assisté », une expression qui n’est plus employée que par ceux qui s’y opposent. Il n’est pas question de suicide, souligne-t-il, les patients ne demandent qu’à vivre. La loi le stipule d’ailleurs expressément. En aucun cas, les actions du malade, de sa famille ou de ses médecins ne pourront être considérées comme « suicide, suicide assisté, meurtre par compassion ou homicide », précise-t-elle. Nul protagoniste ne pourra être poursuivi et les compagnies d’assurances ne pourront pas refuser d’honorer les contrats conclus. Pour les mêmes raisons, le mot « suicide » ne figure pas non plus sur les certificats de décès. La mort est attribuée à la maladie qui a emporté le patient.
Ce 1er mars, le docteur Blanke revient d’une intervention difficile, illustration des contorsions douloureuses parfois imposées par la loi. A l’été 2022, il a été saisi d’une demande d’aide à mourir par une jeune femme d’une quarantaine d’années, atteinte de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Cette pathologie prive progressivement l’individu de ses capacités motrices, jusqu’à la suffocation. A terme, il est complètement dépendant des autres. Or, la loi Death With Dignity requiert que le patient soit en mesure de s’administrer lui-même la substance létale, sans assistance et par « ingestion » : aucune intraveineuse n’est autorisée. En janvier, la patiente ne communiquait plus qu’en remuant les pieds. Quand le médecin a rédigé la prescription, elle ne pouvait plus avaler et elle approchait du seuil de paralysie qui l’empêcherait d’ingérer seule la substance létale. « Avec la famille, on a dû déterminer dans quelle partie du corps elle avait encore assez de force pour pousser le piston de la seringue », relate-t-il.
L’oncologue a établi qu’elle pouvait encore mobiliser ses adducteurs. Une seringue a été fixée à l’intérieur de sa jambe et reliée à la sonde d’alimentation. Un processus éprouvant pour la famille, qui a dû soutenir le tube tout en évitant de contrevenir à la législation interdisant toute assistance finale. Après les adieux à la sœur dont elle était si proche, la jeune femme s’est éteinte en moins de trente minutes. Selon le médecin, elle avait probablement encore quelques semaines à vivre. Comme elle, les patients sont souvent obligés d’abréger le peu de temps qui leur reste, de peur de ne plus avoir assez de force ou d’acuité mentale pour satisfaire aux critères de la loi. Choisir une date est un crève-cœur. « Je refais le point vingt fois avec eux si nécessaire », précise le médecin
« Il ne souffre pas »
Le téléphone se fait insistant. Le docteur Blanke est sollicité pour un autre patient – l’un des cinq à huit qu’il reçoit par semaine –, qui a demandé à avancer l’heure de sa mort. Le requérant est l’un de ceux qui espèrent profiter de l’assouplissement de la loi Death With Dignity, intervenu en 2022. « Il n’est plus nécessaire d’être résident de l’Oregon,expose le médecin. Mon travail est devenu encore plus compliqué. » La modification a fait suite à la plainte d’un médecin de Portland, appuyé par l’association de défense de l’aide à mourir Compassion and Choices. Le praticien jugeait anticonstitutionnel de ne pas pouvoir prescrire l’ordonnance à ceux de ses patients qui habitent de l’autre côté de la rivière Columbia, à quelques kilomètres mais dans l’Etat de Washington. En mars 2022, l’autorité de la santé publique et l’ordre des médecins ont accepté un règlement à l’amiable et annoncé l’abandon des poursuites contre les praticiens qui prescriraient des ordonnances à des non-résidents.
L’Oregon est devenu le premier Etat à donner un accès sans restriction géographique à l’aide médicale à mourir. Depuis, le docteur Blanke est sollicité chaque mois par plusieurs malades venus du reste du pays. Beaucoup sont désemparés, à la recherche d’un endroit où abriter leurs derniers moments. Après quelques incidents dans des hôtels et résidences Airbnb, le médecin a pris les choses en main et passé une annonce. Plusieurs volontaires ont proposé de servir de point de chute aux familles.
Longtemps, le docteur Blanke s’est abstenu d’assister à la cérémonie finale. Il pensait que les familles souhaitaient rester dans l’intimité. Depuis qu’il leur demande leur avis, « 100 % d’entre elles souhaitent [sa] présence », rapporte-t-il. Quand les proches du patient préfèrent éviter la responsabilité de contribuer à sa disparition, il prépare le flacon. Après l’ingestion, il les rassure. « Oui, il bleuit, mais il ne souffre pas, il est inconscient. » Sur 300 cas, il ne se souvient que d’un exemple où le malade était seul – un homme qui s’était disputé avec son fils. A l’autre extrême, il a croisé « toute une famille, 19 personnes, chantant Kumbaya avec des ukulélés ».
Vertus psychologiques
« Chaque mort est une expérience profonde, souligne-t-il. C’est quelque chose d’irrévocable, mais je sais que c’est ce que le malade désire. Et neuf fois sur dix, au-delà de la tristesse, c’est ce que la famille désire aussi. » Le serment d’Hippocrate, souvent invoqué par le corps médical pour sa fameuse recommandation – qui en fait n’y figure pas littéralement – de ne pas faire de « mal » ne lui paraît pas incompatible avec sa vocation de soignant. « Fournir aux patients un médicament destiné à mettre fin à la vie n’est pas causer du mal, estime-t-il. C’est un geste qui leur offre ce qu’ils veulent par-dessus tout : le contrôle sur une vie devenue très désagréable. » Même protégé par le jargon médical, il est des fins de vie « désagréables » sur lesquelles le docteur Blanke préfère ne pas s’appesantir. L’un de ses patients, atteint d’un cancer du pancréas, vomissait le contenu de son intestin toutes les dix minutes. Les soins palliatifs n’y faisaient rien. « Son seul recours, c’était la loi Death With Dignity, se souvient le médecin. Mais il fallait attendre quinze jours. Il est mort avant. »
Cette loi a aujourd’hui un quart de siècle. Approuvée par les électeurs en 1994 (51 % contre 49 %), confirmée en 1997, passée sous les fourches Caudines de la Cour suprême en 2006, elle autorise les médecins à prescrire une substance létale aux adultes en possession de leurs capacités mentales, n’ayant plus que six mois à vivre selon l’avis de deux praticiens et capables d’« ingérer » eux-mêmes le produit. Les requérants doivent formuler deux demandes à quinze jours d’intervalle (l’une écrite, contresignée par deux témoins, l’autre orale). Ils doivent être informés des autres possibilités. Aucun médecin n’est tenu de répondre à leur demande. Les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, qui détruisent mémoire et réflexion, sont exclues d’office de la législation.
Le premier patient, fin 1998, fut Ray Frank, un homme de 56 ans atteint d’un cancer du rein et du poumon. Il avait demandé à sa femme de lui apporter son fusil à l’hôpital. Depuis, 3 280 malades ont reçu une ordonnance létale (24 la première année, 383 en 2021). Parmi eux, 2 159 sont morts après l’ingestion, soit 66 % (218 en 2021, soit 57 %). En moyenne, un tiers des bénéficiaires n’utilisent pas le médicament. Explication souvent avancée : les malades changent d’avis ou de situation. Le simple fait de posséder l’ordonnance aurait des vertus psychologiques. « Cela leur donne le contrôle qu’ils n’ont pas sur la maladie », pense le docteur Blanke. L’oncologue se souvient d’un patient qui conservait son flacon dans un tiroir à chaussettes et le sortait régulièrement. « Comme un pistolet chargé. Il le regardait et disait : “Pas aujourd’hui, mais je pourrais.” »
L’Oregon, au bord du Pacifique Nord, ne compte que 4,2 millions d’habitants. Il n’a dû qu’à un concours de circonstances de devenir le « laboratoire » du suicide assisté, selon l’expression de l’une des rédactrices de la loi, Barbara Coombs Lee, une ancienne infirmière urgentiste devenue juriste pour les besoins de la cause. L’opinion avait été émue par le sort d’un enfant qui s’était vu refuser une transplantation de moelle osseuse. L’assurance médicale jugeait trop minimes ses chances de survie. L’affaire avait entraîné un débat de société sur les choix collectifs en matière de santé. L’amélioration des conditions de fin de vie était apparue comme une priorité des citoyens.
Débat inchangé
« Deux référendums avaient échoué en Californie et dans l’Etat de Washington en 1991 et 1992. Nous voulions une loi qui ait des chances d’être adoptée », explique Mme Lee, l’une des fondatrices de l’association Compassion and Choices.Le texte a été l’aboutissement d’un compromis. Contrairement à l’exemple canadien, il n’est pas question d’euthanasie. « Il n’y a rien d’extrême ni d’un côté ni de l’autre, mais un équilibre entre suffisamment de garde-fous pour empêcher les abus, pas au point toutefois d’empêcher l’accès », détaille la militante, qui reste opposée à l’idée de donner à qui que ce soit, hormis le patient lui-même, le pouvoir d’administrer la mort.
Neuf autres Etats et la capitale fédérale ont suivi l’Oregon : Washington et le Montana (2009), le Vermont (2013), la Californie et le Colorado (2016), le District of Columbia (2017), Hawaï (2018), le Maine et le New Jersey (2019) et le Nouveau-Mexique (2021), représentant quelque 22 % de la population américaine. Les textes sont largement similaires, à quelques variantes près : Hawaï, par exemple, impose une évaluation psychologique des requérants, laissée ailleurs à la discrétion du médecin. Des projets de loi sont à l’examen dans 14 Etats. Si les républicains restent majoritairement opposés au suicide assisté, plusieurs Etats démocrates, comme l’Etat de New York ou le Massachusetts, où le poids de l’Eglise catholique est important, l’ont également rejeté.
A trente ans d’intervalle, le débat éthique se déroule sur les mêmes lignes, avec les Eglises en fer de lance de l’opposition, ainsi que le mouvement antiavortement et les associations de défense des handicapés. Dans les Etats ayant légalisé la« mort dans la dignité », les praticiens estiment que la question morale a été tranchée. « Le bateau a quitté le port, selon l’expression de Lonny Shavelson, le fondateur de la toute nouvelle American Clinicians Academy on Medical Aid in Dying (Acamaid). Les électeurs se sont prononcés. Nous, nous devons répondre aux patients qui demandent à bénéficier de la loi. »
Pendant dix ans, le « modèle » orégonien n’a pratiquement pas évolué. « Toute l’attention se portait sur l’aspect légal. Personne n’avait d’expérience clinique », dit le docteur Shavelson. Le produit employé était le Séconal, un sédatif de la famille des barbituriques. Le processus était empirique, et la mise en place parfois erratique : sept patients ont repris conscience après avoir ingéré le médicament. En moyenne, il fallait vingt-cinq minutes à une personne pour mourir, mais en 2009 un décès a pris cent quatre heures. Le produit était livré sous la forme de 100 gélules, qu’il fallait ouvrir une à une pour vider la poudre. « Je pouvais faire ça en quarante-cinq minutes, parce que j’ai l’habitude, raconte le docteur Blanke, mais un patient atteint de neuropathie n’y arrivait pas. La famille pouvait l’aider, mais n’était-ce pas outrepasser l’obligation d’autoadministration ? Au début, ça n’était pas entièrement clair. »
Nouveau protocole
Aucune recherche n’avait été entreprise dans les universités ou les hôpitaux, même privés, sur un sujet aussi controversé ; aucun journal médical ne se serait risqué à publier des études. Le tournant « clinique » n’a été pris que lorsque la Californie, l’Etat le plus peuplé du pays, a adopté à son tour un texte sur « les options de fin de vie ».
Le jour de l’entrée en vigueur de la loi, le 9 juin 2016, le docteur Lonny Shavelson a ouvert une clinique spécialisée à Berkeley, la première du pays. Le médecin avait été urgentiste pendant vingt-neuf ans. Au moment de l’épidémie de VIH, il avait été sensibilisé, à San Francisco, aux suicides des malades, parfois facilités par des amis ou des praticiens. Il les avait relatés dans un livre intitulé A Chosen Death (« une mort choisie », University of California Press, 1995, non traduit). D’entrée, il a saisi l’ordre des médecins de Californie pour obtenir une définition précise du terme « ingérer ». Le conseil l’a élargie à la voie gastro-intestinale. « Cela a permis d’accepter toute une nouvelle catégorie de patients, dit le praticien. Ceux qui ne réussissaient plus à avaler. » Trois voies sont désormais autorisées : orale, rectale et par sonde intestinale, mais le malade reste le seul à pouvoir activer le processus.
Avec sa consœur Carol Parrot, une anesthésiste de l’université de Washington, le docteur Shavelson s’est lancé dans une enquête clinique hors des sentiers traditionnels de la recherche. Objectif : « Comprendre comment arrêter le cœur des patients, confortablement, et au moment de leur choix. » Et aussi : « Pourquoi c’est si compliqué. » Muni d’un oxymètre et d’un électrocardiographe portatif, le praticien a assisté, en quatre ans, à la mort de 250 personnes. Il a consigné les dosages, les produits, mesuré les respirations, les rythmes cardiaques, inversé l’ordre des substances. Il en a conclu que commencer par ralentir le cœur n’était pas la meilleure approche, et qu’il pouvait être plus efficace de l’accélérer. Le résultat est un cocktail de cinq substances (DDMAPh : diazépam, digoxine, sulfate de morphine, amitriptyline et phénobarbital).
Le nouveau protocole s’est généralisé, d’autant que le Séconal est devenu indisponible, tout comme le pentobarbital, dont les fabriquants européens ont bloqué l’exportation pour empêcher son utilisation dans les exécutions capitales. « Le mélange arrive maintenant tout préparé dans un flacon de verre, précise le docteur Blanke. La famille verse 2 onces [environ 60 millilitres] de jus de pomme dans la bouteille. Il faut mélanger énergiquement : c’est une poudre qui se dissout difficilement. Je vérifie trois fois que le couvercle est bien mis : il ne faut pas risquer qu’il s’envole et perdre le produit. Dès que possible, on verse le liquide dans un verre. Le patient doit boire rapidement, avant que la poudre retombe au fond. Une fois qu’il commence, il faut qu’il consomme les 2 onces en deux minutes, sinon il court le risque de s’endormir sans avoir ingéré la dose létale. »
En 2020, l’Acamaid a tenu sa première conférence à Berkeley, avec 300 participants. La deuxième, les 17 et 18 février à Portland, organisée en coopération avec l’association Death With Dignity, a rassemblé 480 médecins et personnels de santé. Lonny Shavelson et ses collègues entendent faire de l’aide médicale à la mort un élément à part entière du domaine des soins palliatifs. « Un domaine émergent de la médecine », se félicite Peg Sandeen, la directrice de Death With Dignity.
« Aussi rapide qu’Amazon »
L’académie a entrepris de propager les meilleures pratiques, d’informer les médecins qui, s’ils ne sont pas enclins à participer, devraient au moins adresser leurs patients aux spécialistes, estime le docteur Shavelson. Elle forme des « death doulas », les « doulas de fin de vie », un corps de métier apparu récemment et en pleine expansion. « La loi nous considère comme de simples rédacteurs d’ordonnance. Mais il s’agit de médecine et de soins », répète Lonny Shavelson. L’académie encourage la présence de cliniciens auprès des mourants. Dans l’Oregon, en 2021, la moitié des ingestions ont eu lieu en présence de personnel soignant (pour 31 %) ou d’accompagnant. Au Nouveau-Mexique, la proportion est de 98 %.
Selon le praticien, le rôle du médecin est d’éduquer, de rassurer. Il faut arrêter d’effrayer les patients, admoneste-t-il. « Les gens pensent que mourir est un processus misérable, douloureux. Généralement, ça n’est pas le cas. » Cette patiente atteinte d’une leucémie, par exemple : elle craignait de mourir dans des souffrances insupportables, alors que cette forme de cancer du sang conduit plutôt à un affaiblissement général. « Je lui ai dit qu’on referait le point tous les mois, puis toutes les semaines. Finalement, elle n’a pas eu recours à l’aide à la mort. Elle s’est éteinte confortablement en soins palliatifs. » L’épuisement est l’une des causes méconnues du souhait d’en finir, souligne-t-il. « La médecine actuelle arrive à soulager les souffrances. Ce qu’elle n’arrive pas à alléger, c’est ce processus lent et inexorable de fatigue extrême qui mine les patients. »
Le docteur Shavelson ne s’étonne pas du pourcentage élevé de bénéficiaires qui n’utilisent pas la prescription. Selon lui, les médecins « prescrivaient trop tôt », dès qu’ils avaient établi que les patients remplissaient les conditions légales. « On finissait par avoir des gens qui conservaient des doses énormes de morphine à la maison. » L’académie préconise aux praticiens d’attendre que le patient soit en toute fin de vie. « On est en janvier, le patient va peut-être mourir en juin, poursuit le fondateur du groupe. Il aura besoin d’une prescription différente. Sa tolérance aux opiacés peut avoir évolué, ou son appareil digestif. » A ceux qui craignent les pénuries, le docteur Shavelson assure que le médicament est disponible en pharmacie dès la prescription remplie. Quant à la livraison, « on est aussi rapide qu’Amazon ».
L’aide médicale à mourir reste marginale aux Etats-Unis. Entre 1998 et 2020, elle n’a concerné que 5 329 patients, selon une compilation de la chercheuse Elissa Kozlov publiée par la revue Journal of American Geriatrics en juin 2022. Contrairement aux craintes des opposants, les populations les plus vulnérables ne sont pas particulièrement représentées. Au contraire, ce recours semble être plutôt l’apanage des classes aisées. D’après la même étude, les patients sont très majoritairement blancs (95 %) et diplômés d’études supérieures (72 %). Dans l’Oregon, un seul Afro-Américain a bénéficié de la loi Death With Dignity en vingt-cinq ans (sur 2 159 cas), ainsi que 32 Asiatiques et 28 Hispaniques, reflet des inégalités du système de santé américain. « Les Noirs reçoivent leurs diagnostics plus tard que les autres catégories de population. Et ils sont moins susceptibles d’avoir accès aux soins palliatifs, explique Peg Sandeen. Il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas le même accès à l’accompagnement de fin de vie. »
Loin des polémiques et des idées préconçues, les médecins qui prônent le droit à mourir se veulent pragmatiques. « Nous faisons partie de l’équipe de praticiens spécialisés dans la fin de vie. Notre but, c’est de donner le choix aux malades », explique Lonny Shavelson. Dès la première consultation, il dédramatise. « Voilà ce que je dis aux patients : mourir s’est tellement amélioré qu’il y a peu de chance que vous ayez besoin de l’aide médicale à la mort. Mais si c’était le cas, si un jour vous en aviez besoin, ou si vous souhaitiez en bénéficier, alors nous serons là pour vous. »
Après Bruxelles, Madrid et plusieurs autres capitales européennes, la ministre déléguée auprès du ministre de la santé, Agnès Firmin Le Bodo, a entrepris, le 10 mars, un voyage de trois jours dans l’Oregon, Etat pionnier pour l’aide médicale à mourir aux Etats-Unis. A Portland, elle a prévu de rencontrer les responsables de la santé publique et des associations, dans le cadre de la concertation sur la fin de vie qu’elle mène avec les soignants et les parlementaires, alors que s’intensifie le débat français en prélude à une probable nouvelle législation sur le sujet.
L’Oregon a été le premier à mettre en œuvre, fin 1997, une législation autorisant « la mort dans la dignité ». Selon le département de la santé publique, 383 personnes y ont reçu en 2021 une ordonnance médicale leur permettant d’obtenir un médicament entraînant la mort. Parmi elles, 219 (57 %) ont ingéré le cocktail létal : 218 sont mortes et une a repris conscience (pour mourir ultérieurement). 58 autres patients (15 %) n’ont pas pris le médicament et ont succombé à d’autres phénomènes. Le statut de 106 patients (dont 37 décédés) est resté inconnu. 133 médecins ont rédigé des prescriptions (contre 14 en 1998).
Depuis 1998, le profil des requérants a peu varié. Les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes. En 2021, 81 % étaient âgés de plus de 65 ans. 95 % des malades étaient des Blancs, 46 % diplômés d’études supérieures. Le diagnostic le plus courant est celui de cancer (61 %) ; puis ce sont les maladies neurologiques (15 %). La quasi-totalité des patients (95 %) sont morts chez eux – les hôpitaux n’acceptent pas que l’ingestion se déroule dans leurs locaux – et 98 % étaient en soins palliatifs.
Pour justifier leur décision, l’immense majorité des patients ont invoqué la perte d’autonomie (93 %), l’impossibilité croissante de participer à des activités qui rendaient leur vie agréable (92 %) et la perte de dignité (68 %). Phénomène qui témoigne des dysfonctionnements du système d’assurance-santé aux Etats-Unis : 8,4 % des requérants ont mis en avant le coût financier du traitement de leur maladie, soit deux fois plus que la moyenne observée entre 1998 et 2019.
Certaines assurances privées couvrent le prix du médicament létal, ainsi que Medicaid – l’assurance des plus pauvres, régie par les Etats. En revanche, il n’est pas remboursé par Medicare – l’assurance des plus de 65 ans, un programme fédéral. Certains praticiens proposent une « formule » comprenant les visites médicales, les formalités et le « cocktail » létal. Le coût peut varier de 500 à 5 000 dollars.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire