Propos recueillis par Marion Dupont Publié le 12 septembre 2022
Dans « La Norme gynécologique », la sociologue Aurore Koechlin s’est penchée sur ce qui apparaît comme un impératif médical, qu’elle met en question après avoir rencontré patientes et soignants. Elle décrit son travail dans un entretien au « Monde ».
La sociologue Aurore Koechlin présente dans son ouvrage La Norme gynécologique (Amsterdam, 320 pages, 20 euros) le résultat de plusieurs années d’enquête auprès de professionnels de santé et de patientes en gynécologie médicale. En chercheuse et en militante féministe, elle y examine les mécanismes du suivi gynécologique et de ses effets.
Qu’est-ce que la « norme gynécologique » ?
Je la définis comme la norme qui enjoint aux femmes de consulter régulièrement un ou une professionnelle de santé pour le suivi gynécologique, centré sur la contraception et le dépistage (frottis, palpation des seins). La particularité de ce suivi est triple : il est régulier – idéalement une fois l’an –, il ne repose pas sur un motif de consultation précis, enfin, il prend pour objet le corps sain tout au long de la vie.
La consultation gynécologique est souvent présentée comme un acte banal, allant de soi. Cette médicalisation prolongée produit pourtant des effets sur les patientes, selon votre analyse ?
La consultation gynécologique est un espace fondamentalement ambigu pour les femmes. Elle rend possible le dépistage de maladies et de cancers potentiellement extrêmement graves. Elle fournit une ressource parfois non négligeable en termes d’informations et de connaissances sur le corps, la contraception, etc. Mais dans le même temps, elle se fait la vectrice de normes sociales peu interrogées.
L’une d’entre elles, la norme préventive (qui implique que tout individu doit se faire dépister quand il a un comportement à risque ou quand il fait partie d’une population à risque) se traduit par une extrême responsabilisation des patientes dans la gestion de leur corps et de leur santé. Elles sont ainsi placées dans un entre-deux entre capacité d’agir sur la santé et maintien du statut de profane, qui est précisément la source d’une angoisse, présente même de façon diffuse, chez une grande partie d’entre elles.
Dans votre livre, vous vous interrogez sur les cas de violences gynécologiques. Le terme même, pourtant, est récent : comment les définir ? Qu’est-ce qui, dans la relation entre la patiente et le praticien, rend leur existence possible ?
Un élément central pour définir les violences gynécologiques est le non-respect du consentement de la patiente aux actes réalisés, en particulier à l’examen gynécologique. Quant aux conditions de possibilité de ces situations (très minoritaires), j’en développe trois dans l’ouvrage : premièrement, la consultation elle-même, qui constitue une habituation à la douleur, qui peut alors être perçue comme normale tant par le ou la professionnelle que par la patiente. Deuxièmement, les conditions de travail, qui, quand elles sont accélérées, renforcent les automatismes des gynécologues et rendent plus difficile l’analyse de la situation. Et enfin, l’universalisme médical, cet idéal de neutralité et de non-jugement qui est au fondement de la définition moderne du médecin. Même s’il part d’une bonne intention, cet universalisme a pour effet paradoxal de vouloir traiter les organes génitaux comme n’importe quel organe. Mais cela va à contre-courant du ressenti d’une partie des patientes, qui disent vivre la consultation comme un moment dont la dimension genrée et potentiellement sexualisée ne peut jamais totalement être effacée.
Ces dernières années, la gynécologie médicale a suscité de nombreuses critiques, notamment féministes. De quoi cette remise en question est-elle le signe ?
Il me semble qu’on ne peut pas comprendre cette crise de la gynécologie médicale sans y voir une mise en question de la norme gynécologique elle-même. Pour les féministes des années 1960-1970, dont l’objectif était la libre disposition des corps, notamment par l’accès à la contraception et à l’avortement, la norme gynécologique a pu sembler sans importance comparée à l’ampleur des avancées. Mais pour une nouvelle génération de féministes pour laquelle la contraception et l’avortement sont des acquis, cette norme est à la fois plus apparente et plus contraignante. La « crise de la pilule » ou des hormones s’inscrit dans ce contexte. Moins que les techniques en elles-mêmes, les patientes interrogent une contraception difficile d’accès, centrée sur la pilule, dont la charge est inégalement répartie au sein du couple hétérosexuel. La promotion d’une contraception « naturelle » peut alors signifier surtout la promotion d’une contraception non médicalisée.
Face à ces critiques, quelles pistes s’offrent à la gynécologie médicale pour se réformer ?
Je crois qu’il faut accepter une part de démédicalisation et de déprofessionnalisation des enjeux gynécologiques, et plus largement, médicaux. Une formation à la médecine dès le lycée, un accès simplifié à certaines techniques, à des traitements à base d’hormones, me semblent être des revendications à la fois efficaces et simples à appliquer. Mais il ne s’agit pas pour autant de délaisser le système médical : réclamer davantage de moyens pour la santé, c’est œuvrer également pour une amélioration de la qualité des soins. Enfin, le dernier point central serait de faire réellement appliquer la notion de « consentement libre et éclairé » des patientes instauré par la loi. L’urgence est souvent invoquée comme un frein à sa mise en place : mais, précisément, la gynécologie médicale a ceci de spécifique qu’elle est centrée sur la prévention et non sur l’urgence. Elle pourrait ainsi montrer la voie à l’ensemble de la médecine, ce qui serait un beau retournement de situation.
C’est un conseil, pour ne pas dire une injonction, répétée par les professionnels, mais aussi par les mères, les sœurs, les amies : la visite de suivi chez le gynécologue doit se faire une fois par an. Mais d’où vient cette évidence ? Pourquoi s’applique-t-elle aux femmes et non aux hommes, et pourquoi aller voir un médecin lorsque tout va bien ? C’est avec ces questions, et l’intention de montrer la construction sociale là où n’est souvent perçu qu’un impératif biologique, que la sociologue et militante féministe Aurore Koechlin est allée observer des consultations gynécologiques au cours de cinq enquêtes de terrain.
Son livre La Norme gynécologique. Ce que la médecine fait au corps des femmes, en partie issu de sa thèse, présente ses conclusions et dissèque ainsi, avec extraits d’entretiens à l’appui, ce qui se joue dans ces moments hautement intimes. L’autrice décrit tout au long de la « carrière gynécologique » (un terme utilisé pour mieux refléter le travail effectué par les patientes pour être suivies) les émotions qui s’y déploient, la négociation qui prend place, les tensions qui peuvent survenir, mais aussi l’impact des inégalités sociales sur la qualité des soins. Autant d’analyses qui éclairent les critiques adressées à cette spécialité, et les transformations déjà en cours.
« La Norme gynécologique. Ce que la médecine fait au corps des femmes », d’Aurore Koechlin (Amsterdam, 320 p).


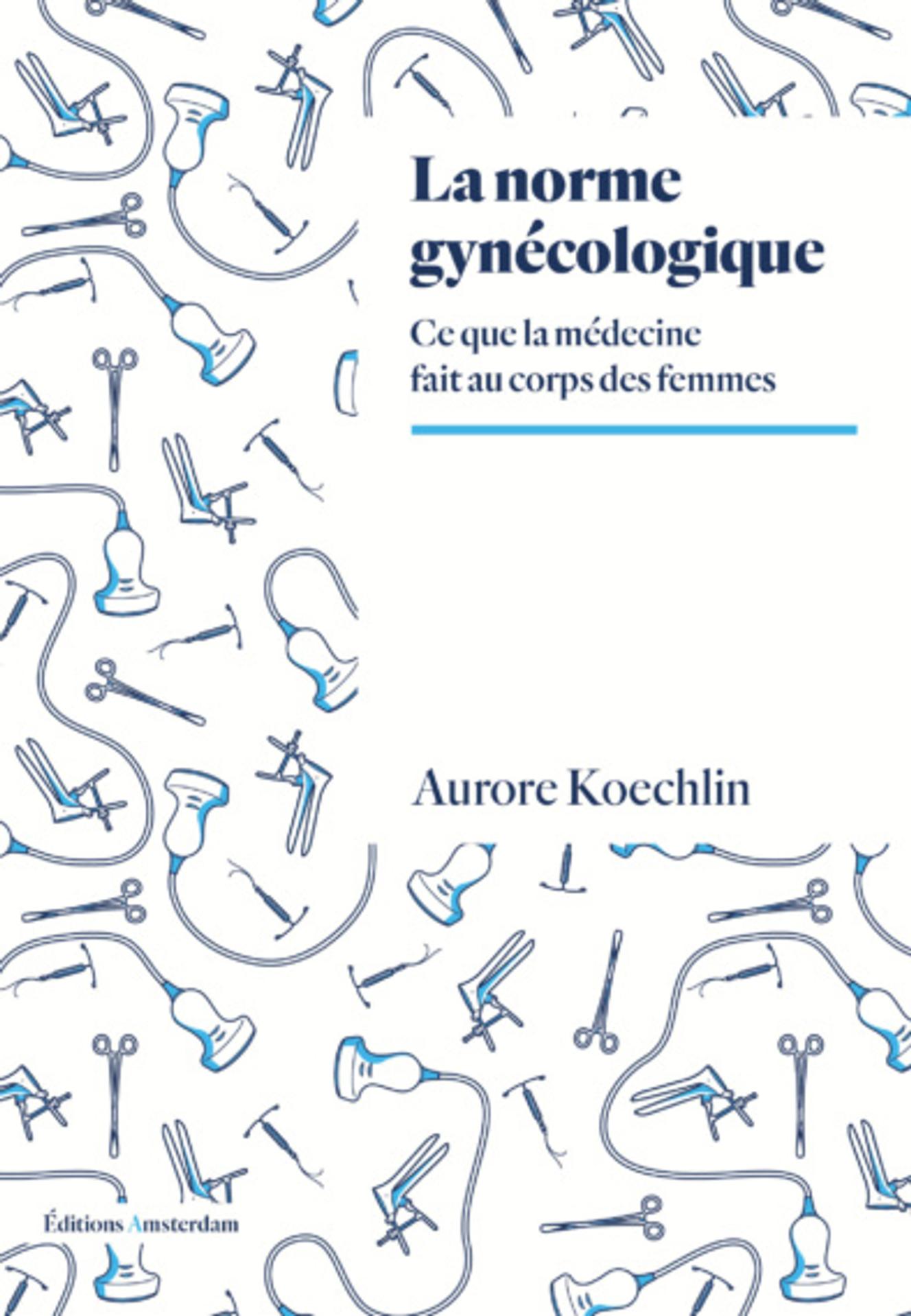

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire