A l’occasion du lancement de l’application « Mémorable » par « Le Monde », enquête sur le fonctionnement de la mémoire. La science donne des pistes pour la nourrir et la préserver, à l’heure où le numérique transforme le rapport aux savoirs.
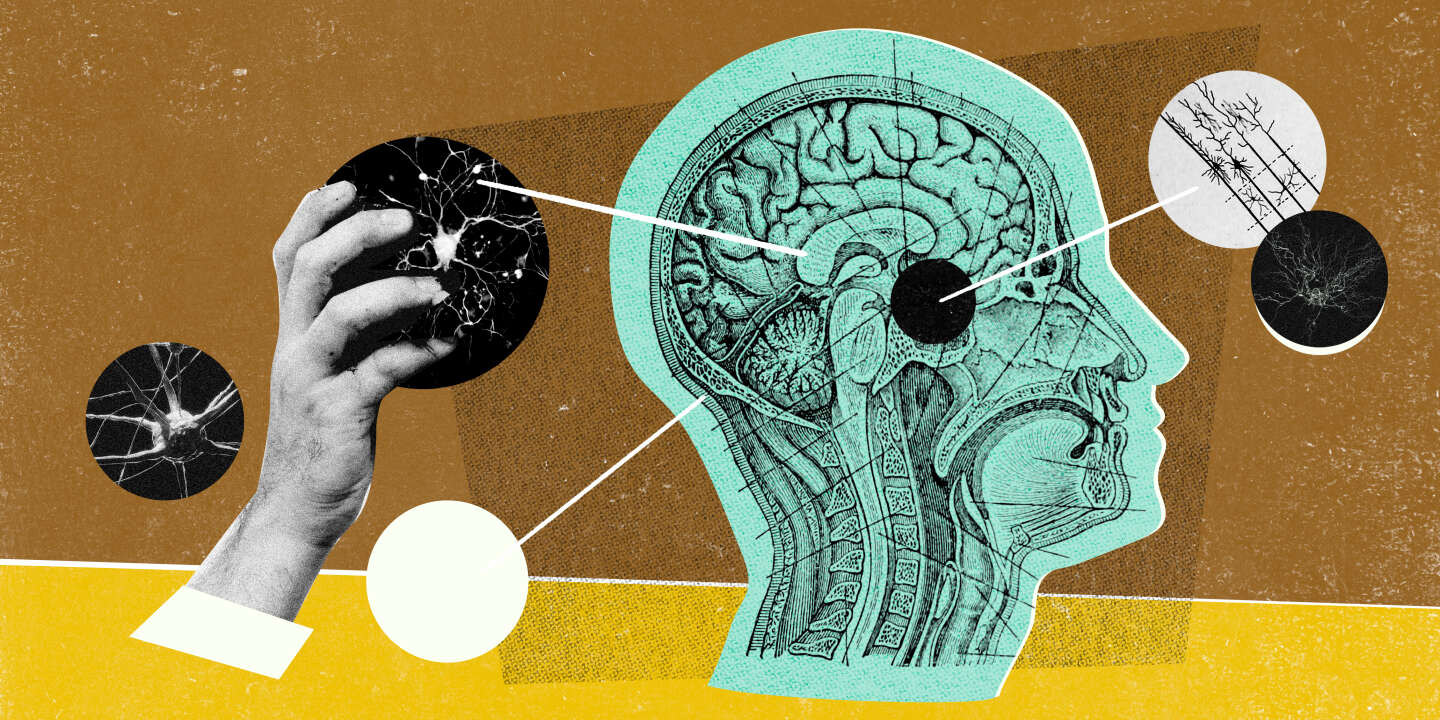
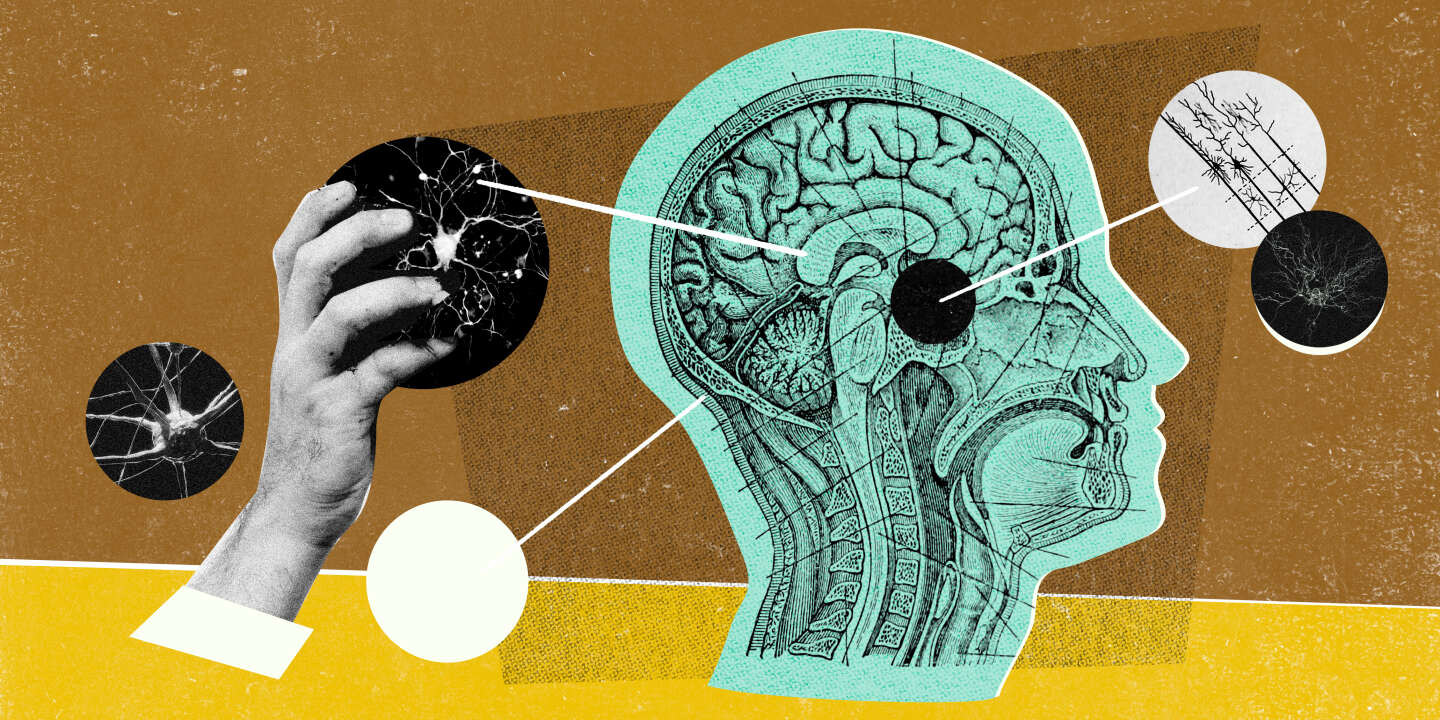
La mémoire est notre identité. Elle nous permet de nous situer dans le temps, mais aussi dans l’espace et les relations sociales, dans notre histoire, celle de nos proches ou de l’humanité tout entière. Sans elle, impossible de se projeter dans l’avenir, de prendre des décisions ou de faire du vélo.
Le bébé qui vient de naître, l’enfant qui grandit, l’adulte qui a mûri, le vieillard qui faiblit… A chaque âge de la vie, la mémoire nous permet d’encoder, de stocker et de récupérer des informations. Mais son fonctionnement change, s’adapte. De 0 à 110 ans, comment façonne-t-elle nos apprentissages ?
Comme des matriochkas
Pour commencer, il faut savoir que la question occupe les philosophes depuis des millénaires, et les scientifiques depuis un siècle et demi. Dans un des essais publiés dans « Les Fondements de la mémoire » (James S. Nairne, 2007) intitulé « Y a-t-il 256 sortes de mémoires ? », le neuropsychologue Endel Tulving, un des plus grands spécialistes de la question, se moquait de l’inflation des propositions au cours des dernières décennies. Il soulignait que certaines des mémoires de sa liste pouvaient s’emboîter les unes dans les autres, comme des matriochkas – la mémoire iconique englobée dans la mémoire sensorielle, la mémoire sémantique incluse dans la mémoire déclarative. « Combien de processus comportementaux ou cognitifs connaissez-vous qui s’incluent eux-mêmes ? », demandait-il à ses estimés collègues.
Manière de dire qu’il conviendrait de revenir à plus de sobriété si l’on souhaitait vraiment expliquer les grands principes du fonctionnement de la mémoire. Le message est passé, même si, comme toujours en neuropsychologie, les particularités de certains patients conduisent à isoler des traits singuliers de la mémoire – par exemple, la prosopagnosie, c’est-à-dire l’incapacité à reconnaître les visages, décrite de très longue date, renvoie sans conteste à un réseau cérébral particulier.
Encoder, stocker et récupérer des informations : chacune de ces phases renvoie à des mécanismes très divers.
Cinq différentes mémoires
Cinq différentes mémoires
S’inspirant de Tulving, qui avait proposé une architecture hiérarchisée de cinq différentes mémoires impliquées dans ces mécanismes, et du Britannique Alan Baddeley, qui a insisté sur le rôle central de la mémoire de travail, le neuropsychologue français Francis Eustache (Inserm, université de Caen, Ecole pratique des hautes études, Observatoire B2V des mémoires) a proposé un modèle plus dynamique, avec sa collègue Béatrice Desgranges.
Ce modèle comprend tout d’abord la mémoire de travail, à court terme. « C’est elle qui nous permet de retenir quelques secondes un numéro de téléphone avant de le noter, ou de suivre notre pensée dans une conversation », illustre Francis Eustache. Elle est au carrefour de toutes les mémoires : les informations qu’elle gère peuvent être oubliées l’instant d’après, ou bien être intégrées à plus long terme, dans la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, par exemple. La première englobe le langage et les connaissances sur le monde et sur soi, la seconde est la médiathèque des événements personnellement vécus, qui nous permettent de nous projeter dans le futur et de nous situer dans le temps et l’espace. Ces mémoires explicites sont distinctes de la mémoire procédurale, inconsciente, celle qui assure notre maîtrise d’un véhicule ou d’un instrument de musique. Ou de la mémoire perceptive, nourrie essentiellement à notre insu par nos sens, dont la mémoire olfactive chère à Marcel Proust, reliée directement aux régions du cortex impliquées dans la mémoire.
Amnésie infantile
Amnésie infantile
Toutes ces mémoires, qui mettent en jeu des régions cérébrales spécifiques, ne sont pas disponibles dès la naissance, et leur rythme de maturation peut varier d’un individu à l’autre. Le nourrisson est capable dès les premiers mois de mémoriser l’emplacement d’un objet, ont montré des études de suivi du regard. Il prononcera bientôt ses premiers mots avant que son vocabulaire ne s’enrichisse de façon exponentielle. Pour autant, une fois adulte, ce qui lui sera arrivé dans les premières années d’existence lui restera opaque. Plusieurs explications sont avancées pour cette amnésie infantile : maturation insuffisante des régions dévolues à la mémoire consciente, plus grande capacité à l’oubli, immaturité du soi…
Publiée en 1997 dans Science, une étude menée à l’University College de Londres portant sur des enfants amnésiques dévoile sans doute une partie de la réponse. « Elle a montré que nous pouvons constituer des connaissances sans passer par la case souvenirs », souligne Francis Eustache, qui a depuis effectué des observations similaires sur de petits patients français. L’étude montrait que des atteintes de l’hippocampe, structure cérébrale très impliquée dans la mémoire, n’avaient pas empêché ces enfants d’apprendre à marcher, à parler et même à lire. Mais vers 6 ou 7 ans, ils se révélaient incapables de se souvenir de leur propre histoire. Leur mémoire épisodique n’était pas capable d’« imprimer » les événements.
Cette étude a marqué un tournant dans l’étude de la mémoire chez l’enfant, en lien avec l’observation du cerveau par différents outils d’imagerie. Il est ainsi apparu que l’hippocampe évolue considérablement entre 4 et 25 ans. Ce n’est que vers 13 ans que la mémoire de travail atteint sa pleine capacité, jonglant en moyenne avec sept éléments distincts ou autant de groupements d’information. Elle peut se subdiviser en sous-catégories : si on doit retenir une liste d’animaux, on peut par exemple s’en rappeler davantage si on les a subdivisés en oiseaux, carnivores, poissons, etc.
Formidable explosion lexicale dès l’enfance
Formidable explosion lexicale dès l’enfance
Chez l’adolescent, la substance blanche, dont la maturation continue pendant les premières décennies de vie, atteint un plateau vers 18-20 ans, notamment pour les fibres blanches sous-corticales, notent Francis Eustache et Bérengère Guillery-Girard dans La Neuroéducation (Odile Jacob, 2016).
L’apprentissage doit donc tenir compte de ces spécificités de la mémoire selon les âges. L’une de ses dimensions les plus spectaculaires est la formidable explosion lexicale qui survient dès l’enfance. L’étendue du vocabulaire spécifique aux disciplines scolaires en témoigne : elle passe de 6 000 mots dans les manuels de 6e à 24 000 mots en troisième, selon une étude conduite par Alain Lieury (Université européenne de Bretagne) et Sonia Lorant (université de Strasbourg). En moyenne, 2 500 et 17 000 mots avaient respectivement été mémorisés par les élèves à la fin de ces niveaux. La bonne maîtrise de ce vocabulaire encyclopédique était prédictive de la réussite scolaire. « Pour que l’enfant comprenne ce lexique spécifique, il est impératif que les enseignants l’explicitent, à partir de différents supports, pour construire une culture commune, souligne Sonia Lorant, mais ce travail, notamment en primaire, n’a pas toujours lieu. » La chercheuse entend explorer plus avant les liens entre intelligence et mémoire, pour déterminer si la maîtrise de ces lexiques permet de mieux construire la pensée. Autre thématique à explorer, l’impact du virage en cours vers l’enseignement de compétences plus que de connaissances.
Ces dernières années, les neurosciences cognitives ont été invitées au chevet de l’école, notamment à travers le conseil scientifique de l’éducation nationale créé en 2018 par le ministre, Jean-Michel Blanquer. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France à la chaire de psychologie cognitive expérimentale, et qui préside ce conseil, distingue quatre piliers de l’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, qui passe par l’autoévaluation, le retour d’information – qui laisse entendre qu’il faut savoir apprendre de ses échecs – et la consolidation, qui passe par la répétition quotidienne des apprentissages.
« Le frein le plus puissant à l’apprentissage identifié par les sciences de l’éducation est l’ennui, au sens d’absence d’émotions »Pierre-Marie Lledo, Institut Pasteur
Mais au-delà, l’émotion est la clé. Ce n’est pas nouveau. Depuis Pavlov, on sait que mémoire et plaisir sont associés. « Il est démontré que les émotions peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée, en renforçant ponctuellement l’attention. Ainsi, une émotion positive peut se traduire par une amélioration ponctuelle des performances mnésiques », souligne l’Inserm. L’imagerie fonctionnelle montre aussi que la récupération d’un souvenir est améliorée par la présence d’une émotion positive. De même, chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. « C’est du présent que part l’appel auquel le souvenir répond, et c’est aux éléments sensori-moteurs de l’action présente que le souvenir emprunte la chaleur qui donne la vie », écrivait ainsi le philosophe Henri Bergson (1859-1941). En revanche, « une émotion trop forte entraîne une distorsion de l’encodage, qui peut conduire au syndrome de stress post-traumatique », ajoute l’Inserm. Des reviviscences restent alors douloureuses à distance de l’événement.
« Le frein le plus puissant à l’apprentissage identifié par les sciences de l’éducation est l’ennui, au sens d’absence d’émotions », souligne Pierre-Marie Lledo, qui dirige l’équipe perception et mémoire à l’Institut Pasteur et travaille notamment sur le rôle de la récompense. Plus prosaïquement, « on a tous en mémoire une matière qu’on a aimée à l’école grâce à la façon de la présenter de l’enseignant, qui produisait des émotions », poursuit le chercheur.
« La mémoire est aussi un acte social, construite en interaction avec les autres » Francis Eustache, neuropsychologue
« L’apprentissage est stimulé par ces expériences qui focalisent l’attention. Ainsi des sessions optimales d’apprentissage peuvent survenir lors d’épisodes d’attention totale », rappelle Gaëll Mainguy, directeur du développement du Centre de recherches interdisciplinaires (CRI). D’abord décrit par le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi à partir de 1975, le « flow » est « un état d’épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d’absorption que les personnes ressentent lorsqu’elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées et qu’elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis », selon la définition de l’European Flow Researchers Network.
Autre point-clé, « la mémoire est aussi un acte social, construite en interaction avec les autres », rappelle Francis Eustache, qui cite à ce sujet l’apport fondamental du sociologue Maurice Halbwachs (1877-1945). Constat partagé par Gaëll Mainguy, qui pointe les effets délétères pour le cerveau du manque d’empathie, du stress ou de la maltraitance plus ou moins visible dans la petite enfance sur les facultés d’apprentissage.
Et pour cause. Ces premières années sont bien sûr essentielles : notre stock de neurones, chiffré à près de 100 milliards, constitué avant même la naissance, subit là ses transformations les plus durables. Mais il faut tordre le cou à plusieurs idées reçues sur celui-ci : ce stock n’est pas d’emblée soumis à une dégradation irréversible, comme on l’entend bien souvent. « Ce qu’on observe, notamment chez les rongeurs, ce sont plutôt des remaniements dans les prolongements des neurones, des additions de contacts entre eux ou l’élagage de ces synapses, au gré des apprentissages », note Nora Abrous (Inserm, Centre Magendie, Bordeaux).
Le cerveau de l’adulte, fabrique à neurones ?
Le cerveau de l’adulte, fabrique à neurones ?
Autre idée à combattre : chez l’homme, le cerveau adulte ne fabriquerait pas de nouveaux neurones. Plusieurs travaux contradictoires publiés ces derniers mois ont entretenu le débat. Mais dans une étude publiée dans Nature Medicine, le 25 mars, Maria Llorens-Martin (Université autonome de Madrid) et son équipe établissent de façon solide que, chez l’homme, des neurones continuent à être produits en abondance, y compris au-delà de 80 ans – sauf en cas de maladie d’Alzheimer. Précisément dans le gyrus denté, une portion de l’hippocampe dévolue notamment à la mémoire épisodique.
« La difficulté de ces recherches, c’est qu’on ne peut réellement voir ces nouveaux neurones que chez l’animal mort », rappelle Nora Abrous, convaincue par la démonstration de sa collègue espagnole, qui a pu accéder à une collection de cerveaux humains « frais ». Mais les études chez les rongeurs étaient déjà sans équivoque : ces nouveaux neurones, fabriqués en permanence, s’accumulent pour concourir aux apprentissages. « Il faut considérer que le cerveau est en perpétuelle réorganisation », résume la chercheuse. Pierre-Marie Lledo abonde : « Le cerveau est prompt à détecter du changement et, en réponse, il produit de nouveaux neurones qui lui confèrent une protection contre certaines maladies neurodégénératives. La neurogenèse contribue à la mémoire. » Nora Abrous, qui organise en juin un congrès international à Bordeaux réunissant les pro et anti-neurogenèse chez l’homme, s’attend à de vifs débats…
Le rôle de la réserve cognitive
Le rôle de la réserve cognitive
La notion de réserve cognitive suscite des discussions plus feutrées chez les spécialistes. L’idée générale est que certains mécanismes neurocognitifs ont un effet protecteur face au vieillissement, qu’il soit normal ou pathologique, comme dans la maladie d’Alzheimer. Des études épidémiologiques portant sur l’incidence des démences illustrent parfaitement le rôle de la réserve cognitive. En 2016, la célèbre cohorte de Birmingham, près de Boston, a confirmé que le nombre de nouveaux cas diminuait de 20 % par décennie. Les principaux facteurs de risque vasculaires avaient diminué, mais ce qui faisait vraiment la différence, c’était l’accès à un niveau d’études au moins équivalent au bac.
Cette réserve cognitive ainsi constituée offrirait des capacités de compensation plus grandes : en cas d’atteinte d’un réseau cérébral, un circuit alternatif peut prendre le relais, si bien que les symptômes restent plus longtemps invisibles. « Avec cette faculté de compensation liée à un plus haut niveau d’études, les sujets sont susceptibles de décéder d’une autre cause et de ne jamais développer de maladie d’Alzheimer, ce qui explique cette incidence moins élevée », écrit la psychogérontologue Hélène Amieva dans Les Troubles de la mémoire, prévenir, accompagner (Le Pommier, 2015). La réserve protège plus longtemps des atteintes de l’âge, mais une fois que celles-ci se manifestent, le déclin est cependant plus rapide que pour des individus dotés d’un capital plus faible. Il existe toutefois bien d’autres facteurs de risques à la maladie d’Alzheimer, qui hante toutes les sociétés vieillissantes.
Quel sera l’impact de l’externalisation de la mémoire, avec la déferlante du numérique ?
Mais une autre inconnue surgit, qui pourrait tarauder toutes les générations : quel sera l’impact de l’externalisation de la mémoire, avec la déferlante du numérique ? La question posée en 2008 par le journaliste Nicholas Carr dans le magazine The Atlantic, « Google nous rend-il stupides ? », est plus que jamais d’actualité.
Certains ont une façon radicale d’y répondre, en faisant miroiter des implants neuronaux, comme la société Neuralink, fondée par Elon Musk, rêve transhumaniste qui ne fait pas l’unanimité. D’autres soulignent que chaque innovation permettant d’externaliser les savoirs – écriture, imprimerie, cinéma, radio, télévision, Internet… – a suscité des interrogations sur ses effets potentiellement délétères. Socrate, dans Phèdre, de Platon, ne nous mettait-il pas déjà en garde contre l’écriture, la qualifiant de pharmakon, tout à la fois remède et poison ?
Côté positif, le numérique donne de nouveaux outils, notamment aux élèves, pour chercher l’information, et « donne cette capacité à vivre tous les jours dans une immense bibliothèque », résume Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à Sorbonne-Université et chercheur au Laboratoire d’informatique de Paris-VI (Lip6, CNRS).
Qui croire, les pessimistes qui craignent que la capacité mnésique s’amenuise. Ou les optimistes qui pensent que les modes d’expression se transforment ?
Cette prolifération de supports externes a-t-elle une grande influence sur nos mémoires internes ? Qui croire, questionne Jean-Gabriel Ganascia dans La Mémoire au futur (Le Pommier, 2018) : les pessimistes qui craignent que la capacité mnésique s’amenuise, comme le philosophe Bernard Stiegler, pour qui « la mémoire est devenue le moteur de l’économie. C’est ce qu’on appelle l’économie des data, qui est en réalité une économie de la mémoire » ? Ou les optimistes qui pensent que les modes d’expression se transforment ?
La dispersion de l’attention par les incessantes sollicitations est en tout cas problématique. Les étudiants connectés pendant les cours courent vers de graves désillusions : ils réussiront moins bien aux examens que leurs pairs moins dispersés, rappelle Eric Jamet (université de Rennes), dans le hors-série de Pour la science consacré à la mémoire, en février-mars. Etre né avec Internet ne rend pas votre cerveau plus multitâche…
Fragmentation de l’attention
Fragmentation de l’attention
La grande majorité de la population dotée d’un téléphone mobile (94 % des Français en 2018, 73 % de smartphones) subit cette fragmentation de l’attention. La littérature scientifique est nourrie sur « les effets lourdement négatifs des écrans sur la concentration, le développement du langage, la réussite scolaire, etc. », constate le chercheur Michel Desmurget. Le numérique imprime sa marque sur notre anatomie.
Une étude, appelée ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), présentée sur la chaîne CBS en décembre 2018, montre que, parmi les 9-12 ans (4 500 enfants étudiés), ceux qui sont plus de sept heures par jour devant les écrans présentent une réduction de l’épaisseur du cortex cérébral. Mais comment interpréter cette différence anatomique ? Est-elle due à l’absence d’activité physique induite, à la nourriture qu’ils ingurgitent, au manque d’interactions sociales, ou aux contenus numériques qu’ils absorbent ? « Aujourd’hui, on ne dispose pas de cohortes, mais nous devons essayer de répondre à ces questions rapidement », note Francis Eustache.
« Bichonner » sa mémoire
« Bichonner » sa mémoire
En attendant, il est sage de « bichonner » sa mémoire, selon son expression. Comment ? Les messages de bon sens sont à rappeler : avoir une bonne hygiène de vie, à savoir bien s’alimenter, faire du sport et bien dormir. Le sommeil est un point fondamental, d’autant plus que le temps de connexion aux écrans qui ne cesse d’augmenter réduit le temps de sommeil, comme le montrent des études.
« De nombreux travaux rapportent un lien entre les troubles du sommeil, son manque chronique et les apprentissages chez l’enfant. Ces troubles peuvent entraîner un fonctionnement moins efficace de la mémoire de travail », expliquent Francis Eustache et Bérengère Guillery-Girard dans La Neuroéducation. Les différentes étapes du sommeil permettent la consolidation du souvenir, des connaissances, de la mémoire en général. L’imagerie a montré que, pendant le sommeil, on rejoue en quelque sorte ce qui s’est passé la veille, en faisant le tri, ce qu’a mis en évidence Pierre Maquet (université de Liège). Le professeur Lionel Naccache (Pitié-Salpétrière, AP-HP) rappelle ainsi que « nous avons un GPS cérébral logé dans l’hippocampe ». Il a été décrit par Edvard et May-Britt Moser, neuroscientifiques de l’Institut Kavli, en Norvège, et l’Américain John O’Keefe, découverte qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2014. « Lors du sommeil paradoxal, ce GPS cérébral se rallume et rejoue les trajectoires de la veille en consolidant les souvenirs épisodiques », poursuit le spécialiste.
Pour « cajoler » sa mémoire, l’éducation est fondamentale, et aussi ce qui va entraîner la mémoire de travail : les loisirs intelligents, par exemple, pour les personnes à la retraite, donner des cours, s’occuper d’une bibliothèque, d’une association caritative…, les relations sociales étant très importantes, insiste Francis Eustache.
L’un des apports les plus réjouissants de la neurobiologie de la mémoire est l’invitation à ne rien faire, ou plus exactement à rêvasser
Les adultes plus âgés doivent-ils s’astreindre à des entraînements cognitifs ? L’Organisation mondiale de la santé, qui a rendu publiques, mercredi 14 mai, ses recommandations pour lutter contre la démence, estime la qualité des données pour en juger « très faible à faible », et sa recommandation reste « conditionnelle », soit bien en deçà de celles concernant l’activité physique ou la nutrition.
Sonia Lorant, qui avait testé l’impact de certaines applications censées « muscler notre cerveau », confirme que la littérature ne montre que des effets réduits : « Plus vous vous entraînez à une activité, meilleur sera votre score à celle-ci, mais vous pouvez être bon au jeu de Tetris sans que cette compétence soit transférée à des rotations mentales dans un exercice de maths, par exemple, ou à d’autres aspects cognitifs », souligne la chercheuse, qui voit d’un œil plus favorable les quiz d’actualité ou de culture.
Pour finir, l’un des apports les plus réjouissants de la neurobiologie de la mémoire est l’invitation à ne rien faire, ou plus exactement à rêvasser. Car notre cerveau, s’il ne se repose jamais, adopte un mode d’activité par défaut lorsque nous ne focalisons pas notre attention sur le monde extérieur.
Découvert fortuitement il y a vingt-cinq ans, cet état se caractérise par un réseau coordonné entre diverses régions du cerveau. Il serait particulièrement impliqué dans la mémoire épisodique. Introspection, voyage mental dans le passé ou le futur, pensées incongrues propices à la création, ce mode de fonctionnement qui semble altéré dans certaines maladies neurodégénératives suscite de multiples travaux en recherche fondamentale comme en recherche clinique, relève Francis Eustache. Pour entretenir ce type de relation désintéressée avec sa propre mémoire, il faut du temps à soi. Dans La Mémoire, entre sciences et société (Le Pommier, 720 p., 13 euros), le chercheur souligne que pouvoir se tourner ainsi vers son monde intérieur est « une richesse qu’il faut préserver ».


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire