La santé à saute-frontière 3/5. De nombreuses femmes se rendent à l’étranger pour bénéficier d’une FIV, d’une PMA ou d’une préservation de fertilité, pratiques encore très encadrées en France.
Devant la clinique IVI de Pozuelo, banlieue chic de Madrid, une patiente, quadragénaire célibataire, tire une petite valise à roulettes pour monter dans le taxi qui l’attend, ce jeudi 9 mai. C’est la fin de son séjour en Espagne et le début de sa grossesse, souffle une réceptionniste.
A l’intérieur du bâtiment, moderne et lumineux, c’est un peu la tour de Babel. Dans la salle d’attente, on parle espagnol, mais aussi anglais, allemand, italien et beaucoup français. Ici, chaque année, 6 000 cycles de reproduction sont lancés. « Un quart de nos patientes sont étrangères, à 40 % des Françaises », résume la directrice adjointe, Yolanda Minguez, qui défend avec ferveur un « droit » à la maternité.
Bien qu’il soit au beau fixe, ce n’est pas le soleil qui motive les patientes françaises à se soumettre à une technique de procréation médicalement assistée (PMA) en Espagne, mais une législation beaucoup plus souple qu’en France. La PMA est permise pour les femmes célibataires ou les couples de femmes. Les fécondations in vitro (FIV) y sont autorisées jusqu’à 50 ans, contre 43 ans dans l’Hexagone. Il est possible de réaliser des tests de compatibilité génétique poussés et des diagnostics préimplantatoires, qui ne sont autorisés en France qu’en cas d’antécédents médicaux familiaux très graves. La conservation d’ovocytes par vitrification, afin de repousser une possible grossesse, y est permise sans raison médicale.
Surtout, alors qu’en France, il faut compter trois ans pour obtenir un don d’ovocyte, en Espagne, il n’existe pas de liste d’attente. Si les cliniques l’expliquent par l’altruisme des Espagnols, premiers donneurs d’organes d’Europe, les 1 000 euros versés pour compenser le temps et les inconvénients liés au processus, apparaîssent sur les forums des sites spécialisés comme une motivation majeure pour les donneuses.
Selon les derniers chiffres officiels de la société de fertilité, en 2016, plus de 45 000 femmes ont eu recours à une FIV en Espagne. Près de 13 000 d’entre elles venaient d’un autre pays, dont 5 100 de France (39,4 % de ce contingent d’étrangères).
« Un classique chez les Parisiennes »
Installée dans une chambre de la clinique, où elle est sur le point de se soumettre à une ponction ovarienne, Caroline, Parisienne de 39 ans qui préfère ne pas donner son nom, est venue pour préserver sa fertilité. « J’ai investi beaucoup de temps dans ma carrière et je n’ai pas vu le temps passer, explique-t-elle. Il y a quatre ans, j’ai réalisé que je ne pourrai pas faire ma vie sans enfant et qu’il faudrait que je pense à congeler mes ovules, puisque la science le permet. » En France, cette pratique n’est autorisée qu’en cas de maladie affectant la fertilité. « Pour moi, c’est un “back up”, une question de sécurité au cas où je n’y parviendrais pas de manière naturelle d’ici deux ou trois ans », ajoute cette célibataire.
Elle a commencé la stimulation ovarienne, en France, il y a douze jours. Son gynécologue n’a posé aucune difficulté pour lui prescrire sur ordonnance le traitement hormonal et les échographies indiqués par la clinique espagnole. « Il est habitué : ça devient un classique chez les Parisiennes célibataires de plus de 35 ans », assure-t-elle.
A la clinique Tambre, édifice discret du quartier résidentiel huppé du Viso, en plein cœur de la capitale, c’est « 40 % de la clientèle qui est étrangère, explique la directrice générale, Inge Kormelink. Ce sont souvent des couples qui sont passés par plusieurs traitements de fertilité sans succès et qui ne peuvent pas attendre deux ou trois ans pour obtenir un don d’ovule. »
9 000 euros
Pénélope (les prénoms ont tous été modifiés), patiente de 42 ans, s’y est rendue le mois dernier. « J’ai eu un cancer du sein à 40 ans, et comme il était hormonodépendant, je n’ai pas pu faire de stimulation ovarienne pour congeler mes ovules avant la chimiothérapie, raconte-t-elle par téléphone. A la fin du traitement, mon gynécologue m’a expliqué qu’avec ce qui me restait d’ovocytes, je n’avais que 4 % de chances de tomber enceinte. Il m’a alors parlé du don d’ovule et nous avons tout de suite écarté la France à cause des listes d’attente : j’aurais dépassé l’âge limite. »
Dans un premier temps, cette chef de projet penche pour les cliniques du Danemark, où la législation permet à l’enfant de connaître l’identité de sa mère génétique, contrairement à l’Espagne. Mais la barrière de l’anglais et un premier contact téléphonique négatif la freinent. Dans les cliniques espagnoles qui se sont spécialisées dans l’accueil des patients étrangers, le personnel parle français.« Cela nous a donné confiance, résume Pénélope. Et puis, on nous a proposé un test de compatibilité génétique, qui permet d’écarter certains risques d’anomalies, ce qui était d’autant plus important que je sortais tout juste d’une maladie. »
Après trois mois de réflexion, durant lesquels il a fallu renoncer au « romantisme » d’une maternité naturelle et « dédramatiser » le fait de porter un enfant qui n’a pas ses gènes, Pénélope est venue en janvier passer un week-end à Madrid avec son mari, afin qu’il donne son sperme. Début mars, la clinique lui a expliqué comment synchroniser son cycle menstruel sur celui de la donneuse. En France, son médecin lui a fait une ordonnance pour qu’elle suive un traitement hormonal pendant trois semaines. Puis, en avril, on lui a annoncé que la fécondation in vitro avait été réalisée et qu’elle devait se rendre à Madrid cinq jours plus tard. « Le transfert a duré cinq minutes : cela fait un mois que je suis enceinte », raconte-t-elle. Le coût du processus s’est élevé à près de 9 000 euros. Beaucoup moins que dans les pays du nord de l’Europe.
Le bébé d’Anne, cadre de 40 ans dans une grande entreprise, célibataire, est quant à lui né le mois dernier, après une insémination artificielle. « J’ai commencé à envisager d’être mère célibataire à l’été 2017, à la suite d’une séparation, raconte-t-elle. Je me suis demandé si je devais attendre de rencontrer la bonne personne, quitte à prendre le risque de ne plus être fertile, ou si je pouvais dissocier le projet de conception d’un enfant de celui du couple. J’ai soupesé toutes les options : faire un enfant dans le dos d’un homme, ce qui me semblait peu éthique et que je me voyais difficilement expliquer plus tard à mon enfant, ou bien opter pour la coparentalité avec un couple homosexuel, ce qui me semblait très compliqué à gérer, d’autant plus que je garde encore l’espoir de fonder une famille classique. »
Finalement, c’est une amie médecin qui l’a renvoyée vers des forums, essentiellement de lesbiennes, et vers l’association française Maia, qui aide les couples en fin de droit pour une PMA en France à poursuivre à l’étranger leur projet de maternité et fournit des informations et une liste de centres partenaires, dont la clinique Tambre.
Après avoir écarté les pays où le don de sperme n’est pas anonyme, de crainte que l’enfant n’ait des « attentes envers un père fantasmé », elle a choisi l’Espagne après un rendez-vous sur Skype avec une coordinatrice et une médecin, en français. L’insémination a marché au premier essai. Au total, cela lui a coûté 1 200 euros, sans compter les billets d’avion et l’hôtel. « Pour moi, c’est socialement très injuste que des gens qui n’en ont pas les moyens ne puissent pas avoir accès à ces techniques, dit-elle. Si l’adoption est autorisée pour les célibataires, pourquoi pas la PMA ? » Elle espère que cet été, en France, le projet de loi pour ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes sera approuvé.

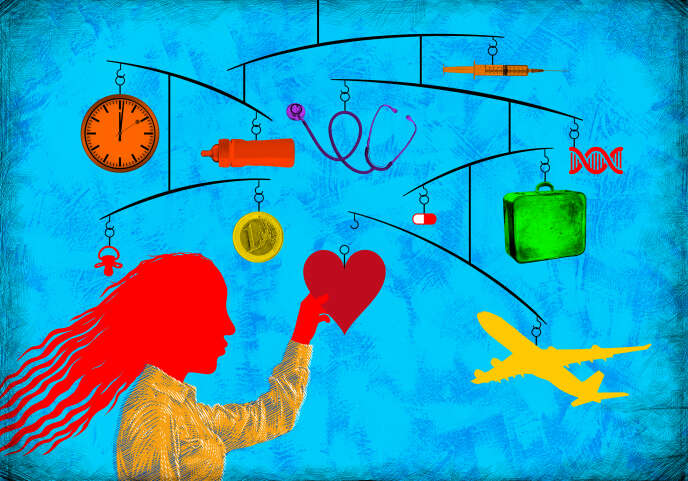

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire