Quand ils arrivent en France, les internes formés ailleurs en Europe sont accueillis avec méfiance.
La santé à saute-frontières (2/5). « L’expérience a été terrible. » Antoine Reydellet en garde un souvenir indélébile. Son premier stage d’interne en France, en 2016, lui a rappelé qu’il avait validé ses six années d’études de médecine… en Roumanie. « Les chefs de service partent du principe qu’on n’a pas le niveau », résume le jeune homme, qui s’est retrouvé « à bout », en arrêt maladie pendant deux semaines, avec un chef de clinique « maltraitant ». Actuellement président de l’InterSyndicale nationale des internes (ISNI), l’étudiant en troisième année d’internat en médecine du travail au CHU de Lyon, a validé tous ses stages. Mais aujourd’hui encore, il dit subir cette mauvaise image qui colle aux diplômés venant d’un autre pays européen. Et particulièrement aux Français qui, comme lui, sont partis dans une université roumaine pour échapper au concours très sélectif de fin de première année ou après l’avoir raté.
Dans ce monde si particulier des études médicales françaises, régulé par un concours et des places limitées par un numerus clausus, l’ouverture européenne ne se fait pas sans difficultés. Il y a bien un système d’équivalence : quel que soit le pays d’origine, un étudiant qui a validé son deuxième cycle d’études médicales a accès au troisième cycle (l’internat).
Depuis près de dix ans, le nombre d’étudiants européens a explosé. En 2012, ils étaient 144 candidats issus d’un pays européen à l’examen classant national (ECN), qui répartit les futurs internes dans les différentes spécialités et régions de France. Ce chiffre a grimpé à 621 en 2018. Cette année, 524 étudiants européens sont inscrits à l’ECN, sur près de 9 000 candidats, en tête les diplômés venant d’Italie (217). Ceux formés en Roumanie sont également nombreux (200), avec une particularité : 60 % d’entre eux sont français. La Roumanie a en effet développé des cursus français dans ses universités.
« Officiellement, tout le monde peut se présenter à l’ECN, mais, après, on vous fait payer votre origine », reprend Antoine Redeyllet. Il constate que la France apparaît de moins en moins attractive à ses camarades qui se tourneraient désormais en plus grand nombre vers l’Allemagne ou la Suisse.
Regard sévère
Les diplômés étrangers témoignent eux aussi d’une arrivée difficile, avec cette barrière supplémentaire que représente parfois leur niveau de langue. Raquel Tena a immédiatement été « mise sous tutelle » par sa chef de service, lorsqu’elle a pris son premier poste d’interne en 2013, avec son accent espagnol. Des débuts« un peu stigmatisants », reconnaît la jeune femme, aujourd’hui médecin généraliste urgentiste à Poissy (Yvelines), qui a réussi tout de même à faire ses preuves à l’époque en une semaine seulement. Elle témoigne :
« Il y a des a priori négatifs envers les étudiants étrangers, mais j’ai suivi mes études dans une université espagnole aussi prestigieuse que les meilleures facs françaises, donc oui, j’avais le niveau. »
Dans le milieu médical, ce regard souvent sévère envers les étudiants européens qui débutent leur internat en France n’est pas sans fondements. En cause : l’ECN a ceci de spécifique qu’il ne s’agit pas d’un concours mais d’un examen où chaque étudiant est classé. Un candidat peut donc obtenir un poste, quels que soient ses résultats… même avec 0/20 aux épreuves. Et c’est un secret de polichinelle : les étudiants diplômés dans un autre pays européen y sont particulièrement mal classés. D’après les dernières données de 2015, 90 % d’entre eux se situaient dans le dernier quart du classement.
Difficulté à se préparer faute d’avoir accès aux mêmes banques d’épreuves que les Français, exercices piégeux, différences de programmes étudiés d’un pays à l’autre… les explications ne manquent pas, entend-on chez de nombreux internes européens, qui déplorent un « procès injuste sur leur niveau ».
« Une anomalie du système »
Il n’empêche, « c’est une anomalie du système », tonne Jean-Pierre Vinel, président de l’université Toulouse-III-Paul-Sabatier. L’ancien patron de la conférence des doyens de médecine a tenté, dans les années 2010, d’instaurer des notes éliminatoires à l’ECN, en vain. « Je suis pour la circulation en Europe, mais quand certains pays, comme la Roumanie, fabriquent des universités spécialement pour nos étudiants français qui ne réussissent pas leur première année chez nous, cela pervertit le système », juge-t-il, brocardant au passage le « business » de ces établissements aux frais d’inscription de plusieurs milliers d’euros.
Pour lui, le constat est clair : si certains candidats européens sont très bons, un grand nombre d’entre eux n’ont pas le niveau de formation clinique suffisant. Ce n’est pas « politiquement correct de le dire, avance-t-il, mais tout le monde sait qu’ils se retrouvent dans des spécialités médicales moins demandées, comme la médecine du travail ou la santé publique, moins exigeantes sur le plan clinique ».
« Notre formation en France s’effectue très tôt au chevet du patient », appuie Jean Sibilia, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine, pour qui« le problème n’est pas forcément sur le terrain de la théorie, mais plutôt de la pratique ». Le chef du service des urgences à l’hôpital de Saint-Denis, Mathias Wargon, en témoigne : récemment, il a refusé de valider le stage d’une interne française formée en Roumanie, « ce qui n’arrive jamais », souligne-t-il, en raison de trop fortes lacunes, notamment pour présenter un dossier ou encore examiner un patient. « C’est un monde compliqué, l’hôpital, décrit-il. Il y a un apprentissage qui se fait pendant l’externat [de la 3e à la 6e année d’études en France]. »
Et dans le milieu médical, personne n’a oublié ces huit étudiants exclus de leur service à l’hôpital pour incompétence il y a quatre ans, obligés de suivre une remise à niveau, six d’entre eux avaient effectué leurs études en Roumanie.
Nette amélioration
A entendre d’autres professeurs de médecine, ce constat sévère est néanmoins à nuancer. Djillali Annane, doyen de la faculté de médecine de Versailles, assure :
« Autant le niveau de formation de ces étudiants européens était un vrai problème il y a une quinzaine d’années, autant, aujourd’hui, cela s’est nettement amélioré. »
Ce qui ne veut pas dire qu’un temps d’acclimatation n’est pas nécessaire, « mais ce temps peut être utile à tous, y compris à certains Français, selon les déficits en compétences », estime-t-il.
Pierre, interne en médecine d’urgence passé par la filière roumaine, ne dit pas autre chose. L’étudiant français n’a pas eu l’expérience violente de certains de ses camarades en arrivant en France en 2017, sur un poste en Picardie. « J’avais cette inquiétude d’être accueilli comme un paria, mais cela s’est très bien passé », décrit le jeune homme, qui a certes été mal classé à l’ECN mais a validé tous ses stages jusqu’ici. Il le reconnaît néanmoins volontiers : une période d’adaptation a été nécessaire. « On n’a pas pratiqué certains gestes que les Français connaissent, témoigne le futur urgentiste. On n’a pas non plus forcément les mêmes réflexes de prescription. »
La situation est vouée cependant à être bouleversée : la loi santé, en cours d’examen au Parlement, prévoit la suppression des ECN, qui devraient être remplacés par des épreuves portant sur les connaissances mais aussi les compétences des candidats. Avec des notes minimales éliminatoires, d’après le ministère de l’enseignement supérieur.

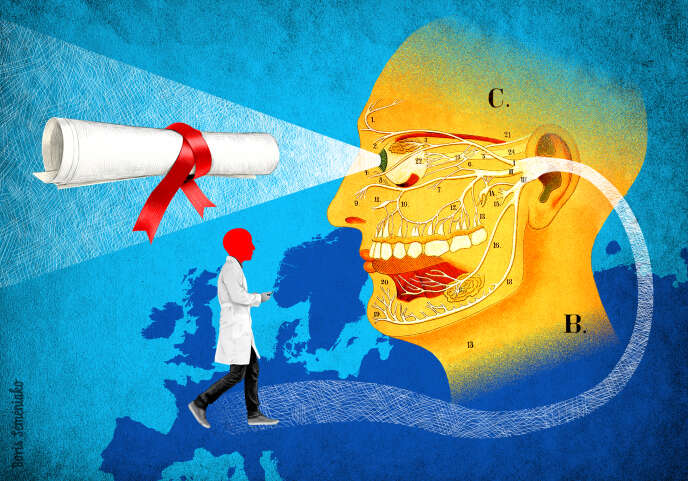

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire