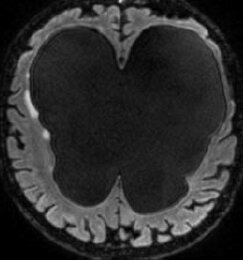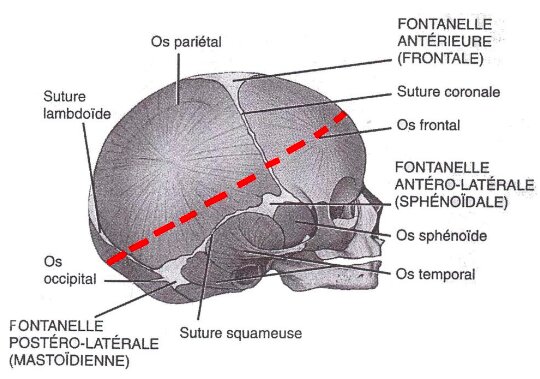Si l'Espagne est en passe d'atteindre son objectif de vacciner pleinement 70% de la population d'ici à la mi-août, les experts avertissent cependant qu'en raison de la flambée due aux nouveaux variants, pour atteindre l'immunité collective, ce chiffre doit désormais être supérieur à 90%, ce qui signifie qu'il faut vacciner les adolescents, explique à El Pais Manuel Franco, porte-parole de la Société espagnole de santé publique:
« Atteindre l'immunité collective sans eux est pratiquement impossible. »
Dans le peloton de tête pour la vaccination complète
L'Espagne a déjà complètement vacciné environ 61% de sa population, contre près de 58% en Italie, 56% en France (56,53 % ce 12 août selon CovidTracker) et 55% en Allemagne, d'après des chiffres établis par l'AFP à partir de sources officielles. Hors UE, elle fait également mieux que le Royaume-uni (58,5%) et les États-unis (un peu plus de 50%).
Consensus sur la nécessité de vacciner et le pass sanitaire
Ces chiffres rendent superflus les débats sur des mesures telles que l'obligation de vaccination ou le pass sanitaire, qui ont provoqué des manifestations dans certains pays européens.
De fait, parmi les principaux pays de l'UE, l'Espagne fait figure de leader de la vaccination contre le Covid-19, grâce à une confiance inébranlable de la population dans son système de santé et les vaccins, mais aussi une forte solidarité familiale.
L'un des "éléments clés" du succès de la campagne de vaccination en Espagne a été "la confiance dans le système de santé", explique à l'AFP Josep Lobera, professeur de sociologie à l'Université autonome de Madrid. Membre du comité national pour la stratégie de vaccination, il a été chargé par les autorités d'étudier comment les Espagnols allaient accepter le vaccin.
79% des Espagnols font confiance aux vaccins anti-Covid
M. Obera et ses collègues ont constaté qu'ils étaient "avantagés par rapport à d'autres pays, car la confiance dans les vaccins en général, et dans les vaccins infantiles en particulier, était traditionnellement plus élevée que dans les autres pays européens".
Selon une étude menée dans 15 pays par l'Imperial College London et publiée en juin, 79% des Espagnols avaient confiance dans les vaccins contre le coronavirus, contre seulement 62% des Américains, 56% des Français ou 47% des Japonais.
Lire la suite ...


:quality(70):focal(1490x1893:1500x1903)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/VOGDIKR4XFGDTADGQMGGJRWQHU.jpg)



:quality(70):focal(653x1093:663x1103)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/WD2CRAQY3ZA3PHWJBR3AGHEVNE.jpg)





:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KTYELUCOGJDM3H4AT3KMGZQQ5Q.jpg)

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/7NAH42DF7RA3NMCJYTP3QPV7BQ.jpg)