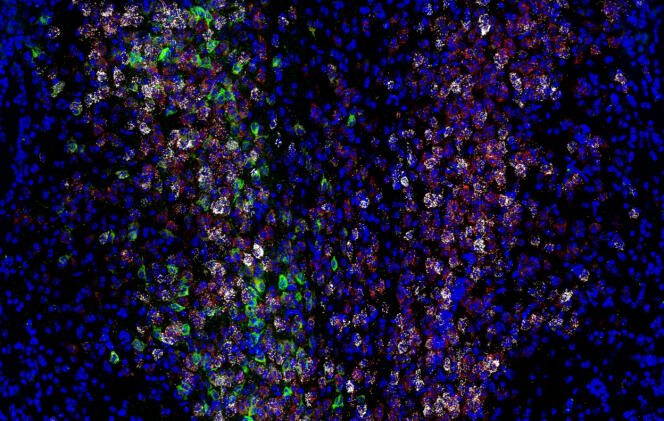par Charles Delouche-Bertolasi publié le 1er août 2022
:quality(70):focal(2473x1601:2483x1611)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/EIHOBWXHHVGYTFC3WOYQZFK74A.jpg)
Prescrire du cannabis médical sans autorisation exceptionnelle : voilà la petite révolution que vont connaître les médecins suisses dès le 1er août avec l’entrée en vigueur d’une modification de la loi helvète datant de mars 2021. Le texte prévoit d’annuler l’interdiction du cannabis pour des raisons médicales et la fin de l’autorisation nécessaire de l’Office fédéral de la santé publique pour toute prescription. L’interdiction de commercialisation étant de fait levée, des milliers de patients devraient pouvoir accéder plus facilement aux médicaments à base de la plante séculaire, notamment les personnes atteintes de cancer ou de sclérose en plaques. Nicolas Authier, médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie, analyse cette avancée de la Suisse et décrypte la situation française.
Pensez-vous que cette avancée suisse soit duplicable en France ?
Lors des phases d’audition qui ont précédé le lancement de l’expérimentation du cannabis médical en France, nous avons interrogé les représentants suisses. Jusqu’alors, le modèle suisse était basé sur des médecins accrédités. Désormais, ils veulent élargir l’accessibilité pour permettre à plus de patients de pouvoir prétendre à ces traitements. Je ne pense pas que ce sera le modèle qui sera retenu en France car il n’est pas possible d’un point de vue réglementaire.
Où en est-on de l’expérimentation française ?
Ce qu’on a retenu est très proche de ce qui se fait à l’étranger, à l’exception du traitement du glaucome et des douleurs chroniques larges. Il y a toujours des revendications et des souhaits d’élargir les pathologies retenues. C’est une possibilité si les preuves scientifiques existent. Au sein du comité scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), nous continuons de faire des auditions, notamment des spécialistes de l’addiction, de la psychiatrie. S’il y a une littérature scientifique avec un niveau de preuve suffisant, cela permettra de rajouter ces indications.
Plus d’un an après son lancement, quels sont les enseignements de cette expérimentation ?
L’expérimentation se termine officiellement le 26 mars 2023. Début août, nous serons à 1 900 patients inclus. Nous sommes sur une moyenne de 100 nouveaux patients inclus par mois. Les spécialistes de l’épilepsie, de l’oncologie ou encore de la douleur semblent être satisfaits de pouvoir disposer de ce nouvel outil thérapeutique. Bien entendu, personne ne parle de miracle mais le retour est positif, aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé. Pour des patients qui sont en échec thérapeutique ou à qui on ne peut pas prescrire des antalgiques opioïdes, le cannabis médical est une alternative intéressante. Il permet d’améliorer le sommeil, de diminuer l’anxiété, d’améliorer l’activité physique et parfois de permettre la reprise de l’emploi. C’est un traitement du patient souffrant de douleur plutôt qu’un traitement de la douleur elle-même.
Quelles sont les priorités à l’approche de la fin de l’expérimentation ?
Nous devons résoudre deux questions. D’abord, celle du statut du cannabis qui n’est toujours pas officiellement tranchée. S’il y a une légalisation, alors ces traitements devront entrer dans les cases «médicaments» prévues par le code de santé publique. Ensuite, il y a la question du remboursement. Les produits à base de cannabis ne répondent pas au chemin classique de la demande de remboursement d’un médicament avec autorisation de mise sur le marché. Ils ne seront pas non plus expertisés par la Haute Autorité de santé qui, d’habitude, constate l’amélioration du service médical rendu et permet ensuite de fixer le prix. Le remboursement sera-t-il donc décidé par un décret ministériel, comme ça avait été le cas pour l’homéopathie ? C’est un sujet très important.
La France va-t-elle légaliser le cannabis médical selon vous ?
Il y a deux possibilités : soit un passage à la généralisation ou légalisation du cannabis médical via une inscription dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui sera voté fin 2022. Soit la prolongation de l’expérimentation. Un rapport intermédiaire doit être rendu en septembre au gouvernement : si nous n’avons pas de signaux positifs au plus tard en octobre, il est peu probable qu’on ait une légalisation au printemps 2023.
Que répondez-vous à ceux qui voient la légalisation du cannabis médical comme une porte ouverte à la légalisation du cannabis tout court ?
Est-ce que le marché de la morphine fait la courte échelle au marché de l’héroïne ? Non. Ce marché, s’il est ouvert, sera extrêmement encadré et régulé. Il ne fera pas la courte échelle à quoique ce soit. Et puis, s’il y a une tendance allant vers la légalisation du cannabis, c’est plutôt celle du cannabis «bien être» avec les produits chargés en cannabidiol, la molécule non psychotrope du cannabis. C’est ce marché qui met le pied dans la porte plutôt que le cannabis médical qui va rester une niche. On est sur des profils d’usagers, un marché et une ampleur de consommation totalement différents. Le cannabis médical ne concernera peut-être que 150 000 patients traités contre au moins cinq millions d’usagers réguliers de cannabis récréatif.




:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/L6VSD4IXX5AF3O62O7FQYPTG5M.jpg)

:quality(70):focal(3506x3235:3516x3245)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/FWMPJBPFKZBI5BVAGIKISY3EGA.jpg)



:quality(70):focal(3193x1760:3203x1770)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/G4IJV6V4QRD2RPPEOIDQFGXJZ4.jpg)



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/A27ECN257ZG35JL2OFEHWWVFRE.jpg)



:quality(70):focal(2255x1535:2265x1545)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/UHMNZ5PPLBFJTOJ3GLTQC6CIIQ.JPG)

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/LOXPIY2XOZCMZIEAKREKL5XCAE.jpg)



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/WCHGHLASUVCIJPA4WFSFDCN73A.jpg)