LE 30/12/2021
À retrouver dans l'émission
LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE
par Nicolas Martin
Peut-on définir les mathématiques ? Depuis quand les utilise-t-on ? A quoi servent-elles ? D’où vient la déraisonnable efficacité des mathématiques ? Faut-il les voir comme un outil pour appréhender la réalité ou comme son essence même ? Pourquoi certains y voient une intention ou origine divine ?

Si l’on devait transcrire l’aporie de l’œuf ou la poule en langage scientifique, ce serait certainement autour de la question des mathématiques : dès l’aube de la pensée, les humains se sont demandés si les mathématiques sont présentes au cœur de la nature, prêtes à être décryptées ou si elles sont un langage inventé par l’homme pour décrire cette nature et l’analyser. Ou pour le formuler différemment, si les mathématiques sont le langage du divin, ou de l’humain. Et lorsqu’on finit par exclure la notion de divin, cela donne la question qui va nous occuper : comment expliquer la déraisonnable efficacité des mathématiques ?
La déraisonnable efficacité des mathématiques. C’est donc l’énoncé du problème qui va occuper La Méthode scientifique dans l’heure qui vient.






:quality(70):focal(2191x1805:2201x1815)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/LN4YMPCYCJEDJA6JSD2NTW6NFQ.jpg)
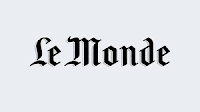


:quality(70):focal(2825x1805:2835x1815)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/AEUIV2M63JDOBGSANILG6YLY34.jpg)












:quality(70):focal(2849x2046:2859x2056)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/RVXYLPVSDBGIRCX3CPTX4ZU7FQ.jpg)





