Christophe Gattuso 1er février 2023
Il peut écrire des poèmes, rédiger des lettres de motivation, proposer des recettes de cuisine et répondre à toutes les questions ou presque qui lui sont posées… Mis en ligne en novembre dernier, le nouvel agent conversationnel ChatGPT, développé par l’entreprise américaine OpenAI et dans lequel a massivement investi Microsoft, pourrait ouvrir d’importantes perspectives dans le domaine de la santé.
Après la chirurgie, la découverte de la pénicilline ou de la vaccination, se souviendra-t-on de ChatGPT comme d’une grande avancée dans le domaine de la médecine ?
Il a fallu moins de trois mois pour que ce modèle de machine learning affole les amateurs de nouvelles technologies. Selon eux, les robots conversationnels, capables de comprendre le langage naturel et de répondre intelligemment aux questions des utilisateurs, pourraient révolutionner certains usages et de transformer de nombreux métiers.
« Depuis environ quatre ans, les "géants du web" comme Google, développent des modèles massifs de langage, tels BERT ou GPT, qui facilitent la mise en œuvre de techniques de traitement automatique de la langue naturelle, comme le résumé de texte, les systèmes de question-réponse, la génération automatique de textes ou le dialogue. Ces derniers surprennent par leur qualité de leur répartie », explique à Medscape édition française Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste de l'intelligence artificielle, ex-Président du comité d'éthique du CNRS, président du comité d'orientation du CHEC (Cycle des Hautes Études de la Culture) et membre du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires.
Lire la suite ...







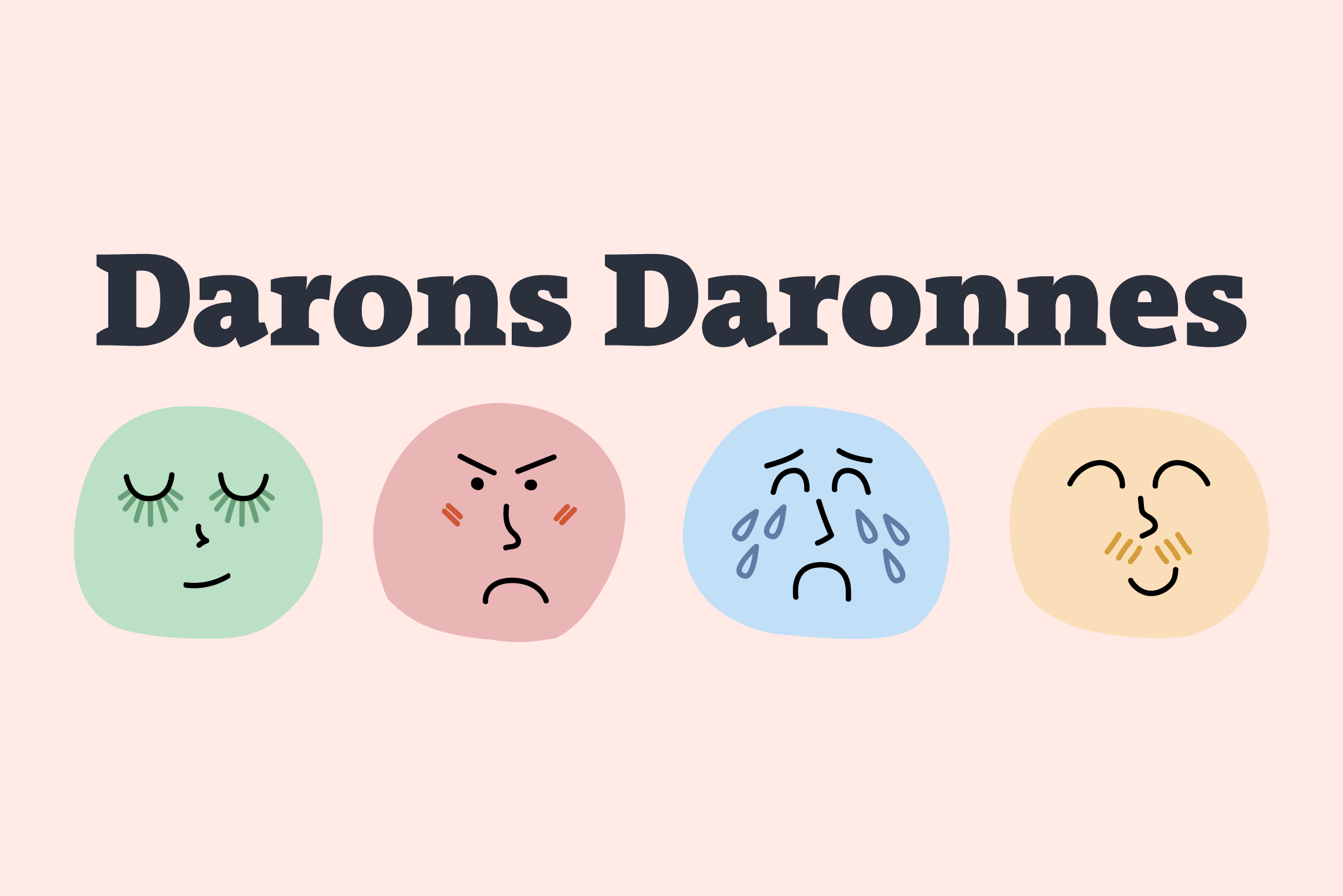












:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/CM4GU6UI75BEZA4CVDHT3RPJ5Y.jpg)


