
par Sonya Faure publié le 21 avril 2021
Injures racistes ou sexistes, violences des réseaux sociaux : comment préserver la liberté d’expression, se demande la philosophe dans son dernier essai. Tous les propos sont admissibles, dit-elle, à condition que l’autre puisse répliquer, se défendre. Débattre en somme, sans oublier l’humour.
(Getty Images)
Nous la considérons comme l’une des valeurs ultimes de notre système politique, mais la liberté d’expression est-elle dépassée ? A redéfinir, en tout cas, selon Monique Canto-Sperber. Dans son dernier livre, Sauver la liberté d’expression (Albin Michel), la philosophe dit son inquiétude face aux dangers qui la menacent : d’un côté, la revendication d’une parole libre, et en réalité souvent raciste, sexiste ou antisémite ; de l’autre, la tentation d’une nouvelle censure au nom de nobles idéaux progressistes. Monique Canto-Sperber poursuit la tradition libérale et l’un des grands penseurs de la liberté de parole, John Stuart Mill (1806-1873), pour la définir en ces termes : «La liberté d’expression est la certitude que nous continuerons à nous parler et à nous surprendre.» Ou dit autrement : «Tous les propos sont admissibles, sauf s’ils n’ont d’autre but que de faire taire et d’anéantir tout débat.» Plutôt qu’une question de valeur ou de morale, la liberté d’expression est un équilibre, et ses limites doivent être définies à partir de la liberté de parole laissée aux autres, à leur liberté de répliquer.
La liberté d’expression vous semble-t-elle aujourd’hui menacée ?
Oui, car elle est prise en tenaille par deux courants. D’une part, la revendication du droit de tout dire, d’une parole libérée de tout tabou, qui se réclame du noble idéal de la liberté d’expression, avec ce qu’elle a d’incontestablement transgressif. La liberté d’expression sert ici à dédouaner des propos qui sont à la limite de l’incrimination pénale, surtout en termes de racisme et d’antisémitisme. Ce genre de parole se retrouve, sous une forme extrême, chez Alain Soral, mais parfois aussi, de façon plus suggérée, dans Valeurs actuelles ou CNews. Et, de l’autre côté, de nouvelles formes de censure.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3AS3KLRB6ZG3LI3VDHFYLEHBGU.jpg)

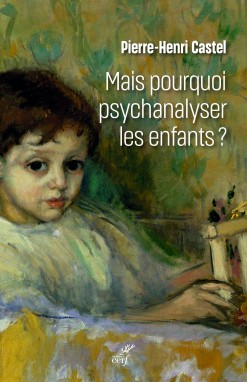




:quality(70):focal(2295x1415:2305x1425)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/B6AWGIHU3FBL3HXN6XG3SK25YY.jpg)






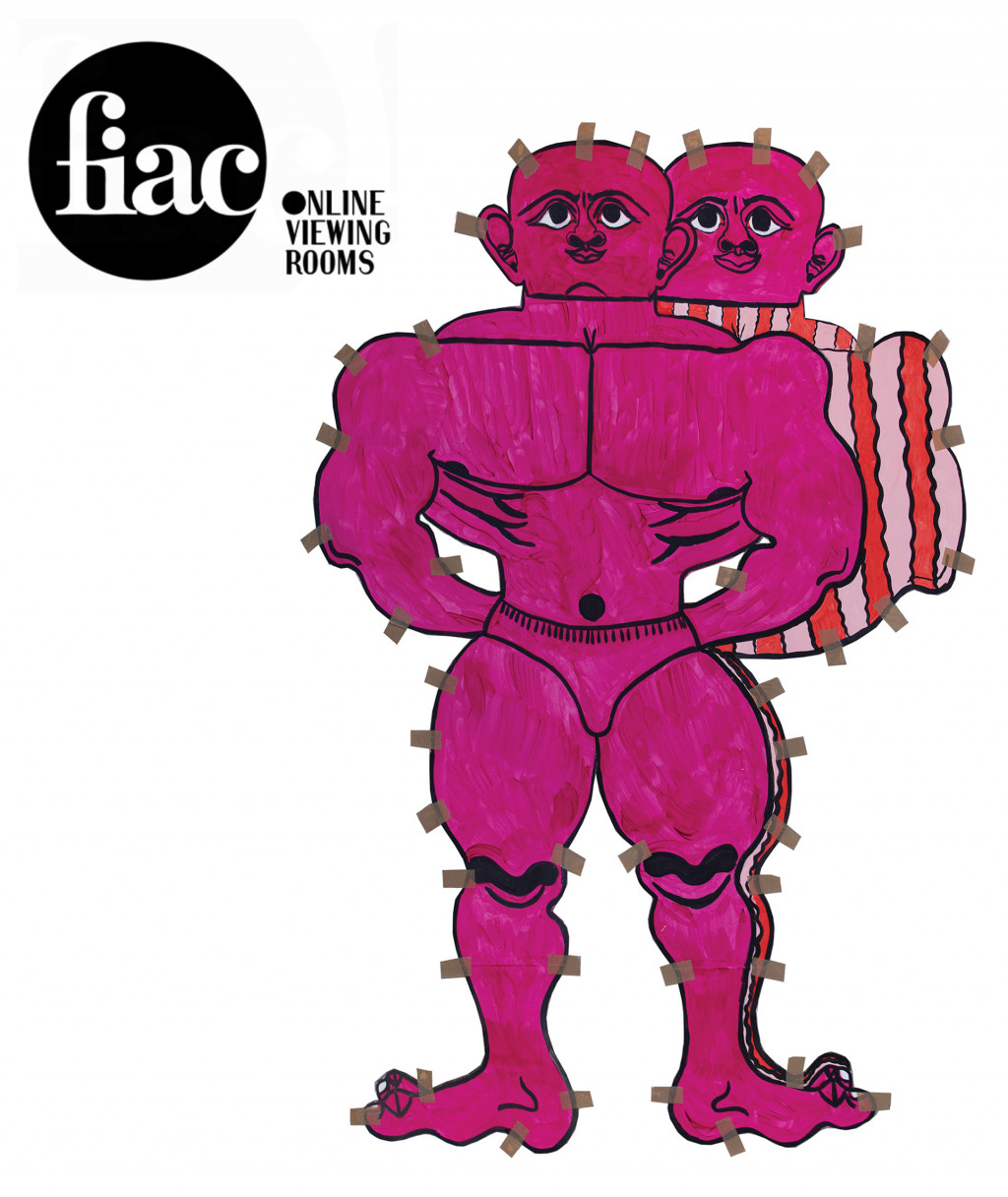
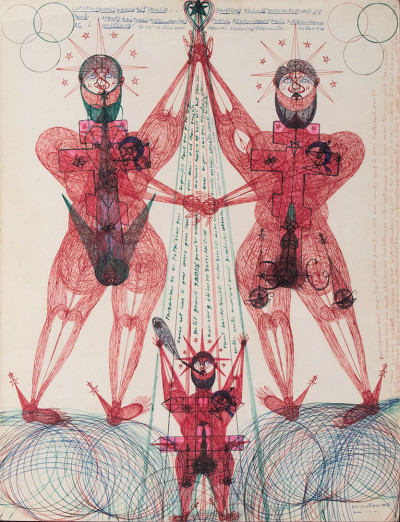
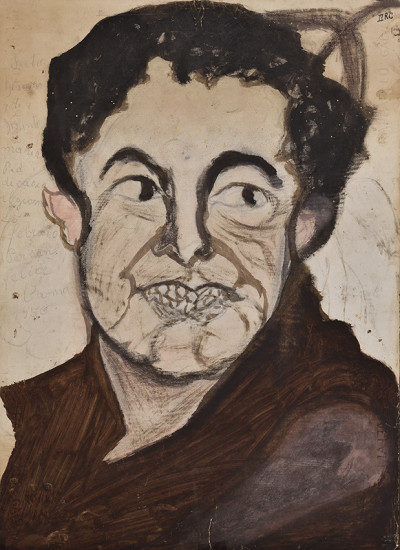





:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/E3E6HTHHAJBZHE6ZBPCUNZKCLE.JPG)








