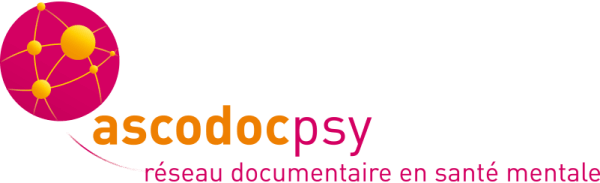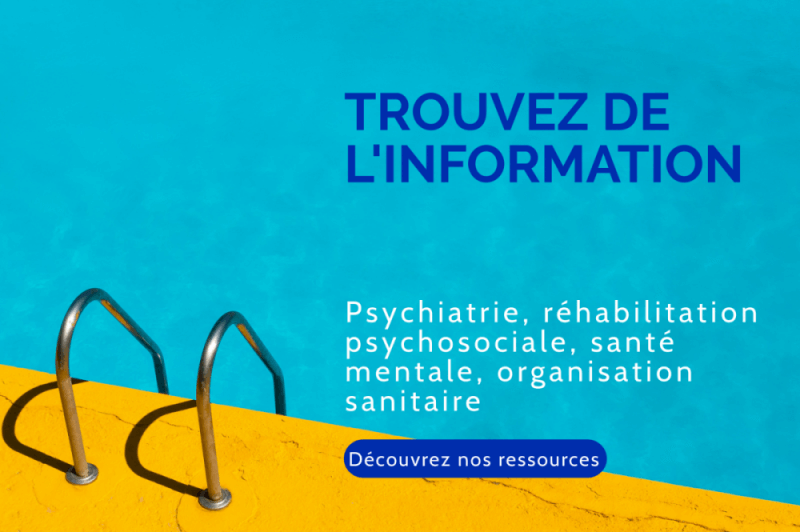Malgré les risques potentiels sur le terrain, les universités ou écoles qui proposent des diplômes préparant à des carrières dans le secteur humanitaire attirent toujours de jeunes aspirants.
« Aider les populations qui en ont le plus besoin, c’est le but de ma vie. » Clémence Petton, 23 ans, le dit sans exaltation mais fermement. L’assassinat de six jeunes Français de l’ONG Acted et de leur accompagnateur, dimanche 9 août au Niger, ne la dévie en rien de la ligne qu’elle s’est fixée : aider les plus démunis, même dans les zones les plus dangereuses.
Ce vendredi de septembre, c’est probablement sa dernière rentrée sur les bancs d’une école. Avec elle, ils sont une trentaine d’étudiants à suivre le premier cours de l’année du master de « management de la solidarité » de l’Ircom, une école privée spécialisée dans la formation d’humanitaires « de terrain », située près d’Angers (Maine-et-Loire). « Il y a trente ans, les hommes et les femmes qui partaient en mission humanitaire dans des zones en conflit étaient des têtes brûlées, sans formation adaptée », affirme Christine Aubrée, directrice du pôle formations de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), école qui compte parmi ses élèves nombre d’aspirants à des carrières dans l’humanitaire.