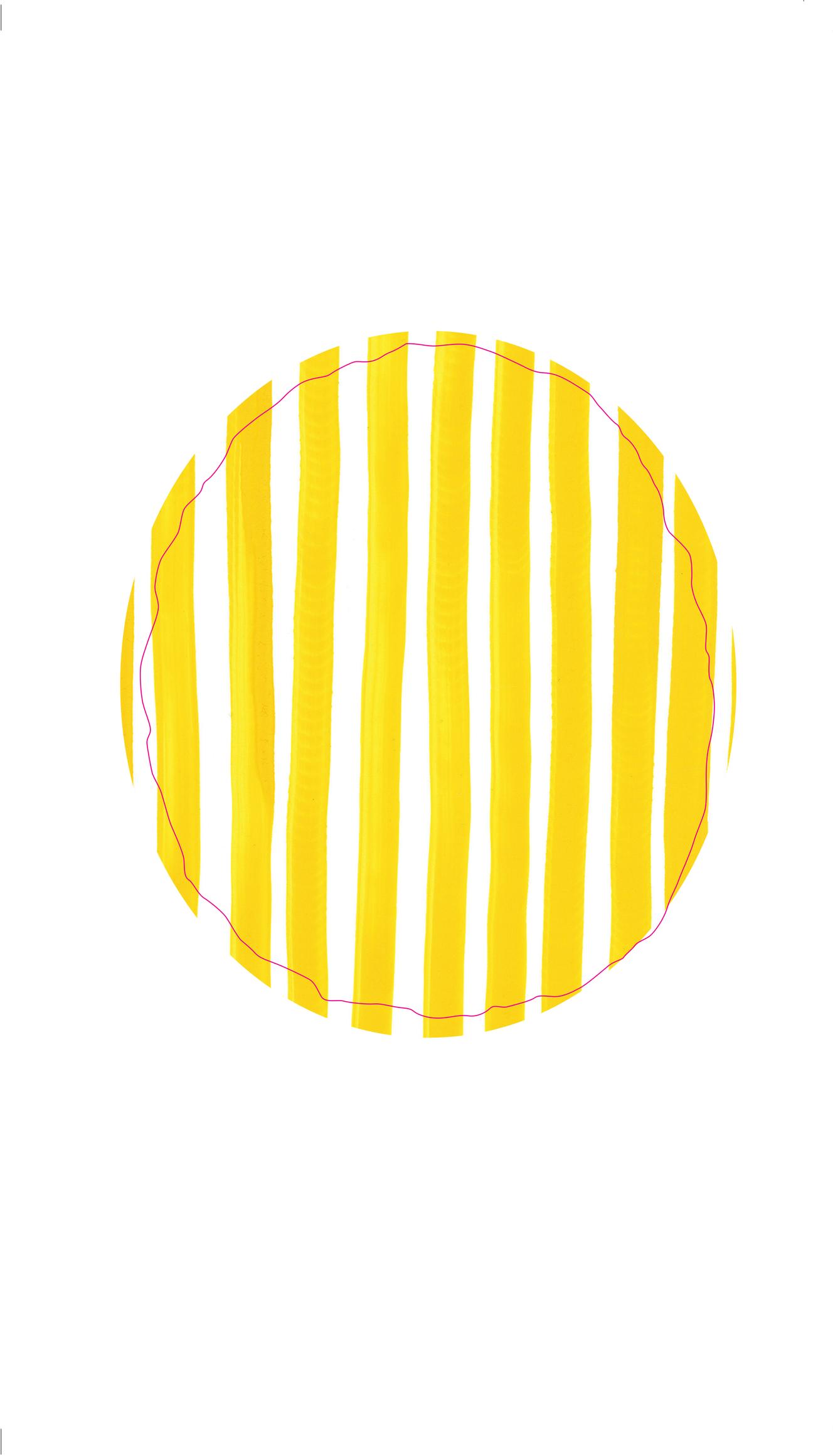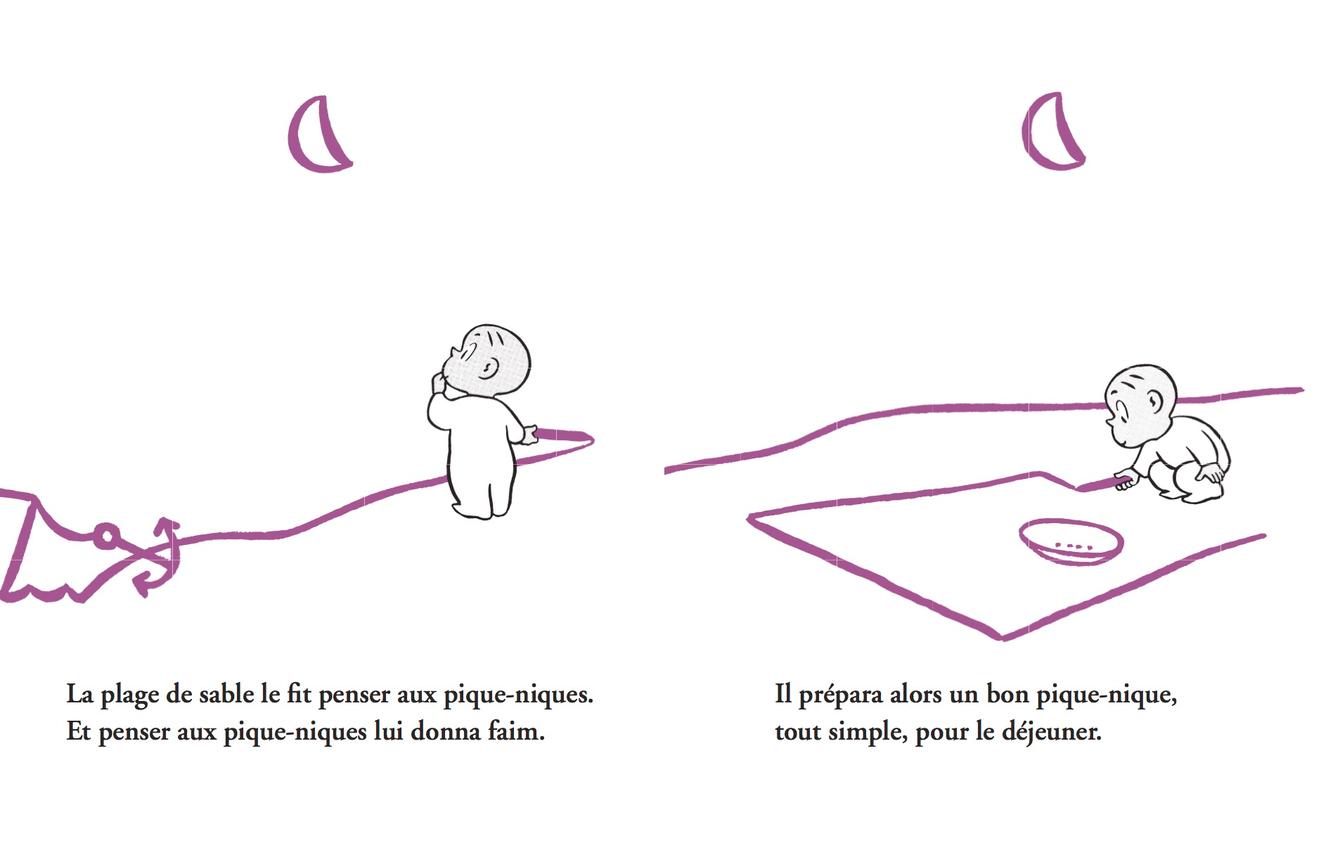FLORENCE MORIN-MARTEL Publié le 9 novembre 2021
QUEBEC

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE
« C’est un deuil impossible à faire quand on se lève tous les matins et l’on se dit qu’un homme est mort comme ça », souffle Mélanie Gélinas, au sujet du suicide de son frère, Jean-Sébastien Gélinas, à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas en 2018.
Depuis trois ans, au moins 17 patients se sont suicidés entre les murs d’un hôpital du Québec, selon une recension de La Presse. Plusieurs étaient justement hospitalisés en raison d’idées suicidaires. La situation risque d’empirer avec la pénurie de personnel qui sévit actuellement dans le réseau de la santé, prévient une experte.
« Comment se fait-il qu’une personne que tu envoies à l’hôpital pour une tentative de suicide soit capable de se suicider ? » C’est la question que se pose Suzy Bossé depuis que son frère, Marc Bossé, s’est donné la mort en décembre 2020 au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup.
Depuis 2018, au moins 17 personnes, dont M. Bossé, se sont suicidées dans un hôpital, selon une analyse des rapports du coroner effectuée par La Presse. Les lacunes recensées sont multiples : médicaments ou produits nocifs à portée de main des patients, mauvaise évaluation du risque suicidaire, notes au dossier mal consignées. « Il s’agit d’un suicide qui aurait pu être évité », note le coroner Pierre Guilmette au sujet d’un homme qui a avalé un désinfectant toxique.
Le risque suicidaire dans les hôpitaux « inquiète énormément » Jessica Rassy, professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. « Je l’entends sur le terrain, raconte-t-elle. C’est une situation qui vient chercher les infirmières qui n’ont pas pu offrir les services nécessaires par manque de temps et de ressources. »
Comment éviter ces morts ? C’est la question centrale d’une enquête publique du Bureau du coroner sur la thématique du suicide, dont le volet factuel s’est terminé en octobre. Entamées en 2019, les audiences publiques ont examiné six cas. La Presse en présente deux autres, qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête du coroner.




:quality(70):focal(2694x1865:2704x1875)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/UNXBXTYVXJFHHDXFLWM6HBIUAQ.jpg)

:quality(70):focal(1867x1684:1877x1694)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/CMUMVRHGD5AYRNWL4AZJ3XNDTQ.jpg)


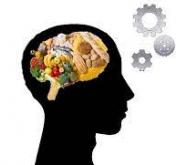

:quality(70):focal(3252x1856:3262x1866)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/JV4KKTVINREWXKYUGOV2ERDDDM.jpg)