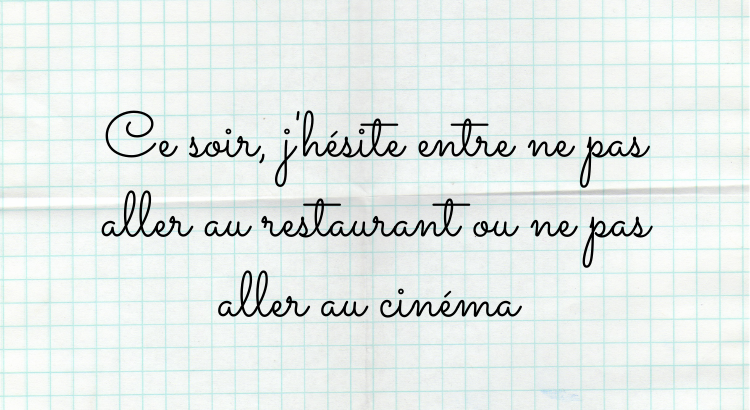Nous interpellons le Président de la République dans une tribune publiée dans le Journal Le Monde daté du mercredi 3 février […]
Monsieur le Président de la République,
Ces derniers mois ont mis en lumière, à travers la douloureuse crise sanitaire que nous connaissons, les insuffisances de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie. Des intubations ou des réanimations ont été imposées à des citoyens, certes âgés mais libres et résolus, à l’encontre de leurs directives anticipées ou de la parole de leur personne de confiance, mandatée à cet effet. Des polémiques ont été nourries et entretenues par des militants anti-choix à la suite des décrets parus sur l’utilisation du Rivotril (clonazepam). Des patients en fin de vie n’ont pas été respectés dans leur conscience et leur volonté. Beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées et l’angoisse s’est ajoutée au virus. Plus que jamais, la loi de 2016 a montré ses faiblesses et son inadaptation aux réalités de la fin de vie.
Ce n’est pourtant pas le corps médical qui est globalement responsable de ces situations qui provoquent des souffrances et nourrissent la crainte des Français à l’égard de leur propre fin de vie. Car la loi de 2016 rend les directives anticipées opposables mais non contraignantes, crée un droit au « laisser mourir » – par la sédation – dans les tout derniers jours de la vie mais refuse un droit au « faire mourir » – par l’euthanasie ou le suicide assisté – lorsque le pronostic vital est engagé, que les douleurs sont inapaisables et qu’aucun espoir ne subsiste et interdit à celles et ceux d’entre nous qui disposent de leur discernement le droit de décider eux-mêmes des conditions de leur propre fin de vie.
Dans le monde, plusieurs pays accordent à leur population la liberté de choisir leur fin de vie. Et cela, sans dérive… Depuis 2001, en Europe, de plus en plus de pays autorisent l’aide active à mourir : la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Cette année, l’Espagne, le Portugal et la très catholique Irlande ont entamé un processus législatif, avec le soutien de leur gouvernement, en direction d’une loi de liberté. En Allemagne, en Autriche et en Italie, des décisions des plus hautes juridictions ont ordonné de permettre l’aide active à mourir ; avant 2022, en ce qui concerne l’Autriche... En Grande-Bretagne, Boris Johnson semble vouloir libéraliser le sujet… Seule la Pologne reste figée sur des positions qui, loin de notre laïcité, évoquent la sacralité de la vie. Mais qui voudrait que la France ressemble à la Pologne d’aujourd’hui avec ses nombreuses atteintes aux droits de l’Homme ?
Lire la suite ...









:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/DQA4Z6NZYNATNBNM4QTEFQYXNE.jpg)