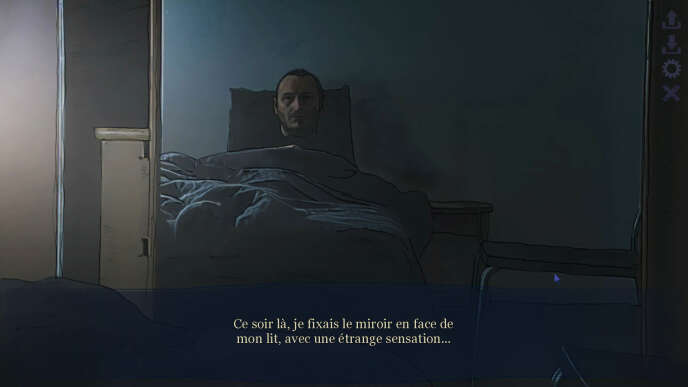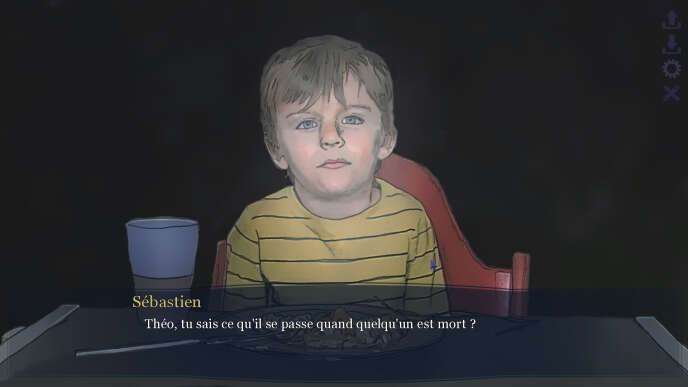La question ne cesse d'agiter les débats autour de l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes : les enfants élevés dans des familles homoparentales sont-ils aussi heureux et épanouis que les autres ? C'est une crainte brandie surtout par les opposants. Alors que l'article premier du projet de loi de bioéthique a été adopté à l'Assemblée nationale, vendredi 27 septembre, des députés dénoncent les risques d'une "PMA sans père", expression empruntée à La Manif pour tous.
[...] Quelle est l'étendue du corpus scientifique sur l'homoparentalité ?
L'homoparentalité est étudiée depuis une cinquantaine d'années. Au total, on recense quelque 700 études scientifiques sur le sujet, dont une petite partie consacrée au développement des enfants. Les toutes premières ont été lancées dans les années 1970, aux Etats-Unis, à la demande de magistrats et travailleurs sociaux, qui devaient décider s'ils pouvaient confier la garde d'un enfant à un parent homosexuel, notamment à la suite d'un divorce.
[...] Que disent ces études ?
Globalement, aucune ne démontre quoi que ce soit d'atypique chez les enfants élevés par des parents homosexuels. "Les recherches réalisées aux Etats-Unis et en Europe du Nord tendent à montrer qu'il n'y a pas d'impact majeur de l'homoparentalité sur le bien-être et le devenir psychologique des enfants", écrivent Olivier Vecho et Benoît Schneider. "On observe, ici et là, quelques différences, tantôt à l'avantage, tantôt au détriment des enfants. Mais au final, rien jusqu'ici ne permet de conclure à une plus grande vulnérabilité de ces enfants", nuance Olivier Vecho, dans le journal suisse Le Temps. Les enfants "ne se portent ni mieux, ni moins bien", confirme Martine Gross à franceinfo.