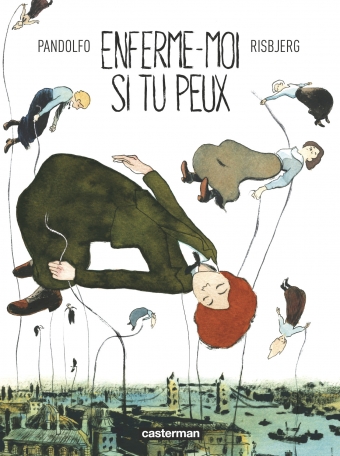18 novembre

En célébrant la Journée mondiale de la philosophie chaque année, le troisième jeudi de novembre, l'UNESCO souligne la valeur durable de la philosophie pour le développement de la pensée humaine, pour chaque culture et pour chaque individu.
En dehors d’être une discipline, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui peut transformer les sociétés et stimuler le dialogue des cultures. En éveillant à l’exercice de la pensée, à la confrontation raisonnée des opinions, la philosophie aide à bâtir une société plus tolérante et plus respectueuse. Elle permet ainsi de comprendre et d’apporter une réponse aux grands défis contemporains, en créant les conditions intellectuelles du changement.
L'UNESCO mène la Journée mondiale de la philosophie – mais ne la possède pas. Cette Journée appartient à toutes celles et tous ceux qui apprécient la philosophie.
En ce jour d'exercice collectif de la réflexion libre, raisonnée et informée sur les défis importants de notre temps, tous les partenaires de l'UNESCO sont encouragés à organiser des activités variées - dialogues philosophiques, discussions, conférences, ateliers, événements culturels et présentations diverses autour du thème général de la Journée avec la participation de philosophes, de scientifiques de toutes les branches des sciences sociales et naturelles, éducateurs, enseignants, étudiants, journalistes et autres représentants des médias et bien sûr du grand public.