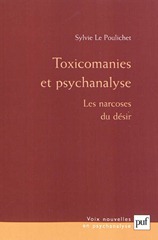Résister à la dérive sécuritaire de la psychiatrie - Entretien avec Philippe Bichon
29 juin 2011
Un grand pas en arrière. Le projet de loi adopté mardi 31 mai en seconde lecture à l’Assemblée nationale se veut relatif « aux droits, à la protection et à la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux ». Symptôme d’un retour à une conception réactionnaire de la folie et du « dessèchement » [1] de la psychiatrie, le texte introduit une série de mécanismes mordant dans les droits déjà fragilisés des patients : sanitaire et sécuritaire se confondent ; la « flichiatrie » s’immisce un peu plus profondément dans l’intimité des personnes ; la déshumanisation des soins efface peu à peu l’ empreinte des approches soignantes désaliénistes. Tout en saupoudrant ses propos d’exemples puisés de son expérience de la psychothérapie institutionnelle, Philippe Bichon, membre du Collectif des 39 Contre la Nuit Sécuritaire et psychiatre à la clinique de La borde revient ici sur la dérive de longue date de la psychiatrie, notamment sur l’aspect gestionnaire et la tendance à la disparition de la dimension relationnelle du soin, avant de parler des dangers et de l’absurdité de l’actuel projet de loi.
Le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire s’est formé en 2008. Quelles furent les raisons de sa création ?
Le collectif des 39 s’est formé en décembre 2008 suite au discours de Sarkozy dans l’hôpital psychiatrique d’Antony. En réaction au meurtre d’un étudiant à Grenoble par un malade lors d’une sortie de l’hôpital, il amalgamait à dessein schizophrénie, dangerosité et criminalité. Le mois suivant, une enveloppe de 70 millions d’euros a été débloquée pour construire des murs, des grillages, des chambres d’isolement et de la vidéo-surveillance. Un petit groupe, constitué par les personnes qui s’étaient investies en 2003 aux États généraux de la psychiatrie à Montpellier a réagi par un appel à pétition contre la nuit sécuritaire. Trente-neuf, parce que ce jour là il y avait trente-neuf personnes. Ce n’étaient pas trente-neuf psychiatres, contrairement à ce que l’on pense souvent du collectif : il s’agissait de professionnels de la psychiatrie ; soit des éducateurs, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres. Puis le groupe s’est élargi, et il y a maintenant des parents de malades et des anciens patients. Nous somme un collectif de professionnels et de citoyens qui essayons de résister à la dérive actuelle. Cette dernière mêle à la dérive de longue date de la psychiatrie une dérive sécuritaire on ne peut plus forte avec le projet de réforme de la loi sur la psychiatrie adopté en seconde lecture par l’Assemblée le 31 mai suite aux récentes modifications apportées par le Sénat.
Vous parlez d’une dérive de longue date...
Dans les années 1960-1970 s’est initié un fort mouvement d’ouverture de la psychiatrie vers la Cité, notamment avec la mise en place de ce que l’on appelle la psychiatrie de secteur, un système pensé par le mouvement de la psychothérapie institutionnelle (citons Daumézon et Jean Oury) et par des psychiatres désaliénistes comme Lucien Bonnafé. La psychiatrie de secteur s’appuie sur l’idée de sortir d’une vision hospitalocentrée en ouvrant l’hôpital sur la Cité, avec des centres médico-psychologiques (CMP) et des structures de suivi dans la cité : les hôpitaux de jour, les appartements thérapeutiques, les appartements accompagnés, entre autres. L’idée était de développer un système de soins de proximité et d’accompagnement sans avoir à démultiplier les intervenants (ce que l’on a appelé l’« équipe unique ») afin d’assurer des soins adaptés et continus entre l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier.
Néanmoins, on a constaté dès le début des années 1980, sous l’égide de la gauche, un virage gestionnaire dans la manière d’aborder la psychiatrie et d’administrer les établissements. Je me souviens avoir manifesté contre la mise en œuvre du forfait hospitalier, en 1982. Instaurer un tel forfait dans la secteur psychiatrique revient, pour les gens hospitalisés au long cours qui ne touchent que l’allocation adulte handicapé (laquelle est diminuée quand les allocataires sont hospitalisés), à leur enlever tout moyen de survie une fois la note d’hôpital payée. De plus, on a assisté tout au long des années 1980 à une énorme réduction du nombre de lits en hôpital psychiatrique sans que ne soit suffisamment travaillée l’insertion des malades dans la Cité : le déploiement de structures alternatives n’a pas compensé le manque de lits. Cela s’est fait avec une certaine complicité des psychiatres. En psychiatrie, une des bases de la maladie mentale est la chronicité, qui implique la nécessité d’organiser une continuité des soins pour un certain nombre de patients ; de penser la relation afin que les gens souffrants ne se replient pas sur eux même. Or, nombre des hôpitaux psychiatriques d’alors pratiquaient une sorte de tri à l’intérieur de l’hôpital où les malades étaient dispatchés dans différents pavillons en fonction de leur pathologie. On trouvait par exemple le pavillon des « aigus » ou le pavillon des « chroniques » pour lesquels aucun projet thérapeutique n’était mis en place et qui n’avaient en conséquence que peu de perspectives d’amélioration. La question était alors « que faire de ces chroniques » ?
Plutôt que de repenser les outils et les méthodes de travail dans l’hôpital, on a créé des Maisons d’accueil spécialisée (MAS), qui existent encore aujourd’hui : une manière de vider l’hôpital de ses « chroniques » en plaçant les gens dans des structures beaucoup moins médicalisées, avec très peu de médecins ni d’infirmiers. Des lieux qui ressemblent à de nouveaux asiles. Suite à la création de ces structures, la politique se centre alors autour de la Durée Moyenne de Séjour (DMS). Il faut soigner de plus en plus vite les malades et les remettre dans la cité. Mais les structures d’accueil, quelles qu’elles soient, étaient et restent insuffisantes. En conséquence, dans les années 1990, on a vu apparaître de plus en plus de fous dans la rue. Et en prison. La diminution des lits a été faite de manière beaucoup trop brutale. Il faut également ajouter que la question de soigner l’établissement a été évitée.
« Soigner » l’établissement …
Il s’agit d’une pratique liée à la psychothérapie institutionnelle. Jean Oury décrit très bien cela, le « blissement de l’Etat » où l’on observe dans les structures de soin une infiltration aliénatoire de l’État et des modèles institutionnels dominants. Le travail de la psychothérapie institutionnelle est de faire une différence entre rôle, statut et fonction ; de penser que la faculté soignante n’est pas incarnée par un statut. Quand un malade se fait aider par quelqu’un, quand il tisse une relation avec un autre, cela se base avant tout sur la singularité de cette personne. Ainsi, l’infirmier, l’aide-soignant mais aussi le cuisinier, l’homme d’entretien, les malades entre-eux peuvent développer une relation soignante. Or, dans l’hôpital, les statuts sont les statuts. Ici [à la clinique de La borde], pendant la visite d’accréditation, les inspecteurs voulaient que tout le monde ait un badge pour, disaient-ils, « que les gens sachent à qui ils ont à faire ». Mais les gens savent tout cela, ils sont capables de se parler. Ces inspecteurs, étaient en blouse - la blouse, j’appelle ça le prêt-à-porter défensif. Bref, à l’hôpital, la structure est pyramidale, hiérarchisé. Un agent des services hospitaliers (ASH) va être au plus près des corps des malades en venant faire le ménage dans leur chambre, mais il n’aura jamais accès aux réunions de soignants.
Jusque dans les années 1970, dans les hôpitaux psychiatriques, le médecin était médecin directeur de l’établissement. L’administratif était assujetti au médecin. Puis une bascule s’est produite, l’administration est revenue aux mains des technocrates. Exemple de l’horreur que ça peut produire : si on décide de faire une sortie à l’extérieur, le directeur de l’établissement peut s’opposer à ce qu’un ASH accompagne un groupe parce que ce n’est pas un soignant. Les directeurs d’établissement, qui ne font pas partie du processus soignant, dirigent sans tenir compte de l’ensemble. Cette infiltration de l’État dans le dispositif de soin le détruit : c’est cet aspect-là qui n’a pas été analysé à temps ; on a pas soigné cette maladie de l’hôpital ; on n’a pas soigné les directeurs – parce que ça rend fou, d’être directeur. Pourtant, les hôpitaux regorgeaient de gens formés à la psychanalyse, à la phénoménologie, mais qui n’avaient peut-être pas assez d’outils pour penser la dimension institutionnelle. D’ailleurs, les rares outils intégrés dans le secteur hospitalier et permettant de penser l’institution en articulation avec l’Établissement ont progressivement disparu. La psychothérapie institutionnelle avait par exemple inventé les « clubs thérapeutiques » dans le but de travailler les préjugés de dangerosité et d’irresponsabilité attribués aux malades mentaux. Un décret de loi en 1958 a permis la créations des « comités hospitaliers » : il s’agissait de structures paritaires rassemblant des travailleurs hospitaliers et des patients. Le but était de travailler l’ambiance à l’intérieur de l’établissement grâce à la gestion sous forme d’association 1901 d’une ligne budgétaire concernant l’ergothérapie et le pécule. C’était un outil de désaliénation sociale permettant d’inventer des activités collectives et de participer concrètement à la vie de quotidienne de l’établissement.
En 2000, soit-disant parce qu’il y avait des risques de détournement d’argent (les clubs perçoivent une subvention de l’établissement), les clubs ont bien failli être définitivement supprimés. C’est grâce à une bataille acharnée de l’Association croix-marines et du docteur Lecarpentier que les principes de la circulaire ont pu être intégrés dans le code de santé publique.
Les réformes de l’hôpital psychiatrique n’ont donc jamais pleinement pris en compte les apports des mouvements désaliénistes ?
L’influence de la psychiatrie de secteur a été prise en compte, mais en oubliant la question de la structure et du soin que l’on apporte à la structure. Il se disait à ce moment là « génial, on va s’installer en ville, on va désenclaver la folie, faire des hôpitaux de jours, des structures intermédiaires » sans véritable réflexion sur la structure même. On peut avoir de beaux hôpitaux de jour qui ne changent pas grand chose à l’approche de la folie. Le travail de « secteur » s’est développé dans de nombreux endroits mais a rencontré de sérieuses difficultés : il a été pensé clivé, à l’image de l’hôpital. Un clivage entre les équipes de soignants d’abord, puisque le travail de secteur a représenté pour les infirmiers un travail noble, en opposition à ceux de l’intra : ils quittaient l’hôpital pour faire des visites à domicile, les horaires n’étaient plus décalés... On observe également un morcellement et un cloisonnement des différents suivis thérapeutiques. À l’intérieur de l’hôpital, il existe un clivage entre les équipes de jour et les équipes de nuit, voire même entre une équipe du matin et celle de l’après-midi. Autre exemple : un type peut être suivi en même temps par un médecin dans un hôpital psy, par un second dans un centre médico- psychologique, et enfin par un troisième dans un hôpital de jour. Des usines à gaz appelées « secteur »...
Il est alors impossible d’établir une continuité dans la rencontre avec le malade. La clinique de La borde cherche au contraire à éviter ce cloisonnement. Les pensionnaires circulent librement d’un espace à un autre. Les moniteurs qui s’occupent de l’hôpital de jour travaillent aussi en intra-hospitalier, et ceux qui travaillent plutôt en intra peuvent accompagner des patients dans la cité. C’est d’une plus grande complexité. Dans certains secteur on a voulu simplifier, mais de manière peu adaptée. La continuité des soins ne peut exister que s’il s’agit d’une continuité humaine et non pas une continuité de « structures » ou de « dispositifs ».
En parallèle, on assiste à une montée en puissance du secteur médico-social constitué en partie de structures démédicalisées qui ne peuvent pas prendre en charge les personnes quand elles décompensent [2]. On observe de véritables parcours du combattant psychiatriques. Des gens qui sont passés dans je ne sais combien de structures à durée déterminée alors qu’il peut falloir 5 ou 10 ans de soin pour qu’une personne parvienne à sortir dans la cité. C’est aussi comme cela que les malades finissent dans la rue. Pour peut-être réapparaître en hospitalisation d’office [sous contrainte] car ils exploseront en ville. La clinique de La borde est considérée comme étant un hôpital psychiatrique, il y a donc des durées de court, moyen et long séjour. Mais si l’on considère qu’une personne ne peut pas être envoyée dans la cité, on ne l’enverra jamais dans un MAS, on continue. Et si c’est un vieux fou, on ne l’envoie pas en gériatrie car c’est ici qu’il a trouvé son équilibre. Il y a des fous qui sont arrivés à La Borde à 25 ans et qui resteront. Cela a un important effet thérapeutique : voir que l’on peut se poser là et que l’on va nous laisser tranquille, selon notre rythme, ça aide.
Dans les années 1990, après les externements abusifs, les hospitalisations à flux tendus, la disparition des clubs, l’arrêt de la formation et de l’internat en psychiatrie, l’arrêt de la formation des infirmiers-psy spécifique, la pression des nouvelles méthodes de management, l’apparition du principe de précaution, du risque zéro avec des soignants obligés de remplir de plus en plus de protocoles... bref, suite à la dégradation du milieu hospitalier, l’ambiance s’est détériorée dans l’hôpital et la violence est montée. Une violence avant tout institutionnelle qui déclenche une autre violence chez les patients et alimente le préjugé de dangerosité de la folie. En conséquence et également parce que les soignants ont peur et ne savent pas quoi faire, on a constaté de plus en plus de mises en chambre d’isolement ou en contention. En 1998, le contrôleur des lieux de privation de liberté a sorti un rapport incendiaire. En réaction, un protocole de mise en chambre d’isolement a été mis en place. Le résultat : une inflation de l’isolement des patients. Grâce au protocole, on peut isoler quelqu’un de façon « éthique ». D’ailleurs, à partir des années 2000, on a vu arriver à La borde de plus en plus de patients qui avaient eu dans leur trajectoire une mise en chambre d’isolement. Je pense que l’actuel projet de loi va avoir exactement le même effet : on va justifier la contrainte et l’on va observer une démultiplication de la contrainte.
Ce nouveau projet de loi se veut relatif « aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ». En réalité, on ne parle aucunement des droits des patients mais uniquement des modalités de leur prise en charge en facilitant « les hospitalisations sous contraintes », désormais désignées comme les « soins sans consentement »...
Lire la suite ici