Par Clara Georges Publié le 15 septembre 2022

En ville, on ne voit quasiment plus d’enfants seuls dans la rue. Pour aller à l’école, 97 % des élèves d’élémentaire sont accompagnés. Quatre spécialistes décryptent cette disparition progressive.
Vous souvenez-vous de l’âge auquel vous êtes sorti seul dans la rue pour la première fois ? Si vous êtes parent, il y a de fortes chances que ce grand moment d’autonomie soit survenu bien plus tôt que pour vos propres enfants. Les enfants seuls ont quasiment disparu des villes. Il suffit d’un chiffre pour donner la mesure du phénomène : en France, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 97 % des élèves d’élémentaire sont accompagnés pour se rendre à l’école, 77 % de ceux du collège, selon un sondage Harris Interactive pour l’Unicef réalisé en 2020. Dans un texte intitulé « Les risques de la rue », disponible en ligne, le ministère de l’intérieur recommande même aux parents d’éviter toute sortie non surveillée des enfants, comme une sorte d’institutionnalisation des peurs collectives : « Faites en sorte qu’il ne soit jamais seul. Faites-le accompagner par une personne de confiance. »
Comment et pourquoi nos enfants ont-ils disparu des rues des villes ? Nous avons posé la question à quatre spécialistes d’horizons différents.
Thierry Paquot est philosophe. Il a écrit plusieurs ouvrages traitant de la place des enfants dans le monde et dans la ville, dont son plus récent, Pays de l’enfance (Terre urbaine, 254 pages).
Clément Rivière est maître de conférences en sociologie à l’université de Lille, auteur de Leurs enfants dans la ville. Enquête auprès de parents à Paris et à Milan (Presses universitaires de Lyon, 2021).
Anne-Marie Rodenas a fondé le Cafézoïde – Café des enfants à Paris 19e, qui fête ce 18 septembre ses 20 ans. Un lieu associatif où tous les enfants de 0 à 16 ans sont libres de venir jouer, échanger, travailler à leur guise.
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste, membre de l’Académie des technologies. Il vient de publier Le Déni ou la fabrique de l’aveuglement (Albin Michel, 256 pages).
Les enfants des villes sont-ils devenus des enfants d’intérieur ?
Thierry Paquot Oui. Ils sont devenus des enfants d’un intérieur qui n’est pas forcément celui de l’appartement mais celui des activités extrascolaires : le conservatoire, les sports, les arts plastiques… C’est-à-dire qu’ils sortent pour être à nouveau enfermés. Les enfants sont confinés. Depuis deux ans, le mot est un peu galvaudé, mais c’est bien de cela qu’il s’agit.



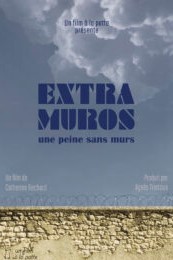






:quality(70):focal(280x266:290x276)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/7XK5V6JBZJEORACF4BA4FR6M2A.JPG)

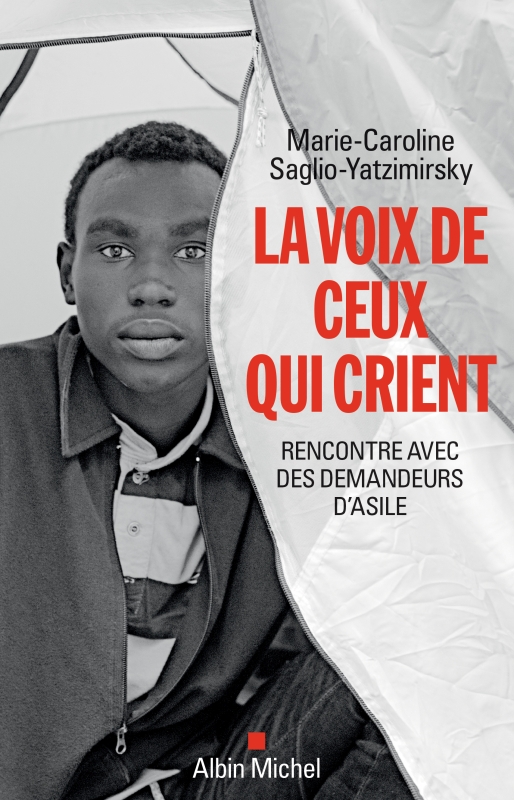






:quality(70):focal(3488x2561:3498x2571)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/VGUPG2GS7FEMLED4SLNZCCYV2E.jpg)






