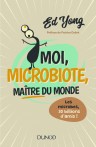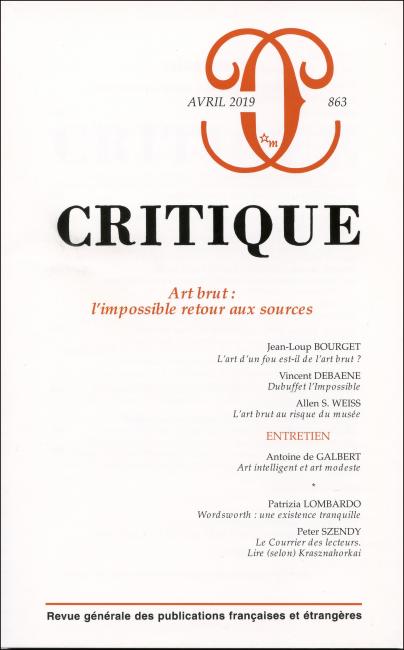Par Aurélia Abdelbost Publié le 10/04/2019
La maternité du Groupe hospitalier mutualiste (GHM) de Grenoble a installé au début du mois d'avril deux lits doubles pour permettre aux parents de vivre ensemble les premiers instants avec leur nouveau-né et de se sentir comme chez eux.
Des lits doubles à la maternité, c'est le défi que s'est lancé la maternité du Groupe hospitalier mutualiste (GHM) de Grenoble. Via une campagne de financement participatif, 7.000 euros ont été récoltés grâce à 130 donateurs et deux lits ont pu être installés au début du mois d'avril. Les parents vont pouvoir vivre ensemble les premiers instants avec leur nouveau-né et se sentir comme à la maison.
"Elle a pleuré de surprise"
"On a fait la surprise à la première maman qui a utilisé le lit double, on avait installé des ballons dans la chambre. Quand elle est arrivée, elle a pleuré de surprise. C'était génialissime. En plus, le couple habitait loin, à l'Alpe d'Huez, donc ils étaient vraiment ravis", raconte Alexandra Licina, cadre sage-femme qui a participé à la mise en place du projet.