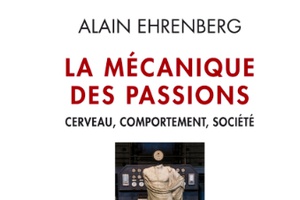Contre les invitations permanentes à « rebondir » après une maladie, un deuil ou un chagrin d’amour, la philosophe rappelle, dans un entretien au « Monde », à quel point les ruptures sont des blessures qui modifient en profondeur notre identité.
Entretien. Philosophe et professeure en classe préparatoire, Claire Marin publie Rupture(s) (Editions de l’Observatoire, 160 p., 16 €), une réflexion philosophique sur l’épreuve de la séparation, de la naissance à la rupture amoureuse. A rebours des discours qui veulent rendre l’échec positif à tout prix, elle explique pourquoi notre époque est autant façonnée par l’expérience de la perte.
En quel sens vivons-nous une « époque de la rupture », qui semble s’étendre de la catastrophe écologique à la disruption politique, en passant par la séparation amoureuse ?
En ce qu’elle s’expérimente désormais, comme vous venez de le dire, sur tous les plans de l’existence. Il y a peu de domaines stables, solides, sur lesquels nous pouvons compter avec certitude. Comme si plus rien, ni les relations, ni les engagements professionnels, amoureux, idéologiques, n’était fait pour durer. Et le théâtre de ces ruptures démultipliées, le monde au sens politique ou écologique, menace de s’effondrer. L’idée même de durée semble d’une autre époque. On valorise la flexibilité, l’adaptation, l’innovation, et on regarde les parcours continus comme s’il s’agissait d’existences paresseuses ou trop prudentes. On est bien loin de l’idée de persévérance. Nous sommes devenus tellement impatients et si facilement insatisfaits !
Or la durée, la continuité sont nécessaires aux relations qui construisent et qui réparent : l’éducation, le soin et tout ce qui permet à un enfant ou à un être fragilisé d’élaborer ou de restaurer une confiance en lui-même, en ses facultés, nécessitent un temps continu et irréductible. On ne peut plus continuer à fragmenter et à accélérer sans cesse nos vies. Il y a des relations fondatrices qui ne supportent pas la discontinuité et la multiplication des ruptures. On sait la souffrance des enfants placés et déplacés d’une famille d’accueil à l’autre, celle des exilés chassés par les conflits ou la misère. Il y a des liens primordiaux qui doivent être préservés. Comment s’orienter dans l’existence sans repères fondamentaux ?