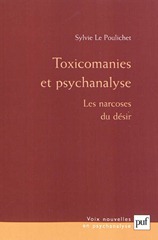Articles, témoignages, infos sur la psychiatrie, la psychanalyse, la clinique, etc.
mardi 5 juillet 2011
Présence du visage, pouvoirs des masques
Par Olivier Douville
Miroir , « Mi-voir ».
La thématique du visage suscite en chacun un sentiment contrasté et puissant :on redoute la perte du sentiment de soi dès qu’on se sent – y compris par soi-même- regardé de travers, on traque dans le visage déformé par des traces de grimages et des maquillages, une sensation de familier, presque plus puissante que celle que délivre toute assurance de familiarité.
Lire la suite ici
Les solutions professionnelles de SBT plébiscitées lors de la Conférence sur la remédiation cognitive en Psychiatrie :
| Communiqué |
Les solutions professionnelles de SBT plébiscitées lors de la Conférence sur la remédiation cognitive en Psychiatrie
de New-York.
Villeurbanne, le 05 juillet 2011
La 14ème conférence annuelle sur la remédiation cognitive en Psychiatrie (Annual Conference in Cognitive Remediation in Psychiatry) s’est tenue à New-York le 10 juin 2011.
Présent à la Conférence, SBT a bénéficié d’une large exposition, grâce notamment aux 4 posters, sur les 12 présentés au total, rendant compte des études scientifiques menées par des chercheurs indépendants, ayant utilisé le programme ScientificBrainTrainingPro et sa composante Psychiatrie (Programme RECOS), et en ayant validé l’utilité et la pertinence.
Le programme a également été présenté lors de deux conférences par Chris Bowie, de la Queens University, et Dani Heifetz, de la FEGS (Health and Human Services System).
Organisée par le Centre Médical de l’université de Columbia, cette conférence s’adresse chaque année aux professionnels de santé mentale, impliqués dans la recherche et le traitement des déficits cognitifs dans les maladies psychiatriques.
C’est donc très logiquement que SBT a tenu le haut du pavé, grâce au programme www.scientificbraintrainingpro.com, progiciel de remédiation et de rééducation cognitive, commercialisé pour la France par les Editions Créasoft, et notamment le programme RECOS, en partenariat avec le Dr Vianin, de l’Université de Lausanne, portant sur la remédiation cognitive dans la schizophrénie.
Lors d'une étude sur la schizophrénie par le Pr Bowie, les résultats ont montré un bénéfice plus important lorsque la remédiation cognitive commençait à un stade précoce de la maladie (Cognitive Remediation Early Episode vs. Chronic Outpatients with Schizophrenia, 2010-2011, Maya Gupta, Katherine Holshausen, & Christopher R. Bowie, Queen’s University, Poster).
Des résultats positifs sur la remédiation cognitive dans la schizophrénie, que devrait renforcer l’étude en cours du Pr Nicolas Franck, chef de service à l’hôpital du Vinatier de Bron (69) (RECOS, a specific cognitive remediation program for schizophrenia : validation vs CRT in a multicenter randomized equivalence trial, 2011, Pascal Vianin, Nicolas Franck, Charlotte Sundby et al.. Poster)
Une troisième étude portait sur les patients dépressifs résistants aux traitements (Neurocognitive Enhancement Therapy for Major Depressive Disorder, 2009-2010, Katherine Holshausen, Maya Gupta, Ruzica Jokic, & Christopher R. Bowie. Poster). Les résultats ont montré une amélioration significative des symptômes neurocognitifs, des performances de mémoire, de la stabilité de l’humeur et de la vitesse psychomotrice. De plus, les résultats s’amélioraient proportionnellement au temps passé sur le logiciel SBTpro.
De bons résultats confirmés par une autre étude sur la dépression, conduite par le Professeur Jouvent de l’hôpital La Pitié Salpêtière à Paris, qui a abouti à la conclusion que la remédiation cognitive pouvait faciliter la guérison de manière significative (Cognitive rehabilitation for depressed patients, 2008-2011, Pr. Roland Jouvent, Ouriel Grynszpan, Ph.D. et al., Poster).
De belles pistes pour l’amélioration des prises en charges dans ces deux pathologies complexes, qui renforcent la volonté de SBT de s’affirmer comme un acteur majeur de la remédiation cognitive dans le domaine de la Santé.
mercredi 29 juin 2011
Résister à la dérive sécuritaire de la psychiatrie - Entretien avec Philippe Bichon
29 juin 2011
Un grand pas en arrière. Le projet de loi adopté mardi 31 mai en seconde lecture à l’Assemblée nationale se veut relatif « aux droits, à la protection et à la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux ». Symptôme d’un retour à une conception réactionnaire de la folie et du « dessèchement » [1] de la psychiatrie, le texte introduit une série de mécanismes mordant dans les droits déjà fragilisés des patients : sanitaire et sécuritaire se confondent ; la « flichiatrie » s’immisce un peu plus profondément dans l’intimité des personnes ; la déshumanisation des soins efface peu à peu l’ empreinte des approches soignantes désaliénistes. Tout en saupoudrant ses propos d’exemples puisés de son expérience de la psychothérapie institutionnelle, Philippe Bichon, membre du Collectif des 39 Contre la Nuit Sécuritaire et psychiatre à la clinique de La borde revient ici sur la dérive de longue date de la psychiatrie, notamment sur l’aspect gestionnaire et la tendance à la disparition de la dimension relationnelle du soin, avant de parler des dangers et de l’absurdité de l’actuel projet de loi.
Le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire s’est formé en 2008. Quelles furent les raisons de sa création ?
Le collectif des 39 s’est formé en décembre 2008 suite au discours de Sarkozy dans l’hôpital psychiatrique d’Antony. En réaction au meurtre d’un étudiant à Grenoble par un malade lors d’une sortie de l’hôpital, il amalgamait à dessein schizophrénie, dangerosité et criminalité. Le mois suivant, une enveloppe de 70 millions d’euros a été débloquée pour construire des murs, des grillages, des chambres d’isolement et de la vidéo-surveillance. Un petit groupe, constitué par les personnes qui s’étaient investies en 2003 aux États généraux de la psychiatrie à Montpellier a réagi par un appel à pétition contre la nuit sécuritaire. Trente-neuf, parce que ce jour là il y avait trente-neuf personnes. Ce n’étaient pas trente-neuf psychiatres, contrairement à ce que l’on pense souvent du collectif : il s’agissait de professionnels de la psychiatrie ; soit des éducateurs, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres. Puis le groupe s’est élargi, et il y a maintenant des parents de malades et des anciens patients. Nous somme un collectif de professionnels et de citoyens qui essayons de résister à la dérive actuelle. Cette dernière mêle à la dérive de longue date de la psychiatrie une dérive sécuritaire on ne peut plus forte avec le projet de réforme de la loi sur la psychiatrie adopté en seconde lecture par l’Assemblée le 31 mai suite aux récentes modifications apportées par le Sénat.
Vous parlez d’une dérive de longue date...
Dans les années 1960-1970 s’est initié un fort mouvement d’ouverture de la psychiatrie vers la Cité, notamment avec la mise en place de ce que l’on appelle la psychiatrie de secteur, un système pensé par le mouvement de la psychothérapie institutionnelle (citons Daumézon et Jean Oury) et par des psychiatres désaliénistes comme Lucien Bonnafé. La psychiatrie de secteur s’appuie sur l’idée de sortir d’une vision hospitalocentrée en ouvrant l’hôpital sur la Cité, avec des centres médico-psychologiques (CMP) et des structures de suivi dans la cité : les hôpitaux de jour, les appartements thérapeutiques, les appartements accompagnés, entre autres. L’idée était de développer un système de soins de proximité et d’accompagnement sans avoir à démultiplier les intervenants (ce que l’on a appelé l’« équipe unique ») afin d’assurer des soins adaptés et continus entre l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier.
Néanmoins, on a constaté dès le début des années 1980, sous l’égide de la gauche, un virage gestionnaire dans la manière d’aborder la psychiatrie et d’administrer les établissements. Je me souviens avoir manifesté contre la mise en œuvre du forfait hospitalier, en 1982. Instaurer un tel forfait dans la secteur psychiatrique revient, pour les gens hospitalisés au long cours qui ne touchent que l’allocation adulte handicapé (laquelle est diminuée quand les allocataires sont hospitalisés), à leur enlever tout moyen de survie une fois la note d’hôpital payée. De plus, on a assisté tout au long des années 1980 à une énorme réduction du nombre de lits en hôpital psychiatrique sans que ne soit suffisamment travaillée l’insertion des malades dans la Cité : le déploiement de structures alternatives n’a pas compensé le manque de lits. Cela s’est fait avec une certaine complicité des psychiatres. En psychiatrie, une des bases de la maladie mentale est la chronicité, qui implique la nécessité d’organiser une continuité des soins pour un certain nombre de patients ; de penser la relation afin que les gens souffrants ne se replient pas sur eux même. Or, nombre des hôpitaux psychiatriques d’alors pratiquaient une sorte de tri à l’intérieur de l’hôpital où les malades étaient dispatchés dans différents pavillons en fonction de leur pathologie. On trouvait par exemple le pavillon des « aigus » ou le pavillon des « chroniques » pour lesquels aucun projet thérapeutique n’était mis en place et qui n’avaient en conséquence que peu de perspectives d’amélioration. La question était alors « que faire de ces chroniques » ?
Plutôt que de repenser les outils et les méthodes de travail dans l’hôpital, on a créé des Maisons d’accueil spécialisée (MAS), qui existent encore aujourd’hui : une manière de vider l’hôpital de ses « chroniques » en plaçant les gens dans des structures beaucoup moins médicalisées, avec très peu de médecins ni d’infirmiers. Des lieux qui ressemblent à de nouveaux asiles. Suite à la création de ces structures, la politique se centre alors autour de la Durée Moyenne de Séjour (DMS). Il faut soigner de plus en plus vite les malades et les remettre dans la cité. Mais les structures d’accueil, quelles qu’elles soient, étaient et restent insuffisantes. En conséquence, dans les années 1990, on a vu apparaître de plus en plus de fous dans la rue. Et en prison. La diminution des lits a été faite de manière beaucoup trop brutale. Il faut également ajouter que la question de soigner l’établissement a été évitée.
« Soigner » l’établissement …
Il s’agit d’une pratique liée à la psychothérapie institutionnelle. Jean Oury décrit très bien cela, le « blissement de l’Etat » où l’on observe dans les structures de soin une infiltration aliénatoire de l’État et des modèles institutionnels dominants. Le travail de la psychothérapie institutionnelle est de faire une différence entre rôle, statut et fonction ; de penser que la faculté soignante n’est pas incarnée par un statut. Quand un malade se fait aider par quelqu’un, quand il tisse une relation avec un autre, cela se base avant tout sur la singularité de cette personne. Ainsi, l’infirmier, l’aide-soignant mais aussi le cuisinier, l’homme d’entretien, les malades entre-eux peuvent développer une relation soignante. Or, dans l’hôpital, les statuts sont les statuts. Ici [à la clinique de La borde], pendant la visite d’accréditation, les inspecteurs voulaient que tout le monde ait un badge pour, disaient-ils, « que les gens sachent à qui ils ont à faire ». Mais les gens savent tout cela, ils sont capables de se parler. Ces inspecteurs, étaient en blouse - la blouse, j’appelle ça le prêt-à-porter défensif. Bref, à l’hôpital, la structure est pyramidale, hiérarchisé. Un agent des services hospitaliers (ASH) va être au plus près des corps des malades en venant faire le ménage dans leur chambre, mais il n’aura jamais accès aux réunions de soignants.
Jusque dans les années 1970, dans les hôpitaux psychiatriques, le médecin était médecin directeur de l’établissement. L’administratif était assujetti au médecin. Puis une bascule s’est produite, l’administration est revenue aux mains des technocrates. Exemple de l’horreur que ça peut produire : si on décide de faire une sortie à l’extérieur, le directeur de l’établissement peut s’opposer à ce qu’un ASH accompagne un groupe parce que ce n’est pas un soignant. Les directeurs d’établissement, qui ne font pas partie du processus soignant, dirigent sans tenir compte de l’ensemble. Cette infiltration de l’État dans le dispositif de soin le détruit : c’est cet aspect-là qui n’a pas été analysé à temps ; on a pas soigné cette maladie de l’hôpital ; on n’a pas soigné les directeurs – parce que ça rend fou, d’être directeur. Pourtant, les hôpitaux regorgeaient de gens formés à la psychanalyse, à la phénoménologie, mais qui n’avaient peut-être pas assez d’outils pour penser la dimension institutionnelle. D’ailleurs, les rares outils intégrés dans le secteur hospitalier et permettant de penser l’institution en articulation avec l’Établissement ont progressivement disparu. La psychothérapie institutionnelle avait par exemple inventé les « clubs thérapeutiques » dans le but de travailler les préjugés de dangerosité et d’irresponsabilité attribués aux malades mentaux. Un décret de loi en 1958 a permis la créations des « comités hospitaliers » : il s’agissait de structures paritaires rassemblant des travailleurs hospitaliers et des patients. Le but était de travailler l’ambiance à l’intérieur de l’établissement grâce à la gestion sous forme d’association 1901 d’une ligne budgétaire concernant l’ergothérapie et le pécule. C’était un outil de désaliénation sociale permettant d’inventer des activités collectives et de participer concrètement à la vie de quotidienne de l’établissement.
En 2000, soit-disant parce qu’il y avait des risques de détournement d’argent (les clubs perçoivent une subvention de l’établissement), les clubs ont bien failli être définitivement supprimés. C’est grâce à une bataille acharnée de l’Association croix-marines et du docteur Lecarpentier que les principes de la circulaire ont pu être intégrés dans le code de santé publique.
Les réformes de l’hôpital psychiatrique n’ont donc jamais pleinement pris en compte les apports des mouvements désaliénistes ?
L’influence de la psychiatrie de secteur a été prise en compte, mais en oubliant la question de la structure et du soin que l’on apporte à la structure. Il se disait à ce moment là « génial, on va s’installer en ville, on va désenclaver la folie, faire des hôpitaux de jours, des structures intermédiaires » sans véritable réflexion sur la structure même. On peut avoir de beaux hôpitaux de jour qui ne changent pas grand chose à l’approche de la folie. Le travail de « secteur » s’est développé dans de nombreux endroits mais a rencontré de sérieuses difficultés : il a été pensé clivé, à l’image de l’hôpital. Un clivage entre les équipes de soignants d’abord, puisque le travail de secteur a représenté pour les infirmiers un travail noble, en opposition à ceux de l’intra : ils quittaient l’hôpital pour faire des visites à domicile, les horaires n’étaient plus décalés... On observe également un morcellement et un cloisonnement des différents suivis thérapeutiques. À l’intérieur de l’hôpital, il existe un clivage entre les équipes de jour et les équipes de nuit, voire même entre une équipe du matin et celle de l’après-midi. Autre exemple : un type peut être suivi en même temps par un médecin dans un hôpital psy, par un second dans un centre médico- psychologique, et enfin par un troisième dans un hôpital de jour. Des usines à gaz appelées « secteur »...
Il est alors impossible d’établir une continuité dans la rencontre avec le malade. La clinique de La borde cherche au contraire à éviter ce cloisonnement. Les pensionnaires circulent librement d’un espace à un autre. Les moniteurs qui s’occupent de l’hôpital de jour travaillent aussi en intra-hospitalier, et ceux qui travaillent plutôt en intra peuvent accompagner des patients dans la cité. C’est d’une plus grande complexité. Dans certains secteur on a voulu simplifier, mais de manière peu adaptée. La continuité des soins ne peut exister que s’il s’agit d’une continuité humaine et non pas une continuité de « structures » ou de « dispositifs ».
En parallèle, on assiste à une montée en puissance du secteur médico-social constitué en partie de structures démédicalisées qui ne peuvent pas prendre en charge les personnes quand elles décompensent [2]. On observe de véritables parcours du combattant psychiatriques. Des gens qui sont passés dans je ne sais combien de structures à durée déterminée alors qu’il peut falloir 5 ou 10 ans de soin pour qu’une personne parvienne à sortir dans la cité. C’est aussi comme cela que les malades finissent dans la rue. Pour peut-être réapparaître en hospitalisation d’office [sous contrainte] car ils exploseront en ville. La clinique de La borde est considérée comme étant un hôpital psychiatrique, il y a donc des durées de court, moyen et long séjour. Mais si l’on considère qu’une personne ne peut pas être envoyée dans la cité, on ne l’enverra jamais dans un MAS, on continue. Et si c’est un vieux fou, on ne l’envoie pas en gériatrie car c’est ici qu’il a trouvé son équilibre. Il y a des fous qui sont arrivés à La Borde à 25 ans et qui resteront. Cela a un important effet thérapeutique : voir que l’on peut se poser là et que l’on va nous laisser tranquille, selon notre rythme, ça aide.
Dans les années 1990, après les externements abusifs, les hospitalisations à flux tendus, la disparition des clubs, l’arrêt de la formation et de l’internat en psychiatrie, l’arrêt de la formation des infirmiers-psy spécifique, la pression des nouvelles méthodes de management, l’apparition du principe de précaution, du risque zéro avec des soignants obligés de remplir de plus en plus de protocoles... bref, suite à la dégradation du milieu hospitalier, l’ambiance s’est détériorée dans l’hôpital et la violence est montée. Une violence avant tout institutionnelle qui déclenche une autre violence chez les patients et alimente le préjugé de dangerosité de la folie. En conséquence et également parce que les soignants ont peur et ne savent pas quoi faire, on a constaté de plus en plus de mises en chambre d’isolement ou en contention. En 1998, le contrôleur des lieux de privation de liberté a sorti un rapport incendiaire. En réaction, un protocole de mise en chambre d’isolement a été mis en place. Le résultat : une inflation de l’isolement des patients. Grâce au protocole, on peut isoler quelqu’un de façon « éthique ». D’ailleurs, à partir des années 2000, on a vu arriver à La borde de plus en plus de patients qui avaient eu dans leur trajectoire une mise en chambre d’isolement. Je pense que l’actuel projet de loi va avoir exactement le même effet : on va justifier la contrainte et l’on va observer une démultiplication de la contrainte.
Ce nouveau projet de loi se veut relatif « aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ». En réalité, on ne parle aucunement des droits des patients mais uniquement des modalités de leur prise en charge en facilitant « les hospitalisations sous contraintes », désormais désignées comme les « soins sans consentement »...
Lire la suite ici
Les Livres de Psychanalyse
… Pas sans le réel
H. Castanet, J-P Cometti, D. Commetti, I. Koch, G. Le Blanc, J-F Lyotard, S. Martin, H. Meschonnic, J-L Nancy, O. Rebufa.
Il particolare - Himeros
Mai 2011
Lire la suite ici
Lacan et la honte : de la honte à l'hontologie : étude psychanalytique
David Bernard
La honte, remarquait Jacques Lacan, «on s'en est longtemps tu», car «ce n'est pas de cette chose dont on parle le plus aisément». Le long silence de la psychanalyse à l'endroit de la honte suffit à le démontrer, à quoi semble s'opposer la multiplicité des travaux qui lui sont aujourd'hui consacrés. Ainsi, une question nouvelle surgit du lieu même de notre modernité : de quoi la honte nous fait-elle signe ?
Juin 2011 - Ed. du Champ lacanien, Paris
Collection In progress
Lire la suite ici
Juin 2011 - Ed. du Champ lacanien, Paris
Collection In progress
Lire la suite ici
La scientologie déchiffrée par la psychanalyse : la folie du fondateur L. Ron Hubbard
Thierry Lamote
Mai 2011 - Presses universitaires du Mirail-Toulouse, Toulouse
Étudier l'Église de Scientologie comme une «simple» entreprise à but lucratif - et Ron Hubbard comme un pur escroc, à la fois machiavélique et rationnel -, c'est rater une dimension essentielle : la Scientologie est avant tout le produit du système délirant construit par son fondateur, dont la personnalité psychotique a laissé de profondes empreintes sur l'organisation et la doctrine.
Lire la suite ici
La psychanalyse entre mots
Annie Franck
Mai 2011 - Hermann, Paris – Collection Psychanalyse
«Nous naissons pour ainsi dire provisoirement quelque part ; c'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y naître après coup, et chaque jour plus définitivement», écrit Rilke. Être au coeur de la recomposition des origines quand celles-ci semblent suspendues au dessus du chaos ou du vide, tel peut être le voyage de l'analyste dans la cure. Annie Franck évoque dans ce livre l'expérience transférentielle, alors qu'elle est confrontée aux limites du sujet, aux bords du corps, de la représentation et de la parole.
Lire la suite ici
Figures de la psychanalyse, n° 21 Direction de la cure
Erès
Mai 2011
Lire la suite ici
Lire la suite ici
Toxicomanies et psychanalyse : les narcoses du désir
Sylvie Le Poulichet
Mai 2011 - PUF, Paris – Collection Voix nouvelles en psychanalyse
La distance est grande entre les discours tenus sur la toxicomanie et l'expérience clinique que le psychanalyste acquiert de certains cas d'addiction toxicomaniaque dans sa pratique psychothérapique. Cette distance pourrait être négligée si le patient ne se trouvait pas lui-même pris dans la logique d'une pandémie sexuelle. Et le thérapeute peut-il échapper aux représentations de cette logique ?
Lire la suite ici
27 Juin 2011
Bonjour !
Aux braderies des occasions perdues, et en période de soldes, une certaine idée théorico-pratique de la psychiatrie risque de choir dans le caniveau, et ce n'est pas la faute à Rousseau. Elle est priée de se taire, et ce n'est pas la faute à Voltaire.
Proposée à l'ancan d'une vente forcée, elle n'a trouvé preneur que du côté des fourgues; ceci grâce à certains experts qui ont dissuadé les antiquaires d'en faire même une relique valable. La Psychiatrie Publique de Secteur, avec son approche humaniste, sociale, et ses pratiques holistiques et multidisciplinaires, pourrait presque écrire en lettres de sang sur les murs des asiles: "homard m'a tuer".
Car nous l'allons voir ci-dessous, le panier de crustacés à pinces coupantes a dit sa loi; au large les comiques du soin à base d'accueil et de relation, aux chiottes le transfert (cette fumisterie jadis inventée par un Autricien embourgeoisé, à seule fin d'ennuyer le Professeur Nimbfray), aux rancard les tocards, aux hangars les ringards!
Cette loi, comme ce l'était déjà en germe dans les lois de 1990 et aussi de 2005, pour les observateurs non aphaques, met en oeuvre des mesures non d'intérêt général, comme ce devrait être son éthique, mais ciblées. Pardonnez ce syllogisme: qui dit cible dit tireur, proie et chasseur... Je ne m'attarderai pas, néanmoins, sur les chasseurs (de voix populistes?), sur les prédateurs de chiasse, prêches, ratures et trahisons. Les diptères agités sur un merdier portent en eux l'insignifiance de leur vol erratique et de leur avidité.
Mais parlons du merdier lui-même.
- Rédigée pour satisfaire à une idéologie, la loi portant réforme des droits des malades en psychiatrie est raisonnable et juste (oh! plus tard les tomates pourries sur mon écran!!!!). raisonnable, car elle répond avec beaucoup de méticulosité à son réel objet, protéger le bon peuple frileux des avatars de la menaçante folie; juste, car elle donne à la majorité la protection majeure que la démagogie lui reconnait.
- Mort aux idéologies, proclament nos grands idéologues aveuglés par la leur. Aussi s'appuient-ils, pour légiférer (régenter?), sur celle-ci. Les personnes atteintes de psychose ne sont que 1,5 million, les vrais citoyens 59 millions. Elles sont souffrantes, peu votantes, égarées du sens commun, le plus souvent pauvres par la force des choses, et ne sauraient donc être détentrices du bon sens populaire; en bref elles ne sont pas le peuple... Moralité: "à traiter comme les autres minorités, en minorant notamment leurs droits et leur dignité"
- Pas plus que dans les autres champs du rejet social, les fous ne bénéficient de ce qui fait le lit de la démocratie, la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Et de la même manière, c'est le contentement ravi et ignorant de la masse qui est "ciblé" dans les mesures à leur encontre. Pour qu'une telle ignominie puisse advenir, ne faut-il pas des acteurs complices?
J'accuse les experts de tous poils de dévoyer la réflexion nécessaire au profit de points de vue consensuels dont les racines sont douteuses. J'accuse les importateurs de produits et denrées psychiâtriques anglo-saxonnes de menées scientistes et intéressées ainsi que de déni du sujet souffrant au profit d'efficiences de façade. J'accuse surtout la grande masse des "rampants", comme on dit en aviation, soumis de plein gré au service des planeurs universitaires, aux pilotes idéologues, aux "mirages" qui bombardent les savoir-faire du terrain des soins.
La psychiatrie française, combien de divisions ? (belle polysémie, non ?), aurait pu dire le démocrate régulateur staline... Une fois, une seule, en quarante ans, les gens qui s'occupent des soins aux malades psychosés se sont réunis et mis d'accord sur des fondamentaux; ce fut à l'occasion des Etats Généraux de Montpellier. Le bébé ainsi accouché est-il encore en couveuse, pour grande prématurité, ou mort-né ? Si on se rappelle que les propositions et motions faites à ce moment-là furent déléguées quasi immédiatement à des Purgons et Diafoirus, à des sous-commissions évoquant les badinages de la feu SDN, à des groupes pondeurs de rapports hermético-expertaux, on voit bien que ledit bébé a été jeté avant même l'eau du bain.
Ce texte ne se veut, malgré les apparences, ni jérémiade ni rodomontade, mais bien proposition d'un retour à la pensée partagée, à l'étude sérieuse de la situation, à l'élaboration des bases théoriques et des mouvements pratiques du soin. Et pas dans un champ miné d'évaluations, de certifications, d'accréditations, de bilans comptables, de pseudo-expertises, mais dans la reprise, sur les bases mêmes des derniers Etats Généraux de la psychiatrie, d'une véritable reconstruction de ce pourquoi nous sommes mandatés et existons en tant que professionnels... Engagés?
Jean Claude Duchêne, cuisinier amateur de ratatouille psy
Le gouvernement prépare un nouveau Plan de santé mentale
28 juin 2011
La secrétaire d’État à la Santé vient d'installer le comité d'orientation chargé d'élaborer un nouveau Plan de santé mentale.
La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, récemment adoptée par le Parlement, sera accompagnée d'un nouveau Plan psychiatrie – santé mentale. Le comité d'orientation a installé le 27 juin par Nora Berra, secrétaire d'Etat chargée de la Santé, a pour mission d'élaborer ce plan. Au-delà de ce nouveau plan, Nora Berra appelle de ses vœux un véritable « débat de société », qui questionne en profondeur « la capacité de notre société à reconnaitre, prendre en compte, accompagner les difficultés que les personnes traversent avec l'expérience de la maladie », afin de « garantir la citoyenneté et l'inclusion, malgré la pathologie et le handicap. »
Lire la suite ici
Lire la suite ici
Psychiatrie : un lourd transfert sur les familles
27 Juin 2011
Par Les invités de Mediapart
Par Les invités de Mediapart
La réforme de la loi sur les soins sans consentement innove en obligeant un malade à se soigner en dehors de l'hôpital. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la responsabilité sanitaire et sociale des familles, analyse Hélène Davtian, psychologue clinicienne et thérapeute familiale.
Lors des débats autour de la révision de la loi de 90, la question de ses effets sur la dynamique familiale a été peu évoquée. Dans le prolongement du travail que j'ai mené autour de la prise en compte de l'entourage des patients en psychiatrie et en particulier de leur entourage jeune voici quelques éléments de réflexion.
Tout d'abord il ne faut pas nier la dimension purement économique de cette approche déjà à l'œuvre dans d'autres pathologies (cancer, sclérose en plaques, AVC,..). Le basculement des soins de l'hôpital vers la cité, et plus précisément vers l'entourage familial, est une tendance forte dans lequel s'inscrit cette loi qui acte que les familles peuvent être une alternative à l'hôpital psychiatrique. La charge des familles en psychiatrie n'était-elle pas déjà suffisante ?
Les temps d'hospitalisation du patient représentaient pour les familles un temps de récupération et de répit où elles pouvaient être un peu attentives à leurs besoins et en particulier à ceux de l'entourage jeune ; avec cette loi, ce temps si précieux pour l'équilibre de chacun sera encore rogné. Et l'on semble oublier que ce temps de récupération des familles, après le stress intense vécu lors de la montée de la crise, est essentiel pour le patient lui-même. De nombreuses études (Julian Leff en particulier) ont établi une corrélation montrant que plus le niveau de stress était important dans la famille, plus le taux de rechutes était important pour le patient. Donc l'intérêt porté à l'entourage est aussi un intérêt porté au malade.
Concernant les familles en psychiatrie, l'augmentation de la charge sera de plus majorée par le fait qu'on attendra d'elles de gérer l'ordre public. En effet, si un malade commet un délit alors qu'il est en soin ambulatoire sans consentement chez ses parents, vers qui se tournera la victime pour demander justice ? Qui sera accusé de ne pas avoir alerté assez tôt, de ne pas avoir suffisamment surveillé les allées et venues du malade, voire de l'avoir laissé sortir ? L'Etat se dédouane des risques sécuritaires sur les familles alors qu'il rogne sans cesse sur les budgets de suivi et de soin aux malades et qu'il ne soutient pas les projets d'accompagnement des familles.
Sur le plan de l'organisation des soins ambulatoires sans consentement, les choses restent floues sur le qui fait quoi. Est-ce que ce sera aux membres de l'entourage de surveiller les entrées et sorties du malade ? La famille sera-t-elle placée dans un rôle de surveillant de son proche ? Sera-t-elle auxiliaire des soins (distribution des médicaments, hygiène corporelle,...), doit-elle assurer le gîte et le couvert (fonction qu'assure l'hôpital) ? Si le malade a un logement indépendant, attend-t-on de son entourage une action quelconque ?
En bref, qu'est-ce qui reste à la charge des soignants et qu'est-ce qui est à la charge de l'entourage ? Si l'on pousse plus loin : les aidants familiaux pourront-ils prétendre à une rétribution de leurs services (ce pour quoi milite l'association des aidants familiaux)? On peut imaginer que ceci aura forcément des répercussions sur les relations et le climat familial.
Pour en revenir précisément à la question du sans-consentement, on sait que majoritairement ces situations de danger pour autrui se jouent en direction de l'entourage proche et familial. Or, on légifère sur des événements intervenus dans l'espace public (Grenoble...), alors que la question du danger sur autrui dans la psychose relève le plus souvent de la sphère intime : résultat, on renvoie les malades dans le lieu où ils sont le plus susceptibles d'être violents. Il y a donc un paradoxe que beaucoup de familles que j'ai suivies vivent déjà « votre fils est trop malade pour notre structure, on ne peut pas le gérer, reprenez-le » ; « votre frère est trop dangereux, on n'a pas les moyens de le prendre en charge ». En dix ans de travail auprès des familles, j'ai en tête de nombreux drames dans les familles.
Ce paradoxe vient aussi d'une méconnaissance de la nature de cette violence par ceux qui légifèrent. Tant que cette violence sera traitée comme un acte délinquant à éradiquer, les réponses seront absurdes et inefficaces.
Ce paradoxe en effet est encore plus flagrant en direction de l'entourage jeune des patients (enfants et frères et sœurs). Alors que, du fait de leur jeune âge, ils n'ont pas la possibilité de visiter leur proche malade quand il est hospitalisé, les soins ambulatoires sans consentement feront qu'à l'extrême ils seront dans un contact quotidien avec lui au moment où ses symptômes et son angoisse le débordent et sont projetés sur son entourage. Ils étaient tenus à l'écart, ils seront inclus : deux positions tout aussi excessives et dangereuses.
Il faudrait au minimum exiger, avant de prendre une décision de soin en ambulatoire sans consentement, que l'on prenne en compte la configuration familiale et que l'on travaille avec tous les membres de la famille qui vivent sous le même toit (et pas uniquement ceux qui sont en position adultes de décideurs et d'interlocuteurs).
C'est à la société et aux adultes de protéger les jeunes. Cette loi renforce leur proximité avec la souffrance psychotique et nie ses retentissements sur la santé et l'équilibre de ces jeunes. En évacuant cette question, elle va totalement à l'encontre du travail que l'Unafam avait amorcé en direction des jeunes proches.
Enfin, concernant le climat familial, on peut se demander sur qui porte le non-consentement, sur le patient ou sur ses proches, et qu'en est-il si un des proches vivant sous le même toit ne se sent pas en capacité d'assurer cette charge, est-ce à lui de partir ? (C'est ce que font beaucoup de frères et sœurs: « je lui ai laissé ma famille et moi je n'en ai plus », ai-je entendu). Par ailleurs mettre l'entourage et notamment les jeunes en position de choisir peut les plonger dans des conflits de loyauté vis-à-vis de leur proche malade qui seront très couteux psychiquement et affectivement: « si tu refuses, à cause de toi je serai obligé de rester à l'hôpital ».
Mais surtout on sait que pour une personne souffrant de troubles psychotiques, toute intrusion dans son intimité est une violence. Violence qui peut en engendrer d'autres et le plus souvent envers elle-même. Leur seul refuge est leur chambre, leur studio. Faire de leur seul lieu d'intimité un lieu possible de privation de liberté me semble éthiquement contestable et représente une solution de court terme qui se paiera dans le long terme. Que leur restera-t-il comme espace de liberté : la rue, l'errance ?
On peut anticiper une augmentation du recours au sans consentement, car à quoi bon s'en priver alors que c'est si simple et que ça dédouane les soignants mais bien plus la société et les politiques.
Certes par cette loi les familles peuvent se sentir reconnues, mais à quoi bon être reconnu si le renforcement de la charge augmente et si cela induit une instrumentalisation des aidants familiaux?
Par ailleurs, quelles contre parties seront exigées à l'aide fournie gratuitement par les familles (d'ailleurs cette aide n'a-t-elle jamais été évaluée depuis la réduction des lits en psychiatrie : De 300 jours par an en moyenne par patient à moins de 30 jours de soin en institution actuellement?) ? Accès gratuit à des groupes de parole? Psychothérapie de soutien (comme dans certains réseaux ville hôpital pour le cancer)? Appui professionnel pour soutenir les familles dans les démarches d'hospitalisation en cas de crise comme le propose la Ffapamm, (équivalent de l'Unafam au Québec) ? Ou juste des ateliers d'entraide fonctionnant sur la bonne volonté d'une poignée de bénévoles, mais qui permettent à l'état de dire: « on vous a aidé, maintenant débrouillez-vous ».
Il faudrait arrêter de banaliser les troubles psychotiques en niant leur dimension projective. En cette période où l'on fait face aux effets d'une crise nucléaire majeure, je dirai que le trouble psychotique a ceci de bien particulier qu'il émet des radiations sur l'entourage, parfois sans laisser de traces apparentes. « J'ai absorbé ses délires comme une éponge », « j'étais la confidente de tous ses délires » sont des phrases qui revenaient constamment dans mon travail auprès des jeunes proches. Toutes les équipes soignantes en psychiatrie le savent, le Dr Racamier dans sa formation aux équipes le disaient: « celui qui côtoie le malade peut avoir la sensation de vivre en perpétuel déséquilibre, dans l'incertitude, l'étrangeté, la perplexité, de ne rien comprendre, d'être dans le flou et la confusion ». On ne peut pas exposer les familles et notamment les jeunes mineurs de l'entourage du malade sans soutien, sans information spécifique, sans temps de répit.
Le plus étonnant, c'est que le pendant de cette banalisation pour les familles est la dramatisation de chaque fait divers impliquant une personne souffrant de troubles psychotiques. Comme me disait un garçon de 13 ans dont le père souffrait de troubles bipolaires sévères « pourquoi il existe des cellules psychologiques quand il y a un accident et pour moi il n'y a rien! ».
Banalisation à l'intérieur des familles, dramatisation sur l'espace public : il faut sortir de ces positions extrêmes et infondées et arrêter de légiférer sur l'émotion. Il faut prendre toutes les données du problème, être attentifs à toutes les personnes impliquées dans la situation. Rassembler et non pas diviser.
Hélène Davtian, psychologue clinicienne et thérapeute familiale.
A été pendant 10 ans au siège national de l'Unafam
chargée du développement de l'aide aux familles en psychiatrie.
Essai : La rue des précaires, Soins psychiques et précarités de Jean-Pierre Martin
lundi 27 juin 2011La « souffrance psychique » des « exclus » est devenu un sujet sur lequel se penche la compassion médiatique. Mais c’est aussi une réalité que côtoient quotidiennement travailleurs sociaux ou professionnels de santé engagés dans l’aide ou le soin à ces hommes et ces femmes « en trop ».
À partir de son expérience de psychiatre de service public et de militant, Jean-Pierre Martin montre les dangers d’une approche de l’errance qui la transformerait en « trouble du comportement » relevant de réponses normatives, de traitements ou de soins imposés.
C’est pourtant dans cette voie que sont aujourd’hui engagés la psychiatrie et le travail social, sous l’impulsion des politiques libérales qui opèrent le basculement de l’État « social » à l’État « pénal ». C’est aussi celle qui menace « l’humanitaire ».
Le livre fournit une analyse précise des effets désastreux, pour les pratiques d’aides et de soin, de la soumission des institutions sanitaires et sociales au « management » et aux politiques sécuritaires.
Il montre également les alternatives qui ont pu se construire, notamment avec les équipes « psychiatrie précarité », et leur démarche d’aller vers ceux qui ne demandent rien. Le soin commence par être un « prendre soin », de personnes qu’il ne s’agit pas d’invalider mais de respecter.
Ce livre, au-delà des professionnels de la psychiatrie et de l’action sociale, concerne les militants intéressés par la dimension subjective de la misère et de la précarité.
Jean-Claude Delavigne
Érès
Au ministère de la Santé, on ne remplace pas les fonctionnaires qui partent
La règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux a été pratiquement respectée en 2010 (48,4% selon le rapport du député Gilles Carrez. Cent mille fonctionnaires sont ainsi partis sur la période 2009-2011. En 2012, 30.401 suppressions de poste sont prévues. Le document qu’à rédigé le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée Natiuonale pointe toutefois «des différences entre ministères assez surprenantes». Le taux de remplacement varie ainsi de plus de 100% de partants non remplacés aux ministère des Affaires étrangères et de la Santé à 21% à la Culture et 23% dans les services du Premier ministre. Le rapport Carrez montre que l’économie budgétaire est limitée pour l’Etat, du fait notamment des primes versées aux agents restants. Et il s'étonne que paradoxalement, les ministères pour lesquels la règle de non remplacement a été la plus stricte (Santé, Affaires étrangères ou Agriculture), sont aussi ceux pour lesquels les mesures catégorielles bénéficiant aux agents restants ont été les plus faibles.
“A 30 kg, l’urgence est médicale avant d’être psychologique” : Marcel Rufo, pédopsychiatre, spécialiste de l’adolescence
Marcel Rufo, pédopsychiatre spécialiste de l'adolescence SIPA
FRANCE-SOIR Peut-on faire une erreur de diagnostic sur une anorexique qui se présente aux urgences ?
MARCEL RUFO Ça me semble difficile. Quand une jeune fille pèse 30 kg et n’a pas de cancer, il n’y a pas d’autre option. Le problème est ailleurs : paradoxalement, les cas extrêmes d’anorexie suscitent un rejet de la part de beaucoup de médecins.
F.-S. Pourquoi ?
M. R. L’anorexie est le seul cas ou le patient aime sa maladie. Les jeunes filles, souvent, ne veulent pas se soigner et sont capables de toutes les manipulations pour tromper les médecins. Dans n’importe quelle autre maladie, le patient collabore. Trop souvent, les anorexiques sont considérées comme responsables de ce qui leur arrive. Comme si elles avaient choisi de ne plus manger. Hélas, la maladie est plus forte qu’elles. Il ne faut pas leur en vouloir de leurs stratégies d’évitement, qui font partie intégrante des troubles de l’alimentation.
F.-S. Quelles sont-elles, ces stratégies ?
M. R. Elles cachent les aliments, font semblant de manger, parlent beaucoup de nourriture pour tromper leurs interlocuteurs. Elles promettent, manipulent… Le mécanisme fonctionne malgré elles. Et lorsque la manipulation échoue, elles s’effondrent. Tant qu’elles manipulent, elles sont vivantes. A l’hôpital, par exemple, au moment de la pesée, certaines boivent deux ou trois litres d’eau pour augmenter temporairement leur poids. Il faut penser à surveiller le ballonnement de leur ventre. Avec l’anorexie, il faut être extrêmement vigilant à tout. Et, surtout, il faut soigner la maladie, mais ne pas attaquer l’anorexique.
F.-S. Aurélie est morte d’un arrêt cardiaque. Est-ce une cause fréquente de décès chez ces patientes ?
M. R. Les décès représentent entre 5 et 22 % des anorexiques. Les autres guérissent, même si 40 % d’entre elles rechutent avant de guérir totalement. Plusieurs causes médicales sont responsables des décès, comme un affaiblissement de la résistance de l’organisme aux infections pulmonaires par exemple. Les troubles cardiaques interviennent souvent lorsque les jeunes filles se font vomir. Le cœur est un muscle, qui peut donc maigrir et rétrécir. De plus, ces patientes manquent de potassium, qui alimente le moteur électrique cardiaque. Le rythme cardiaque se ralentit. Les vomissements forcent alors sur un cœur épuisé.
F.-S. Que devrait faire un service d’urgence non spécialisé lorsqu’il voit arriver une jeune fille autour de 30 kg ? Certains les transfèrent immédiatement en psychiatrie…
M. R. Dans ces cas-là, l’urgence est médicale avant d’être psychologique. Et c’est un psy qui vous le dit ! La seule chose à faire est de les envoyer en réanimation, de leur poser une sonde pour les alimenter et de surveiller leurs paramètres organiques. Mais cela implique de les accueillir sans peur, et avec bienveillance. Ensuite, quand elles ont repris 3 kg, on peut les transférer dans une unité spécialisée qui offre une prise en charge globale, tant sur le plan psychologique, qu’endocrinologique. Elles auront alors la force psychologique pour l’affronter.
Lire la suite ici
mardi 28 juin 2011
Le gène de l'épilepsie identifié
LEMONDE.FR avec AFP | 27.06.11
La double hélice de l'ADN.AFP/HO
Une équipe de chercheurs américains et marseillais ont identifié un gène clé dans le mécanisme de transformation d'un cerveau sain en cerveau épileptique, a annoncé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans un communiqué.
Menés par le neurobiologiste Christophe Bernard, directeur de recherche Inserm à l'hôpital de la Timone, en collaboration avec un laboratoire californien, les travaux ont porté sur sa forme la plus fréquente chez l'adulte : l'épilepsie du lobe frontal (ELT), qui résiste à tout traitement pharmacologique dans 30 % des cas.
L'étude affirme que la neutralisation de ce gène chez des rats mène à des "bénéfices thérapeutiques immédiats". Cette découverte ouvre la voie à des traitements préventifs chez les personnes risquant de développer une épilepsie à la suite d'une affection du cerveau de type méningite ou traumatisme crânien.
Le Magazine Littéraire
Annie Le Brun : « L'actuelle bonne conscience se veut à la fois subversive et normative »
24/06/2011
Entretien
Poétesse aux accents surréalistes, figure intellectuelle à l’esprit incisif et polémique, exégète notamment de Sade, Alfred Jarry et Raymond Roussel, Annie Le Brun n’a de cesse d’explorer les marges comme d’autres sondent les lignes de faille. Son dernier livre, Ailleurs et autrement (paru récemment chez Gallimard), revient, au fil de chroniques publiées dans La Quinzaine littéraire durant la dernière décennie, sur ses engagements littéraires et idéologiques. L’occasion d’une rencontre avec l’auteur des Châteaux de la subversion.
Bon nombre des textes d’Ailleurs et autrement s’inscrivent dans la dénonciation d’une époque de la «fausse conscience» à la «subversion subventionnée», une période où la poésie même paraît menacée. Dans ce contexte, faut-il selon vous repenser le lien historique qui l’unit à la Résistance ?
Annie Le Brun. Dans ce livre, il n’y a rien de délibéré concernant l’articulation dont vous parlez puisqu’il s’agit de la réunion d’articles portant sur les sujets les plus divers mais dont la succession chronologique sur une dizaine d’années n’en rend pas moins compte d’une critique se développant à l’encontre d’une sorte de simulation critique qui est désormais une posture comme une autre. Ainsi me paraît-il insupportable qu’à tout propos on parle de «Résistance», en se référant implicitement ou non à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. C’est encore une de ces approximations, au bout du compte monstrueuses, qui en dit long sur la fausse conscience devenue norme. Et, à l’évidence, la littérature en participe, sans parler de la mômerie intitulée «Printemps des poètes», dès lors qu’elle ne se propose pas d’abord d’échapper à la confusion, mieux de la combattre en se tournant vers de tout autres horizons.
Lire la suite ici
Lire la suite ici
Inscription à :
Articles (Atom)