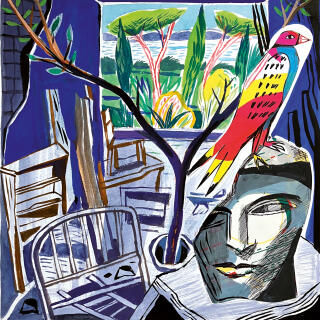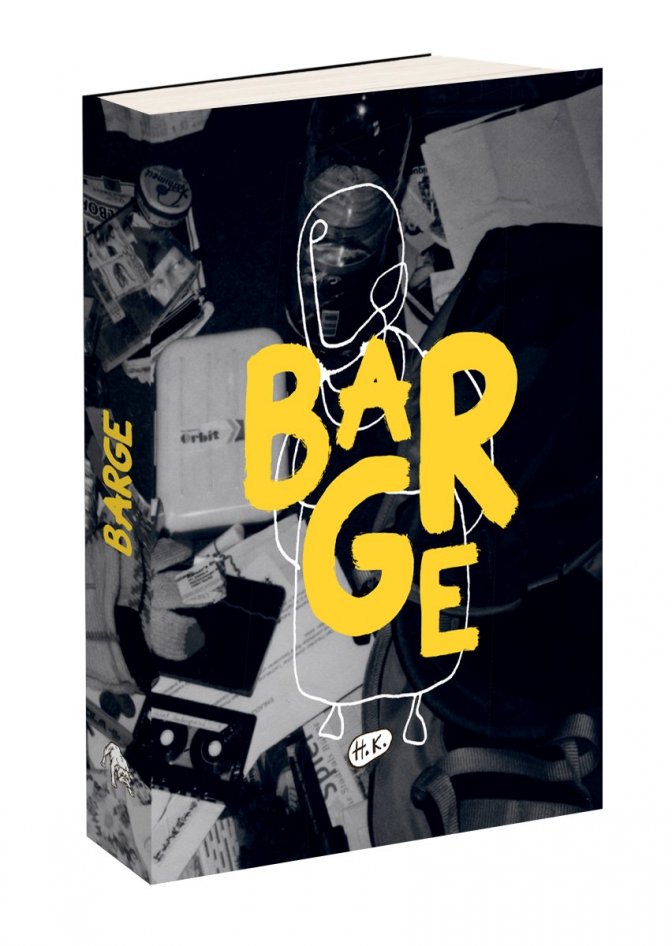Publié en ligne le 8 janvier 2024
PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE /
Chronique de Jacques Van Rillaer
Carl Gustav Jung (1875-1961) est un médecin suisse, dont le nom évoque la « psychanalyse jungienne » et la « psychologie analytique ». Il a grandi dans un milieu imprégné de croyances irrationnelles. Son père était pasteur protestant. Son grand-père maternel, également pasteur, prétendait être en relation avec des esprits. Dans son bureau, un siège était réservé à l’esprit de sa première femme qui venait lui rendre visite chaque semaine [1]. À l’âge de 23 ans, Jung a participé à un groupe qui effectuait des expériences de spiritisme avec, pour médium, sa cousine Hélène Preiswerk. Il a alors dévoré des écrits sur la parapsychologie. Il a consacré sa thèse de doctorat en médecine à la psychologie des phénomènes occultes. Il a toujours gardé un très vif intérêt pour ces phénomènes.
Le psychiatre
Jung s’est formé à la psychiatrie à partir de 1900 au Burghölzli, le prestigieux hôpital psychiatrique de l’université de Zurich. Le directeur était alors Eugen Bleuler, un des psychiatres les plus célèbres d’Europe. En 1902-1903, Jung fit un stage d’un semestre à la Salpêtrière, chez Pierre Janet. Il en revint avec l’idée de Janet selon laquelle il y a, en particulier chez les malades mentaux, des « idées fixes subconscientes », à forte valeur affective, qui se comportent comme des personnalités parcellaires dans l’inconscient.
Bleuler a invité Jung à réaliser des recherches avec le test des associations verbales qu’avait imaginé Sir Francis Galton, puis développé le psychiatre Theodor Ziehen. L’expérimentateur prononce une série de mots soigneusement choisis. Le sujet doit à chaque fois énoncer le premier mot qui lui vient à l’esprit. Pour Ziehen, un long temps de réaction permet de détecter des « complexes de représentations émotivement chargées » dont le sujet n’a pas habituellement conscience 1.
Jung a notamment constaté la ressemblance des réponses données par les pères et les fils et, d’autre part, par les mères et les filles. Il a estimé que le test permet d’explorer l’inconscient. Il a pensé que c’était un moyen de détecter des criminels, mais a fini par se rendre compte que c’était une méthode problématique. Le test des associations verbales, comme les autres techniques projectives qui viendront après lui, laisse trop de place à l’interprétation de l’investigateur et à la projection de ses propres idées. Jung, qui a travaillé pendant plusieurs années à ce test, a publié en 1906 un livre à son sujet puis a abandonné sa pratique.
Le psychanalyste
En 1900, Bleuler a demandé à Jung de rendre compte du livre de Freud sur les rêves. Jung s’est alors intéressé aux publications de Freud. Dans son ouvrage sur la démence précoce (1906), Jung écrit qu’il ne partage pas les idées de Freud sur l’importance de la sexualité. Pour lui, la thérapie de Freud est « tout au plus une méthode possible ». Néanmoins, il a envoyé son livre sur les associations à Freud en 1906 et est allé le voir l’année suivante à Vienne. Les deux hommes ont été enchantés de se rencontrer. Jung croyait que Freud allait révolutionner la psychologie. Freud se réjouissait de la reconnaissance que lui apportait le numéro deux du célèbre hôpital de Zurich. Il voyait en Jung le moyen, pour sa psychanalyse, d’appartenir à la communauté scientifique de la psychiatrie et d’échapper à la critique d’être une « science juive ». Il a rapidement considéré Jung comme son héritier. Il lui écrivait en 1909 : « Vous serez celui qui comme Josué, si je suis Moïse, prendra possession de la terre promise de la psychiatrie » [2] et à Binswanger deux ans plus tard : « Si l’empire que j’ai fondé devenait orphelin, nul autre que Jung devrait hériter de tout. Vous voyez, ma politique poursuit inlassablement ce but » [3]. Il s’est arrangé pour que Jung devienne en 1910 le premier président de l’Association psychanalytique internationale et le rédacteur en chef de la première revue de psychanalyse.
Toutefois, comme le note le célèbre historien de la psychiatrie, Henri Ellenberger : « Dès le début, leurs relations furent entachées d’un malentendu fondamental. Freud exigeait de ses disciples qu’ils acceptent sa pensée sans réserve. Bleuler et Jung envisageaient leurs relations avec Freud comme une collaboration où chacun conserverait son entière liberté. Au début, les relations entre Freud et Jung se trouvèrent facilitées par une bonne volonté réciproque. Jung avait le tempérament avenant et souple de son grand-père ; Freud était disposé à se montrer patient et à faire des concessions, tout en restant intraitable sur sa théorie du complexe d’Œdipe et de la libido. Mais c’étaient là précisément des idées que Jung n’accepta jamais » [1].
Des divergences de vue étaient apparues dès les premières rencontres. Jung écrit dans son autobiographie : « Mon travail pratique m’avait fait connaître de nombreux cas de névroses dans lesquels la sexualité ne jouait qu’un rôle secondaire, alors que d’autres facteurs y occupaient la première place : par exemple, le problème de l’adaptation sociale, de l’oppression par des circonstances tragiques de la vie, les exigences du prestige, etc. Plus tard, j’ai présenté à Freud des cas de ce genre mais il ne voulait admettre, comme cause, aucun autre facteur que la sexualité. J’en fus très peu satisfait » [4].
Lire la suite ...


:quality(70):focal(668x2066:678x2076)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KK6L2ZC4HJFCRGGVLLCW447ZYU.JPG)