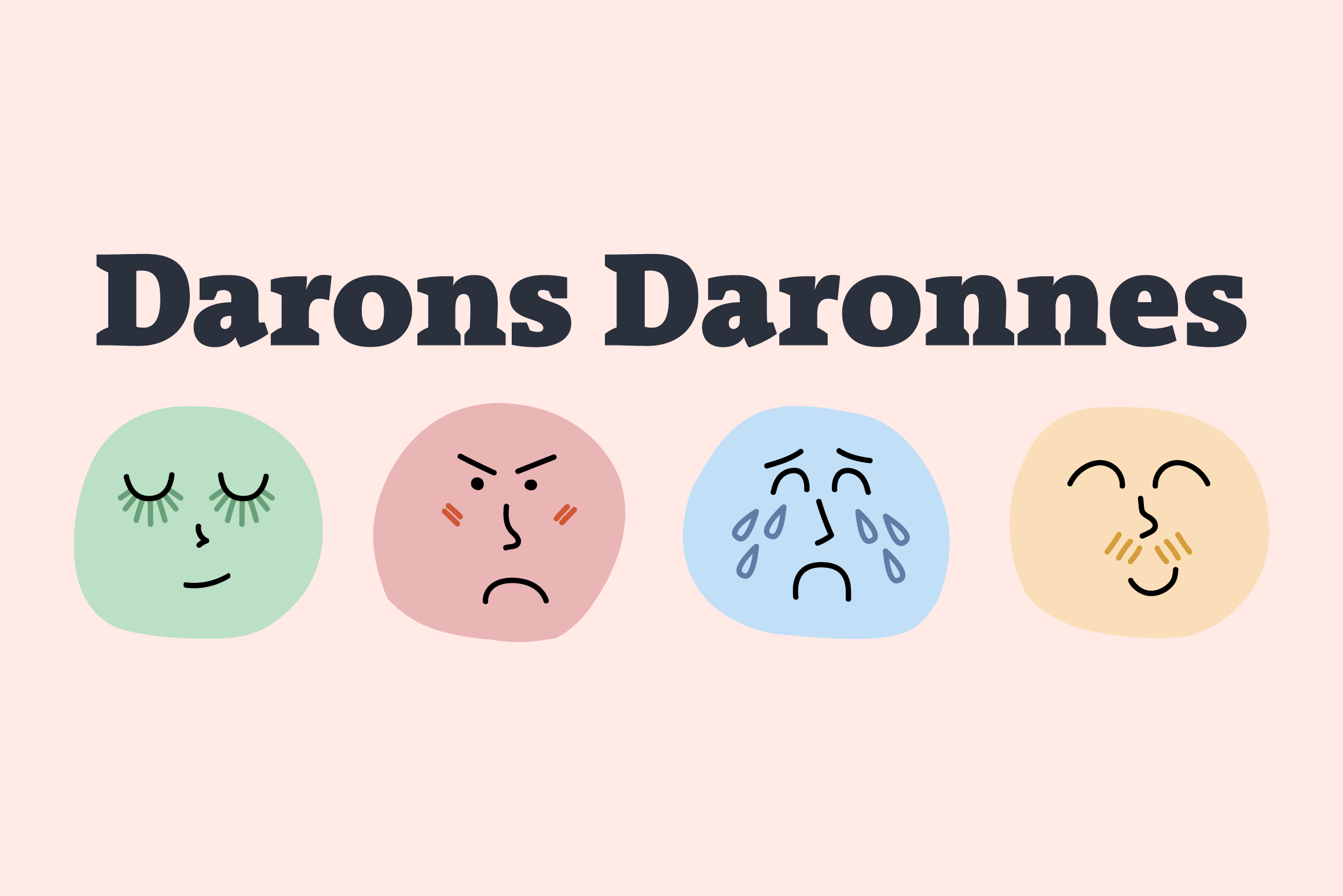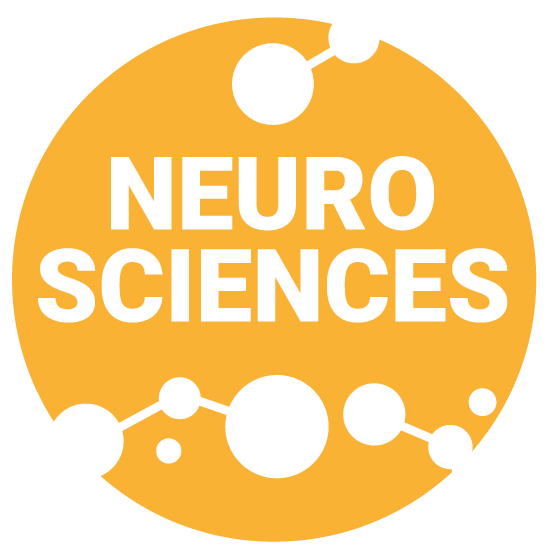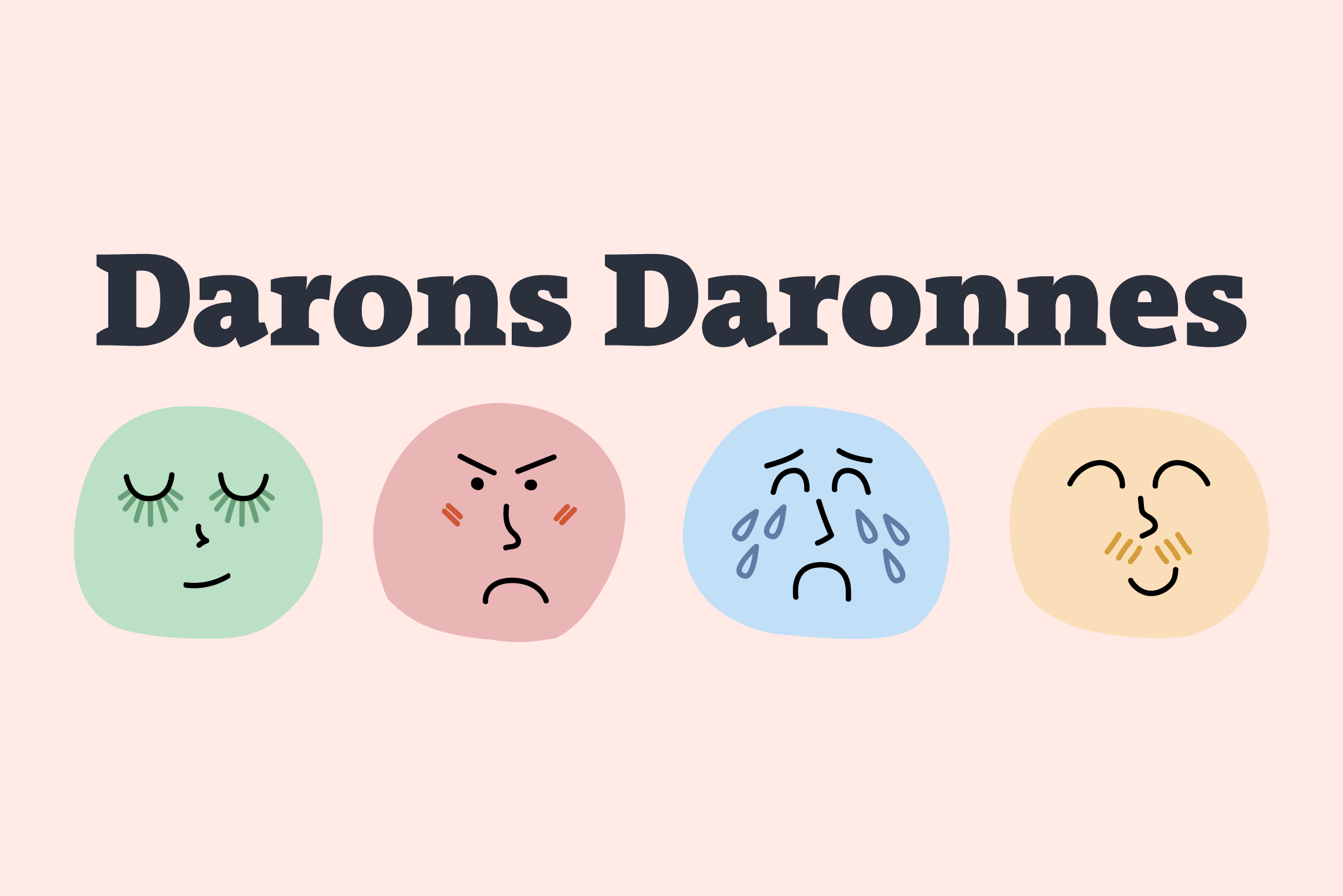
Je ne sais pas vous, mais j’ai un peu de mal à atterrir en 2024. J’ai passé la première semaine à souhaiter à tout le monde une bonne année 2023. Et il m’a fallu m’arracher à cet état flottant dans lequel m’avaient plongée les vacances avec les enfants. Bien sûr, il y a l’habituel blues du dimanche soir, la crainte d’être à la merci d’heures qui s’écoulent trop vite, après avoir savouré un temps sans contrainte.
En y réfléchissant, je crois cependant que c’est autre chose que je n’avais pas envie de quitter. J’adore Noël chaque année, un peu plus depuis que j’ai des enfants. Pourquoi ? Parce qu’à cette période mes enfants m’ouvrent un passage vers mon passé. Comme si, avec leur propre bonheur, leur émerveillement, ils se frayaient un chemin jusqu’à mon enfance, et faisaient surgir en moi les sensations de l’époque, oubliées et pourtant intactes, conservées dans une petite boîte au creux de mon âme.
Il y a évidemment la nuit de Noël, le dîner des adultes avec ces éclats de rire, ces odeurs mêlées de nourriture, de parfums et d’alcool (mais plus de cigarettes !) ; le coucher tardif, et le réveil le 25 au matin, avec la découverte extraordinaire des cadeaux, qui nous permet de continuer à croire que le monde recèle une part de magie.
Mais cette année, ce retour à l’enfance s’est aussi niché ailleurs pour nous. Nous avons eu la chance de passer le Nouvel An à Londres (à ceux qui le peuvent, je recommande vivement le système d’échange d’appartements), et d’y assister à une représentation de Mon voisin Totoro dans la salle de spectacles du Barbican Centre. C’est une adaptation scénique du film du Japonais Hayao Miyazaki (1988) par la Royal Shakespeare Company et Joe Hisaishi. Une amie me l’avait vivement conseillée, et j’avais réservé sans trop y repenser ensuite, faute de temps. Nous avons donc atterri un soir dans cette salle des années 1970 avec mon compagnon et mes trois enfants de 8, 6 et 4 ans.
C’est peu dire que nous avons été émus. A peine les portes fermées, nous avons été emportés, swept off our feet, comme diraient les Anglais, dans un univers où le merveilleux devient tangible. Quand apparaît sur scène pour la première fois Totoro, cette gigantesque bestiole poilue, ronflant de tout son soûl, j’ai pleuré d’émotion. Mon fils de 4 ans a poussé des éclats de rire de joie pure, tandis que toute la salle a frémi d’un murmure d’émerveillement. C’était comme redevenir un enfant, pour de vrai, pendant presque trois heures.
Lire la suite ...



:quality(70):focal(2196x2277:2206x2287)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/SZBTTQHTYNFZTOQK7QIQP7N6BI.jpg)