Véronique Duqueroy 21 février 2024
Depuis trois ans, la Dre Pauline Seriot, urgentiste en service hospitalier et collaboratrice de Medscape , exerce comme médecin référent dans le cadre de combats de MMA.
La Fédération de MMA Française ( FMMAF ) définit le MMA ( Mixed Martial Arts) comme un sport de combat basé sur des techniques issues de divers arts martiaux et sports de combat comme le judo, le jiu jitsu brésilien, la lutte et la boxe.
La Dre Seriot a accepté de répondre à nos questions sur son activité de médecin de cage* : quelles sont ses responsabilités en tant que médecin dans le déroulement des combats ? Quels sont les défis ? Quid des combats féminins ? Quel regard ses confrères portent sur ce type de pratique médicale ? Interview
*Le terme de « médecin de cage » est celui employé par l'UFC (Ultimate Fighting Championship) qui est reconnue comme la plus importante ligue mondiale de MMA.
Medscape : Quelles sont les compétences requises pour être médecin référent en combat de MMA ?

Dre Pauline Seriot
Crédit : Yann Levy / Hexagone MMA
Dre Pauline Seriot : Le préalable est d'être médecin urgentiste, il faut savoir parer à toute éventualité, mais il n’y a pas de formation spécifique à proprement parler. Vous apprenez sur le tas, en immersion, au contact des intervenants que vous rencontrez ― officiels (juges, arbitres), cutmen ― idéalement en suivant un autre médecin référent. Il faut également bien connaître le Code sportif du MMA. Cela nécessite donc les compétences médicales, mais aussi une bonne connaissance du domaine sportif. L’expérience vient avec le temps. J’ai maintenant 100 médicalisations [surveillance médicale de combats] à mon actif.




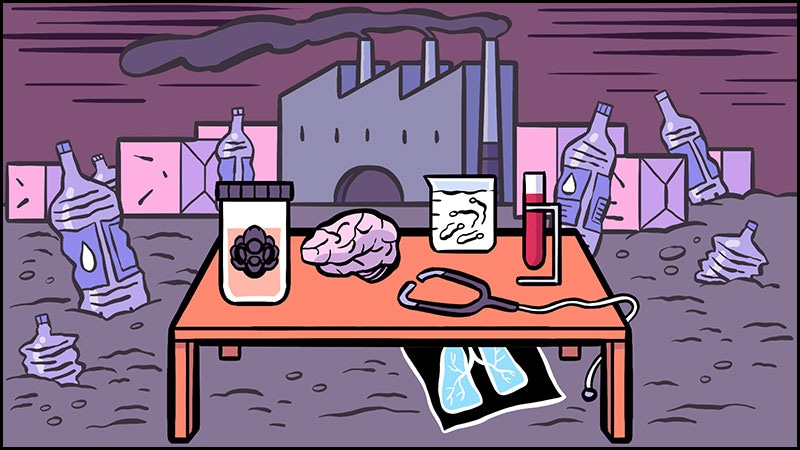







:quality(70):focal(1295x1945:1305x1955)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/RREGHG55IBCHJCKYJOUFJRMXKU.jpg)








