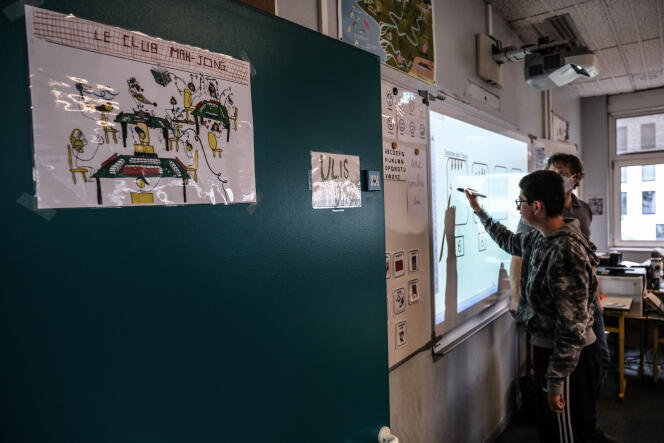Dimanche 30 octobre 2022
L'Esprit public
Une convention citoyenne sera lancée le 9 décembre. Les conclusions seront rendues en mars 2023. La question posée est la suivante : "Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?"
- Dominique Schnapper sociologue et politologue, directrice d'étude à l'EHESS
- Monique Canto-Sperber Philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l’ENS et ancienne présidente de l'université Paris sciences et lettres (PSL), auteure de plusieurs ouvrages de philosophie antique et philosophie morale contemporaine
- Frédéric Worms Professeur de philosophie contemporaine à l’ENS, directeur adjoint du département des Lettres et membre du Comité consultatif national d’éthique, producteur à France Culture
- Catherine Vincent ex journaliste au monde et désormais indépendante. Elle se consacre notamment aux sujets du vieillissement et au grand âge. Elle fait partie des membres fondateurs du CNaV (Conseil national autoproclamé de la vieillesse).
En Belgique, huit personnes meurent chaque jour par choix, avec l’assistance d’un médecin. Ce pays de 11 millions d’habitants a compté l’an dernier 2700 euthanasies, soit 2,5 % du nombre total de décès. Dans 84 % des cas, la mort était attendue à brève échéance.
L’euthanasie en Belgique est un acte individuel, à l’initiative du patient seul, qui doit en formuler personnellement la demande à un médecin, en toute lucidité et conscience et sans pression extérieure. Cette pratique ne fait plus guère débat aujourd’hui. Wilfried Martens, Premier ministre belge pendant 12 ans et leader des chrétiens-démocrates opposés à la loi, est mort euthanasié en 2013. Il souffrait d’un cancer du pancréas.



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/423GDFQ7EFHLNPZ2EFGSU7L7HA.jpg)