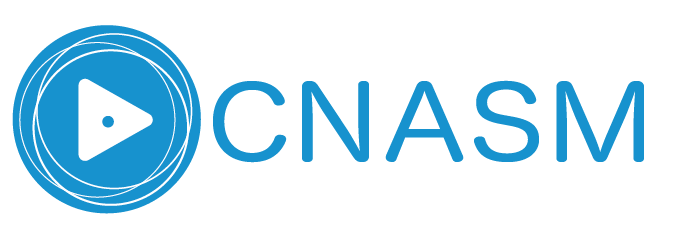Ce sont eux qui ont à chaque fois fait changer l’équation alors qu’on pensait avoir maîtrisé l’épidémie. Les variants ont surgi au fil des mois et de l’évolution du Sars-CoV-2. Mais pendant que le Covid-19 repart pour une nouvelle vague en France et en Europe, aucune mutation majeure ne semble pour l’instant renverser la table sanitaire comme l’a fait le variant delta au printemps. On peut donc légitimement se demander si le virus responsable du Covid-19 continue à évoluer ? Oui, répond Etienne Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur, mais delta, actuellement dominant, écrase toute la concurrence. Pour le moment. Le scientifique fait le point pour Libération sur les variants récemment détectés et sur le potentiel évolutif du Sars-CoV-2.
L’absence de nouveau variant majeur signifie-t-elle que le Sars-CoV-2 évolue moins vite qu’avant ?
Le virus évolue toujours à la même vitesse. Il accumule environ deux changements dans son génome tous les mois. Les variants préoccupants sont souvent des anomalies de ce point de vue. Ils présentent un nombre de mutations important par rapport à leurs ancêtres les plus proches, comme si on avait manqué ces intermédiaires, ce qui complique l’identification de leur origine.
Mais le risque d’apparition d’un variant est réduit grâce à l’augmentation de la proportion de personnes immunisées. Les infections des personnes vaccinées – souvent plus de cinq ou six mois après la deuxième dose – sont de plus courte durée et intensité, ce qui réduit les occasions du virus de faire des erreurs et qu’un nouveau variant soit transmis.
Ceci est à pondérer avec une partie de la population mondiale qui n’a pas eu la chance d’avoir accès au vaccin. Ensuite, on ne sait pas encore si ce coronavirus pourra évoluer pour échapper suffisamment au système immunitaire tout en conservant une bonne capacité de transmissibilité, et se diffuser de façon significative dans la pandémie.
Si un nouveau variant survient, sera-t-il nécessairement un descendant de delta ?
C’est très probable car le variant delta est hégémonique en Europe et en Amérique du Nord. Mais il existe encore des zones où d’autres variants circulent : en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Par exemple, le variant Mu [découvert en Colombie, ndlr] ne l’était pas. Mais «delta plus», AY.1 et AY.4.2, le sont. Aujourd’hui, les Anglais sont attentifs au variant AY.4.2, qu’ils soupçonnent d’être légèrement plus transmissible que le delta. Mais pour le moment, aucun de ces variants n’a de combinaisons de mutations associées à un changement de caractéristique majeur.
Les variants alpha et delta avaient pour point commun d’être 50 % plus transmissibles que le variant dominant. Est-il vraiment possible de voir arriver un variant 50 % plus transmissible que delta ?
Il est difficile de répondre à cette question. Nous ne connaissons pas le potentiel évolutif de ce virus. Il est vrai que delta nous pose déjà beaucoup de problèmes. Plus le virus circule, plus le hasard peut générer des combinaisons de mutations et peut-être que l’une d’entre elles lui permettra de battre delta. Ou peut-être le pic a-t-il déjà été atteint…
Le variant B.1.640, responsable d’un cluster en Bretagne en octobre, est-il dangereux ?
Il s’agit d’un variant sous surveillance, mais il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour le moment. Il a été détecté en France, mais aussi en Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis. Les séquences les plus anciennes ont été retrouvées au Congo.
B.1.640 est sous surveillance en raison de son apparition dans plusieurs territoires largement dominés par le variant delta. Il présente aussi beaucoup de mutations dans la protéine de spicule à la surface du virus, et des mutations associées à de l’échappement immunitaire chez d’autres variants.
Est-ce que le système de surveillance français a bien réagi face à ce cluster ?
Oui. L’un des cas était lié à un voyage au Congo et la réaction rapide des autorités de santé a permis d’éviter que virus s’échappe largement de ce cluster. C’est un l’un des buts de cette surveillance. Malgré cela, ce variant a déjà été repéré ailleurs en France, à Paris et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Aujourd’hui, le système est confronté à un nouveau problème, celui d’obtenir un échantillon viable du variant pour le caractériser complètement. Dans leur routine, les laboratoires de ville ne conservent pas le virus dans un état qui permette son étude approfondie. Ils le désactivent tout de suite.
Pour un spécialiste de l’évolution des génomes des virus comme vous, cette pandémie est une grande première. Jamais l’émergence d’un virus n’a été aussi documentée. Quelle leçon en tirez-vous ?
En effet, dans beaucoup de pays, les efforts de séquençage ont atteint un volume très élevé. A tel point que l’on voit les limites des outils que l’on utilisait jusqu’ici. Jusqu’à présent les plus gros jeux de données dont nous disposions pour le VIH, Ebola, ou la grippe comportaient seulement quelques milliers de séquences. Pour le Sars-CoV-2, on en a déjà presque cinq millions ! On est obligé de développer des nouveaux outils.
D’ailleurs, la communauté scientifique se demande si l’on a vraiment besoin d’autant de séquences, ou si l’on peut capturer les mêmes paramètres épidémiologiques et d’évolution avec une fraction de ces données.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/L42GNBGBGZGBHCDXHLEUWW4TYA.jpg)


:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/3KVMI5YTTBG6BELA6YWZL2LR64.jpg)



:quality(70):focal(2135x1535:2145x1545)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/CNCN7GRNBJHFZBAVA7UQY6XRVQ.jpg)


:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/GFR7HRHAMVGN7FPOZIGMZVSEFI.webp)






:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/X7SYPW46NRHHLKZPZAEOZ7KBME.jpg)