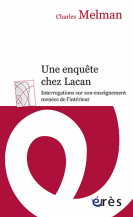Pour une refondation de la psychiatrie
Par HERVÉ BOKOBZA Psychiatre, membre du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire
La psychiatrie, discipline profondément ancrée dans le champ social, est en grave péril. Ceci a été dénoncé vivement et clairement lors des états généraux de la discipline en 2003. Nous affirmions alors que seul un changement radical de politique permettrait d’éviter le risque de désastre sanitaire auquel nous étions confrontés.
Traiter des personnes souffrant de pathologie mentale pose toujours la question de l’exclusion et de la ségrégation : la peur de la folie est ancestrale et le demeurera probablement. Peur de la folie de l’autre, de la sienne, de l’étrangeté, de l’étrange, du déraisonnable.
Soigner, c’est dédramatiser, faire confiance, accompagner, encourager.
C’est, quand cela est possible, rassurer les familles, tenter d’expliciter notre travail, leur permettre de traverser des moments on ne peut plus douloureux.
Or, il y a trois ans, le président de la République est venu stigmatiser les malades mentaux : ils seraient tous potentiellement dangereux, nous a-t-il affirmé.
Le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire est né de cette infamie.
En juillet, une loi inique et liberticide était votée : sous-tendue par cette supposée dangerosité, elle enferme les patients dans une coquille sécuritaire et elle continue de transformer les soignants en exécuteurs de diktats normatifs. Au lieu de veiller sur les patients, on nous demande de les surveiller.
La norme envahit les services, les pratiques, les espaces de soins : tout doit être contrôlé, protocolisé, prévu, géré, contrôlé, sécurisé. Or, le soin a besoin de liberté de penser et d’action, de confiance, de surprise.
Notre temps doit être consacré à nos patients, au travail de réflexion au sein des équipes de soin. Or, pour répondre aujourd’hui à ces exigences normatives, chaque soignant est convoqué à se replier ou à se renfermer pour accomplir sa «mission» : remplir des cases, des fichiers. En fait, tout se passe comme s’il fallait éviter, refouler ou dénier l’essence même de notre pratique : la rencontre avec le patient, seul garant d’un soin de qualité.
Une machine infernale est en marche. Chacun tente de résister comme il le peut. Lors d’un récent débat avec Claude Finkelstein, au forum de Libérationà Lyon, j’insistais pour signifier que la psychiatrie ne se limitait pas, loin de là, «aux horribles internements» ; que près de trois millions de personnes se confient à des soignants tous les ans avec confiance et espoir, que c’est justement pour tenter de sauvegarder ces rapports de confiance que des mouvements importants de toute la profession s’étaient organisés dans le but de combattre cette récente loi qui justement institue la méfiance. Mais nous avons perdu une nouvelle bataille.
Dans ces conditions, que deviennent et que vont devenir nos lieux d’hospitalisation ? Seront-ils ou ne sont-ils pas déjà complètement obsolètes ? Ne sont-ils pas les lieux qui peuvent le moins résister à cette machine normative et excluante, dont les récentes lois ne représentent que les derniers avatars ?
Devrons-nous continuer d’accepter que nos pratiques soient à ce point méprisées, dévalorisées, étouffées par les pouvoirs publics ?
Devrons-nous continuer à garder un «entre nous de circonstance» où chacun tente de se débrouiller comme il le peut, en s’épuisant et parfois vainement, et n’a de cesse de dire : «Ce n’est plus possible» ?
Devrons-nous encore longtemps courber l’échine, oublier de dire, accepter l’inacceptable, participer à cette formidable œuvre de démolition qui s’accomplit devant nous et hélas parfois avec nous, au mépris de nos valeurs et de nos espoirs ?
Car nous continuons d’affirmer que ceux qui souffrent de pathologie mentale ont besoin et auront besoin à des moments de leur existence de recourir à des lieux d’asile et qu’il est hors de question de supprimer encore des lits ! Mais inventer des lieux où l’accueil de la souffrance est possible est indispensable ! Lieux où les rencontres nécessaires à tout soin qui se réclame «humain» ne sont pas dictées par des protocoles aliénants, lieux où les règlements ne sont pas l’unique proposition «contenante», lieux où prendre du temps est possible et estimé nécessaire, lieux où le patient puisse tout simplement être reconnu dans sa singularité.
Or, jour après jour, ces espaces sont de plus en plus difficiles à maintenir vivants. Que beaucoup disparaissent pour laisser place à des endroits indignes des valeurs humanistes qui ont fondé la psychiatrie moderne nous fait honte et nous révolte. Nous ne l’acceptons pas car cela nous écœure.
Seul un mouvement de grande envergure réunissant soignants, patients, familles, citoyens pourra stopper cette machine infernale. Il est décidément grand temps de refonder la psychiatrie.