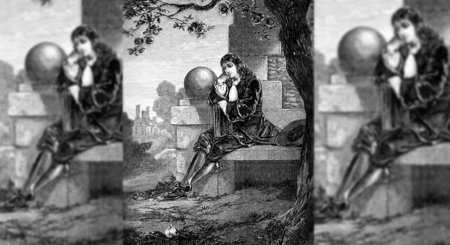ABSTRACT
La recherche des critères objectifs de guérison en psychothérapie demande d'abord une mise au point des caractéristiques de cette forme de traitement. En outre, il est nécessaire de surmonter les différences doctrinales des écoles psychothérapiques, notamment en ce qui concerne la nosographie, le rapport d'efficacité entre l'évolution de la cure et la technique employée et la notion de terminaison d'un traitement. Ensuite, pour obtenir des critères de guérison autant que possible universellement acceptables, il faut que d'une part ceux-ci soient assez généralisés et non strictement conditionnés par des présomptions théoriques unilatérales, et que d'autre paît, ils soient assez précis et concrets pour donner une garantie de validité clinique.



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/5373ZROXDREE5CQKRINBCHA6PE.jpg)



:quality(70):focal(3267x3410:3277x3420)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/Q2QKQKBGRFEG5JFKS63W3UVVG4.jpg)