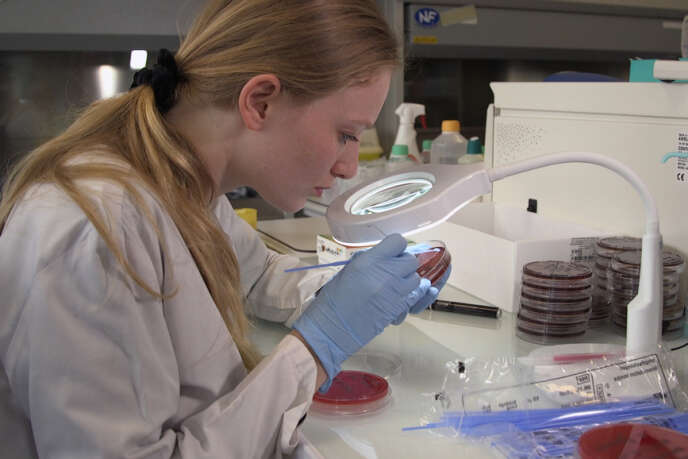- 17 OCT. 2019
- PAR MISS MARPLE
- ÉDITION : CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
- Ce texte m’a été envoyé par Roger Gentis en 1998 afin que je l’inclue à un livre dont je lui avais envoyé la première version, "Le Carrefour des Impasses", sur mon vécu d'infirmière de secteur psychiatrique. Il y relate son parcours en psychiatrie, fait un bilan de l'évolution de celle-ci et s'interroge sur son devenir.
Je remercie le Professeur Werner de m'avoir choisi pour venir présenter ce rapport à votre symposium. Je pense qu'il l'a fait en connaissance de cause: j'ai participé pendant près d'un demi-siècle à la difficile transformation de la psychiatrie française, ce qui ne peut manquer d'émailler ce rapport de souvenirs personnels et de l'entacher d'une certaine partialité. Vous voudrez bien en tenir compte. Par ailleurs, j'ai cessé d'exercer il y a maintenant neuf ans dans la psychiatrie publique, mais j'occupe ma retraite avec de multiples actions de formation et surtout, dans le midi de la France, avec de nombreuses supervisions et régulations d'équipe, tant dans le secteur socio-éducatif que dans le secteur médico-social; je participe tous les ans à plusieurs rencontres et colloques - bref, je reste en contact assidu avec la psychiatrie en train de se faire, et c'est ce qui m'autorise à prendre la parole devant vous.
A moins d'y passer des heures, je ne saurais évidemment pas plus que quiconque dresser un tableau exhaustif de la psychiatrie française en cette année 1998. Comme sans doute dans la plupart des pays dits occidentaux, la situation est en France extrêmement complexe, conflictuelle et mouvante. Vous connaissez aussi bien que moi les multiples options idéologiques qui se disputent actuellement le champ de la santé mentale - la France n'est nullement en retard à cet égard et on y trouve comme ailleurs à portée de main comportementalisme, cognitivisme, thérapies systémiques, psychiatrie biologique, psychanalyse freudienne ou jungienne, art-thérapie, sophrologie, analyse transactionnelle, thérapies gestaltistes, etc. Comme ailleurs sans doute, ces différentes tendances s'affrontent ou s'associent - plusieurs d'entre elles coexistent le plus souvent dans une même pratique, de façon plus ou moins éclectique, sans que cette coexistence ait été toujours bien pensée, bien articulée, ce qui est assez étonnant dans un pays où la spéculation théorique précède souvent d'assez loin les réalisations pratiques.
On ne peut par ailleurs dissocier ce malaise de la psychiatrie de la conjoncture politique et économique dans laquelle il se développe. Dans le contexte actuel d'inflation du coût de la santé et des tentatives de maîtrise que cela induit chez les gestionnaires, la psychiatrie se trouve dans une position très inconfortable, car on lui demande de limiter ses dépenses, et pour cela d'évaluer son activité en vue de la rationaliser, de rendre des comptes - ce qui en soi est tout à fait normal et compréhensible: la difficulté dans le cas de la psychiatrie, c'est qu'il est difficile de fonder ces calculs sur des paramètres véritablement pertinents, comme c'est plus aisément le cas en médecine somatique. Il y a là une aporie méthodologique bien connue, même si l'on s'obstine à la méconnaître: lorsqu'il s'agit de prendre en compte le sujet humain, toute tentative de quantification l'objective immanquablement, et l'on n'a plus affaire qu'à un pseudo-sujet, un sujet en trompe l'œil. Alors on s'évertue à établir des grilles de calcul aussi ingénieuses qu'arbitraires, dont le résultat le plus clair est de fournir des statistiques inutilisables, ou que du moins on devrait considérer comme telles - car à la base on ne peut mettre des chiffres sur la pratique sans distordre gravement la réalité de celle-ci.
Plus grave encore, il y a là l'amorce d'un cycle éminemment pervers, car les réticences et les tricheries des travailleurs de base suscitent la défiance des instances de contrôle et la mise en place d'un appareil hiérarchique de plus en plus bureaucratique et policier, de plus en plus désinséré de la pratique réelle des gens de terrain. Ces bureaucrates, qui étaient parfois de bons soignants tant qu'on ne les avait pas aliénés à cette tâche impossible, s'accrochent alors faute de mieux à ce qui fait illusion de leur pouvoir, ils deviennent des fétichistes de l'ordinateur et ne voient plus l'exercice du métier de soignant qu'à travers les quatorze pouces de leur écran. Il me semble qu'il y a là, c'est pourquoi j'insiste un peu, un des ingrédients essentiels du malaise actuel de la psychiatrie, en France - difficulté qu'on peut ramener, en fin de compte, à un problème de méthodologie, qui est en même temps un problème d'éthique: on veut faire entrer la psychiatrie dans une quantification dont la validité, si toutefois elle est établie, a été testée hors de son champ, et qui constitue pour elle un véritable lit de Procuste. En un mot, on ne semble pas s'être soucié de la spécificité de la psychiatrie et c'est sans doute par là qu'il aurait fallu commencer…
Nous touchons là, bien sûr, un autre aspect important de la question: la place de la psychiatrie parmi les disciplines médicales.