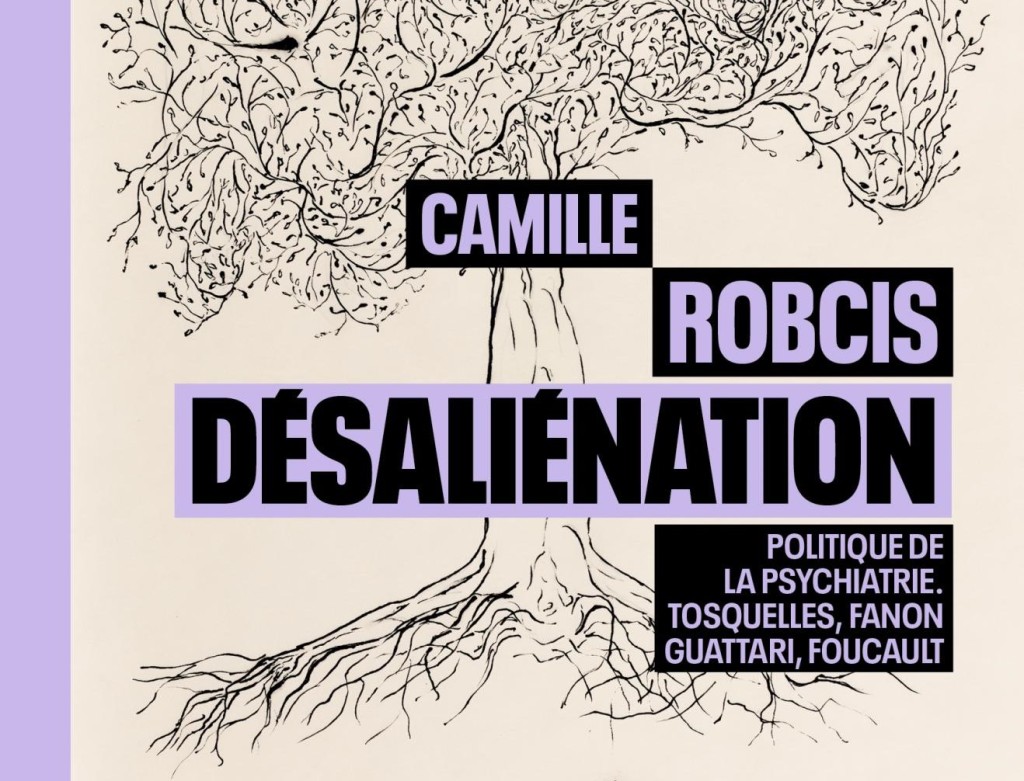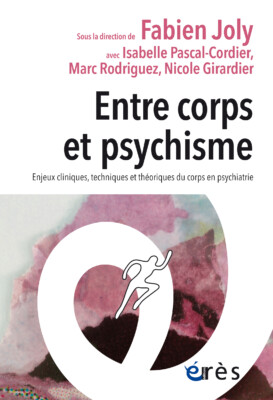18 avril 2024
Jacques Cofard
Depuis la parution ce mercredi d'un entretien dans Paris Match de la Pre Karine Lacombe, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine (Paris) qui accuse le Dr Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins des urgentistes, de « harcèlement sexuel et moral » — lequel dénonce une calomnie et se défend en évoquant de la « grivoiserie » —, les langues se délient sur les réseaux sociaux quant au harcèlement sexuel à l’hôpital. Rappelons que Medscape France y avait consacré une enquête dès 2019, dans laquelle plus de 1000 praticiens exerçant en France, avaient apporté leur témoignage (voir Enquête : harcèlement sexuel dans le milieu médical en France).
Sur X, sous le hastag combiné #Metoo #Hopital, de nombreux témoignages de victimes voient le jour, comme celui, choquant, d'Éloïse Nguyen-Van Bajou : « J’ai été agressée par un collègue avec qui je bossais aux urgences, un soir de fête de service. Les violeurs ne sont malheureusement pas des monstres. Ce sont nos collègues, nos meilleurs potes, nos frères. Éduquez vos garçons. ».
Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris (SIHP) a lancé un appel à témoignage pour lancer des procédures. Tout comme le syndicat Sud santé sociaux. La Fédération hospitalière de France a salué pour sa part la libération de la parole des femmes, et le ministre délégué à la santé, Frédéric Valletoux, réunira la semaine prochaine les associations, syndicats, directeurs d'hôpital, pour prendre des mesures afin de lutter contre ce mal endémique que sont les violences sexistes et sexuelles. La Dre Anna Boctor, membre du syndicat Jeunes médecins, avait dénoncé la discrimination de genre en 2019, pour en avoir elle-même été victime. Depuis c'est une militante active contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Nous l’avons interviewé sur la persistance de comportements sexistes totalement inappropriés et inacceptables dans le contexte hospitalier.
Medscape édition française : Avez-vous été étonnée par cette vague MeToo à l'hôpital, à la suite de la dénonciation des agissements du Dr Patrick Pelloux par la Pre Karine Lacombe ?
Dre Anna Boctor : Le Dr Pelloux avait une réputation dans le milieu.
Ce qui veut dire qu'une réelle omerta existe dans le milieu hospitalier ?
Dre Boctor : oui c'est ça. Le fait que l'on discrimine les femmes dans l'avancement de leur carrière et le fait qu'on les harcèle sexuellement, cela se rejoint, cela fait sens. Ce sont des violences sexuelles et sexistes. Tous les ingrédients sont réunis pour favoriser ce type de comportements. Traditionnellement, il n'y avait pas de femmes en médecine. Avec le temps, les femmes ont investi les études de médecine mais malgré cela, ça n'a pas inversé la tendance pour les postes de pouvoir, qui restent aux mains de la gente masculine. C'est un problème complexe, qui combine plusieurs facteurs : le plafond de verre imposé aux femmes, souvent déterminé au moment de la grossesse, le maintien d'une caste au sommet du pouvoir médical qui cultive un entre-soi et parmi lesquels on compte nombre de harceleurs qui pratiquent l'abus de pouvoir. Si une victime dépose plainte contre l’un des membres de cette caste, elle risque de voir sa carrière brisée.
Lire la suite ...





:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/RYEWHR4NSBFVNOBGOL77FVTR3I.jpg)