Par Aureliano Tonet Publié 8 août 2022

Pionnier, dès le milieu du XXᵉ siècle, dans la recherche sur la psilocybine, l’Hexagone s’est très tôt focalisé sur les dangers, réels ou fantasmés, de cette molécule. Les travaux ont aujourd’hui timidement repris, nourrissant les espoirs de la communauté scientifique.
Octobre 1966 : une spectaculaire descente de police perturbe le Salon du champignon, qui se tient, comme chaque automne, au Muséum d’histoire naturelle. Directeur de l’établissement entre 1951 et 1965, et désormais à la tête du laboratoire de cryptogamie, le mycologue Roger Heim en a fait un rendez-vous prisé des Parisiens. Les forces de l’ordre le somment de retirer la vitrine sur les psilocybes, dont la plupart des espèces sont hallucinogènes. En France, depuis le 1er juin 1966, la psilocybine, une molécule extraite de ces champignons, a rejoint la liste des stupéfiants, au côté d’autres substances dites « psychédéliques », comme le LSD (diéthyllysergamide).
Le directeur du Muséum se plie à contrecœur à la requête des autorités. Dans ses laboratoires qui jouxtent le Jardin des plantes, il a identifié, en 1957, une espèce alors inconnue, le Psilocybe mexicana, permettant au chimiste suisse Albert Hofmann d’en isoler le principe actif l’année suivante – la psilocybine, donc. Roger Heim a découvert ce champignon au Mexique, à l’été 1956, au côté de son ami le plus cher, le banquier new-yorkais Robert Gordon Wasson. « Je n’ai certainement pas besoin d’insister sur le fait que la presse publie chaque jour des informations absolument fausses en ce qui concerne les drogues naturelles, écrit le mycologue au commissaire Jacques Arnal. Les champignons hallucinogènes du Mexique, utilisés pendant des siècles par les Indiens, n’ont occasionné aucun trouble sérieux. Ils sont certainement moins délétères que l’alcool de tequila extrait de l’agave qui les a remplacés. » Dans cet échange tient tout le paradoxe français : bien qu’aux avant-postes de la recherche sur la psilocybine, une molécule qui nourrit aujourd’hui les espoirs de la communauté scientifique, l’Hexagone s’est très tôt focalisé sur ses dangers, réels ou fantasmés.
Une passion française
Son rôle de pionnier, notre pays le doit en partie à la francophilie de Robert Gordon Wasson, l’homme sans qui Roger Heim n’aurait pas mis la main sur le Psilocybe mexicana. Né en 1898, ce New-Yorkais découvre l’Europe à 16 ans, au cours d’un long voyage, seul, des deux côtés des Pyrénées. En 1917, il s’engage dans le corps expéditionnaire américain : il servira quatorze mois en France en tant qu’opérateur radio. Précoce, cette passion française ne le quittera plus. En 1926, c’est certes à une Russe qu’il se marie, la pédiatre Valentina Pavlovna Guercken, dont la famille s’est exilée à New York après la révolution bolchevique. Mais c’est en France que le couple passera la plupart de ses vacances, avec une prédilection pour la Provence, la Normandie et le Pays basque. D’autant que, une fois nommé vice-président des relations publiques de J.P. Morgan, en 1943, le banquier multipliera les voyages d’affaires à Paris.
Ces séjours sont l’occasion de creuser l’obsession qui le dévore depuis qu’il a épousé Valentina. Leur lune de miel au Mexique, en 1927, pendant laquelle ils sont tombés sur des champignons sauvages, a bouleversé le destin des Wasson : tous deux sont convaincus que l’humanité se divise entre les peuples « mycophiles », qui adorent les champignons, comme les Slaves, et les « mycophobes », qui les détestent, comme les Anglo-Saxons. Ils épluchent le patrimoine linguistique, artistique et populaire de chaque pays, en quête d’indices confirmant leurs intuitions, tantôt sur le terrain, tantôt en sollicitant une internationale de savants. Des recherches qui aboutiront à la parution, en 1957, d’un premier ouvrage, Mushrooms, Russia and History (« Champignons, Russie et histoire », non traduit), bientôt suivi d’autres publications.
La France les obnubile particulièrement, par son caractère hybride. D’après les Wasson, certaines régions seraient « mycophiles », adeptes des champignons, comme le Pays basque, la Catalogne ou la Provence ; d’autres, dans la moitié nord, pencheraient du côté « mycophobe ». La chapelle romane de Plaincourault, dans l’Indre, mobilise leur attention. L’une de ses fresques, datant du XIIe siècle, représenterait-elle des champignons aux côtés d’Adam et Eve ? A regret, le couple se rangera à la thèse de deux historiens de l’art, qui y distinguent des pins romains plutôt que des amanites tue-mouche…
Coup de foudre amical
Pour autant, les époux n’abandonnent pas les investigations sur notre sol : les archives du banquier, que nous avons consultées à la bibliothèque botanique de l’université Harvard, près de Boston, sont truffées d’échanges avec des sommités françaises. Au linguiste Jean Séguy, spécialiste de la langue d’oc, Robert Gordon Wasson demande, le 19 décembre 1955, dans un français presque parfait : « Quelle est l’espèce de champignon immangeable que les Gascons appellent “con d’ânesse” ? » Verdict de l’expert : « cunnu sagma » désigne un type de « mauvais champignons »… Jusqu’à sa mort, en 1986, le banquier entretiendra de même une correspondance fournie avec deux pontes du Collège de France, les anthropologues Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss.
Le premier peut ainsi écrire, en 1969, qu’il le « félicite avec la sympathie du chercheur et la chaleur de l’ami ». Le second, en 1958, lui fait cette confidence, alors qu’il s’apprête à rédiger une critique dithyrambique de Mushrooms, Russia and History pour le magazine L’Express : « Puisque je suis, outre un anthropologue, un mycophile enthousiaste (et un cuisinier également !), soyez assuré que mon approche suivra de près la vôtre. » Et de lui confier, deux ans plus tard, qu’il avait pensé à lui en visitant le Louvre, à la vue d’un tableau d’un peintre du XVIIe siècle, Abraham Mignon, représentant « des psalliotes, des mycènes et une hydne »…
Nul ne peut rivaliser, cependant, avec le rôle qu’a joué Roger Heim dans la vie du banquier. Leur coup de foudre amical remonte à l’été 1949. Pour illustrer l’ouvrage sur lequel ils planchent depuis des années, Robert et Valentina ont jeté leur dévolu sur des aquarelles du naturaliste Jean-Henri Fabre (1823-1915). Or il se trouve que l’Harmas, le musée où elles sont entreposées, à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), dépend du Muséum d’histoire naturelle. En leur facilitant l’accès aux collections, Roger Heim tape dans l’œil des Wasson, qui se cherchent alors un guide pour arpenter les sous-bois souvent techniques et ténébreux de la mycologie : le Français, décident-ils, sera le leur. Au fil des centaines de lettres que le banquier envoie au mycologue, le plus souvent sur du papier jaune à en-tête J.P. Morgan, « Cher docteur Heim » devient vite « Cher maître et ami ».
Périples mexicains
Les deux hommes ne partagent pas que la passion des champignons. Libéraux assumés, ils se situent sur la droite de l’échiquier politique. Centralien, entré au Muséum dès 1927, Roger Heim anime, à partir de 1942, un réseau de résistants. Déporté en 1943, il reprendra, dès la fin de la guerre, ses fonctions au Muséum. Il gardera de cette tragédie une loyauté absolue au général de Gaulle, qu’il a l’autorisation de joindre sur sa ligne directe. Cela ne peut qu’inspirer confiance à Robert Gordon Wasson, proche du Parti républicain et des services secrets américains.
De fait, la correspondance entre Wasson et Heim brasse les sujets les plus variés. Le premier sollicite le second pour identifier les amanites figurant sur une nature morte d’Otto Marseus van Schrieck, un peintre du siècle d’or néerlandais, ou pour obtenir des informations sur « la crotte », ainsi que les Jurassiens surnomment un de leurs champignons. Heim, en retour, consulte son ami banquier sur l’opportunité de certains placements financiers, ou sur les événements« lamentables » du canal de Suez, en 1956.
Mais ce sont leurs périples au Mexique qui cimentent l’amitié entre les deux hommes. Entre 1953 et 1962, Wasson y effectue dix voyages ; Heim le rejoint à trois reprises, en 1956, 1959 et 1961. Dans le village de Huautla de Jimenez, dans le sud du pays, le banquier découvre un champignon hallucinogène, en juin 1955, au cours d’une cérémonie célébrée par la chamane Maria Sabina. Dès son retour à New York, il fait expédier par bateau plusieurs spécimens à Roger Heim. Le mycologue parvient à en faire pousser, en usant notamment le « fumier de bovidés exotiques » de la Ménagerie du Jardin des plantes, mais l’identification reste ardue. Aussi se décide-t-il à partir à Huautla en compagnie de Wasson, à l’été 1956.
« Ces jours resteront dans ma mémoire aussi longtemps qu’elle durera », écrit Gordon Wasson à Roger Heim à propos de leur séjour au Mexique en 1956
Il se berce des chants de la chamane, goûte le champignon, en récupère des échantillons dans les règles de l’art. « Ces jours resteront dans ma mémoire aussi longtemps qu’elle durera », écrit le New-Yorkais. « Les heures ont passé comme les lucioles que nous admirions le soir », lui répond le Parisien. En 1957, après qu’il est parvenu à identifier le Psilocybe mexicana, au Muséum, ses équipes étaient sur le point d’en isoler le principe actif, avant d’y renoncer à la suite d’un incident de fiole. Des spécimens sont alors envoyés en Suisse, aux laboratoires Sandoz, où le chimiste Albert Hofmann synthétise la psilocybine en 1958.
Le banquier partage avec son ami son plus haut fait de gloire, la publication dans l’hebdomadaire Life, en mai 1957, de ses aventures à Huautla. L’article est illustré par une photo des deux hommes, dans les collines mexicaines, ainsi que par des dessins mycologiques de Roger Heim, pour lesquels il percevra 500 dollars. Sept mois plus tard, le Français figure parmi les premiers informés de la mort de Valentina, d’un cancer. « C’est hier seulement que m’est parvenue votre lettre m’annonçant l’irréparable, écrit Heim le 9 janvier 1959. Je réalise le dur calvaire que vous avez dû connaître. Ma pensée, dans les mois écoulés, en marge de nos lettres, s’y reportait sans cesse. »
Périples en Nouvelle-Guinée et en Inde
Durant cette période dramatique, les deux hommes se confondent en marques d’amitié. Heim fait nommer Wasson correspondant du Muséum, le 19 décembre 1957. Dans le même temps, il entreprend de donner à une variété de psilocybe le nom scientifique de Ps. Wassonii Heim – en vain, hélas, car une autre équipe de chercheurs l’a devancé. Quant à Wasson, il organise, moins d’un mois après la mort de son épouse, un voyage de huit jours à New York pour son ami français, ponctué de conférences, de visites et de dîners avec l’élite locale.
Il faut dire que le banquier a le bras long. Quand il se rend à Paris, Wasson dort au luxueux l’hôtel Lotti ou au Ritz, près de la place Vendôme, où se trouve l’antenne française de sa banque. Il donne rendez-vous au Traveller’s Club, un cercle huppé des Champs-Elysées. Et mobilise les employés de J.P. Morgan ou de la Société générale, voire les attachés de l’ambassade américaine, pour effectuer tout type de commissions – y compris mycologiques. Roger Heim sera l’un des principaux bénéficiaires de cette prodigalité, même après la fin de son mandat de directeur du Muséum, en 1965 – il continuera d’y exercer en tant que professeur de mycologie, et prendra sa retraite en 1971. Avec Wasson, il effectuera d’autres périples en Nouvelle-Guinée et en Inde, jusqu’à sa mort, en 1979. « C’était un personnage ; je l’admirais et je l’aimais. Sans lui je n’aurais pu rien faire dans la mycologie », s’épanche le New-Yorkais à la veuve de son ami, en février 1980.
« C’est par l’entremise de Roger Heim que la première étude clinique au monde sur les effets de la psilocybine a été menée, en 1958, à Paris », Vincent Verroust, historien des sciences
La correspondance entre Heim et Wasson occupe une place centrale dans la thèse d’histoire des sciences qu’écrit actuellement Vincent Verroust, intitulée « Une science est née, les conséquences heuristiques de la découverte des champignons divinatoires du Mexique, en France (1953-1971) ». Ce quadragénaire anime depuis 2017 la Société psychédélique française, une « association de médiation culturelle et scientifique sur le thème du psychédélisme ». Dans un restaurant indien, à deux pas du Jardin des plantes, il nous en offre quelques autocollants à l’effigie d’un coq juché sur un champignon.
« Conscience écologique »
« Il y a une vingtaine d’années, j’ai fait un stage dans l’annexe du Muséum à Dinard, un vieux manoir en bord de mer, raconte Vincent Verroust. Je fouille les tiroirs d’un secrétaire et je tombe sur des lettres de Roger Heim évoquant deschampignons hallucinogènes. J’ai voulu essayer à mon tour. »Pour le chercheur, c’est une révélation, dont témoignent ses activités actuelles. La question environnementale, qui fut un sujet de préoccupation pour Roger Heim, traverse sa thèse en filigrane. « La conscience écologique de Heim s’est aiguisée avec le temps, pour aboutir à la parution en 1973 de son essai, L’Angoisse de l’an 2000. Cet engagement a-t-il été intensifié par la psilocybine, qui a souvent pour effet d’accentuer notre sentiment d’interconnexion avec la nature ? »
Avec sa boule à zéro et ses lunettes rondes, semblables à celles qu’arborait jadis Roger Heim, Vincent Verroust revient sur un autre legs du mycologue : « C’est par son entremise que la première étude clinique au monde sur les effets de la psilocybine a été menée, dès 1958, à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, à Paris. Heim s’est rapproché de Jean Delay, qui dirigeait alors l’établissement, et s’est arrangé pour lui fournir la substance. » L’expérience porte sur 72 malades mentaux et 29 sujets sains. La journaliste scientifique Erica Rex a pu comparer cette étude avec celles qui avaient été menées à Sainte-Anne, quelques années auparavant, autour du LSD.« Les essais sur le LSD s’apparentaient à de la torture : les sujets étaient traités comme des rats de laboratoire, sans souvent savoir ce qu’on leur administrait, retrace l’Américaine. C’est un peu moins vrai pour l’étude sur la psilocybine. Les médecins prenaient davantage soin des patients, du moins durant leur séjour à l’hôpital. »
Fin de la recherche psychédélique
Dès les années 1950, aux Etats-Unis, des pionniers des thérapies psychédéliques ont insisté sur la nécessité, pour obtenir des résultats positifs, de les réaliser dans un cadre rassurant. Cela n’a pas toujours été le cas à Sainte-Anne, où les sujets étaient parfois livrés à eux-mêmes, sous une lumière aveuglante, avec un suivi pour le moins aléatoire. A ce titre, l’histoire d’Henriette B. est exemplaire. Sans emploi, cette célibataire de 35 ans souffre d’anorexie – 40 kg pour 1,69 m – et d’un « cortège dépressif ». Après une session sous psilocybine, elle écrit : « Je vole sur un rayon de soleil, je suis vertige… Je ne sens plus le poids de ma chair libérée… » A sa sortie de Sainte-Anne, un mois après y être entrée, elle a gagné 7 kg. Mais, une fois chez elle, Henriette replonge dans la dépression. « Elle a été laissée seule, regrette Erica Rex. Or si le sujet n’est pas bien entouré avant, pendant, mais aussi après la thérapie, celle-ci a toutes les chances d’échouer. »
En 1963, la France abandonne la recherche sur les psychédéliques, trois ans avant leur interdiction. Elle ne reprend, timidement, qu’aujourd’hui, plus de quinze ans après les premières études qui ont ravivé outre-Atlantique l’intérêt des scientifiques pour ces substances, en particulier pour la psilocybine. « Cet écart s’explique en partie par l’habitude qu’on a prise, pour soigner les maladies mentales, de recourir à une fierté française : les neuroleptiques, portés par les découvertes d’Henri Laborit et du laboratoire Rhône-Poulenc dans les années 1950 », estime Vincent Verroust.
Raphaël Gaillard, qui dirige le pôle de psychiatrie de l’hôpital Sainte-Anne, réfute cette hypothèse. « La France souffre d’abord d’une inertie spectaculaire face à l’innovation, avance le psychiatre, normalien et expert judiciaire. Aux Etats-Unis, l’initiative est individuelle et pragmatique : si ça marche, on teste. Chez nous, le poids de la responsabilité collective et réglementaire est autrement plus lourd. » Cinquante-cinq ans après « sa » première mondiale, Sainte-Anne testera bientôt la psilocybine pour lutter contre la dépression. L’étude, prévue pour 2023, portera sur 80 sujets, avec l’étroite collaboration du laboratoire anglo-saxon Compass Pathways, le plus actif mais aussi le plus décrié sur ce composé. « Sans le soutien d’industriels, aucune recherche ambitieuse ne peut se faire », assume Raphaël Gaillard, sous le regard songeur d’une figurine de Maître Yoda qui surplombe son bureau. Et de tempérer : « Le cimetière des molécules est rempli de substances qui n’ont pas tenu leurs promesses… Je n’ai jamais cru à la panacée. »
« Les thérapeutes ne pourront pas donner la main aux patients, comme ils le font aux Etats-Unis, les flics débarqueraient aussitôt ! », Luc Mallet, chercheur en neurosciences
Le psychiatre met en garde contre la tentation de dépénaliser la psilocybine, comme s’y emploient déjà certaines villes américaines : « Sans supervision médicale, il y aura fatalement des accidents – or aujourd’hui la tolérance à l’accident est nulle », insiste-t-il, en citant la possibilité, infime mais réelle, de développer des troubles cardiaques ou schizophréniques. En 2018, un Lyonnais de 18 ans est mort en se jetant par la fenêtre, après avoir pris des psilocybes avec des amis. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) estime que 5,3 % des adultes ont consommé un champignon hallucinogène au moins une fois dans leur vie. « L’augmentation de soi, ça ne me concerne pas ; soigner des souffrances épouvantables, si, poursuit Raphaël Gaillard. En légalisant ces substances, on risquerait de priver de leurs bienfaits ceux qui en ont le plus besoin : les malades… D’autant que ces traitements ont l’avantage de tordre le cou à l’opposition historique entre la pharmacopée et la thérapie, les médocs et le divan. »
Son collègue Fabrice Jollant, professeur de psychiatrie à l’Université de Paris, s’apprête à étudier l’impact de la psilocybine sur la réduction des conduites suicidaires, sa spécialité. « Le suicide est lié à un déficit de sérotonine, mais aussi à l’impression qu’on est seul au monde. La psilocybine peut corriger ces deux facteurs : elle agit sur les récepteurs de sérotonine et, si elle est accompagnée d’un protocole adéquat, elle peut accroître le sentiment de connexion au monde. »L’étude sera menée à Iéna, en Allemagne, même si Fabrice Jollant ne désespère pas d’en réaliser une bientôt dans en France. « Un fabricant américain de psilocybine projette de s’installer près d’Aurillac, croit-il savoir. Encore faut-il vaincre l’idéologie, très implantée en France, qui tend à disqualifier tout ce qui ressemble à des drogues, au mépris des données scientifiques. »
« Descartes, Freud et Lacan sont passés par là »
Luc Mallet est psychiatre et chercheur en neurosciences à l’Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Il vient d’ouvrir une section « psychédélique » au sein de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie où il espère rassembler une cinquantaine de confrères. Il compte leur partager ses réussites récentes : en coopération notamment avec huit services d’addictologie d’Ile-de-France, il a levé 1,2 million d’euros pour mesurer, entre autres, les effets du LSD sur la dépendance à l’alcool. L’étude, ambitieuse, devrait compter 210 patients. Le protocole sera bien plus « froid » qu’aux Etats-Unis : « Les thérapeutes ne pourront pas donner la main aux patients, comme ils le font aux Etats-Unis, sinon les flics débarqueraient aussitôt !, module Luc Mallet. En France, il y a une méfiance diffuse pour ce qui touche au spirituel : une étude sur les traits dominants de personnalité a montré que le rapport à Dieu est la principale différence entre les Américains et les Français. Descartes, puis Freud et Lacan sont passés par là. »
Mais la France est aussi le pays de Claude Lévi-Strauss, l’ami de Robert de Gordon Wasson. En 1970, au détour de sa critique d’un ouvrage du banquier new-yorkais, l’anthropologue arguait que les hallucinogènes sont « des déclencheurs et des amplificateurs d’un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l’élaboration ». Ce « discours latent », en France, quel est-il ? Il fait grand cas, semble-t-il, de la créativité artistique. L’expérience réalisée en 1960-1961 à Sainte-Anne par René Robert en atteste. Ce psychiatre a demandé à 29 artistes, dont cinq internés, de peindre ou dessiner sous psilocybine. Après une expérience infructueuse à l’hôpital, les essais s’avèrent plus concluants dans l’atelier ou au domicile des artistes. L’un d’eux, Sam Mendel, s’écriera même : « Je n’ai jamais eu le culot de faire ça. » Intrigué par la substance, le poète Henri Michaux en tire une certaine satisfaction : « La psilocybine est étonnante par les transformations intérieures », écrit-il en avril 1959.
« La France diabolise les états modifiés de conscience. Les Américains, avec leur tempérament de pionniers, y sont plus enclins », la comédienne Blanche Gardin, consommatrice de psilocybe à usage thérapeutique
Plus d’un demi-siècle plus tard, les principaux mécènes de la Société psychédélique française s’avèrent également être des artistes, révèle Vincent Verroust. Parmi eux, on trouve la comédienne Blanche Gardin. Après avoir pris des champignons hallucinogènes entre ses 17 ans et ses 30 ans, « en quête d’une expérience de transcendance », elle y est revenue autour de la quarantaine, cette fois pour des raisons thérapeutiques – elle souffrait de maux de ventre, combinés à un « terrain dépressif ». « Les antidépresseurs modifient votre humeur mais pas votre rapport à vous-même et au monde, confesse Blanche Gardin, aujourd’hui âgée de 45 ans. La psilocybine, elle, m’a guérie. » A quoi tient, selon elle, le retard français en la matière ? « Alcool mis à part, la France diabolise les états modifiés de conscience. Celui qui les recherche quitte le groupe, la normalité. Les Américains, avec leur tempérament de pionniers, y sont plus enclins. »
Installée depuis plus de vingt ans à New York, où elle travaille pour plusieurs médias français, dont Le Monde, Stéphanie Chayet a consacré un livre aux psychédéliques, Phantastica(2020, Grasset). Elle y a eu recours après la découverte d’un cancer du sein, en 2016, à l’âge de 44 ans. La journaliste explique ainsi le hiatus entre ses deux pays : « Les promesses des psychédéliques – exploration des confins, réinvention de soi… – sont plus compatibles avec les mythes américains qu’avec nos penchants égalitaristes et collectivistes. »
On en revient à Robert Gordon Wasson, qui voyait les champignons hallucinogènes comme le reflet de nos affects. Son alter ego, Roger Heim, n’a jamais dit autre chose : « L’homme et le champignon sont faits soit pour s’entendre, soit pour se heurter. Face à face, comme dans un miroir, l’un répète l’autre dans sa symbolique ou affective signification. »

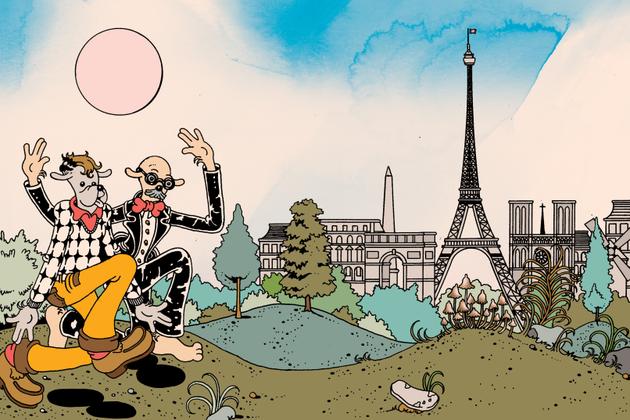
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire