Par Célia Laborie Publié le 05 mars 2021
ENQUÊTE Alors que le Covid-19 rend impossible d’organiser un mariage, des vacances ou une soirée d’anniversaire sans craindre de nouvelles restrictions, des centaines de milliers de Français se sont lancés, en 2020, dans un projet à long terme : devenir parent. Mais comment envisager avec optimisme l’avenir de ses enfants ?
Avec ses grands yeux gris, son air endormi et son petit pantalon à pois blancs, Siggy semble totalement inconscient d’être venu au monde en pleine tempête. En presque quatre mois sur Terre, le garçon a entendu des dizaines et des dizaines de fois le mot « Covid » sans le comprendre. Et sans, bien sûr, se douter des conséquences que ce virus aurait sur ses premières années de vie. Comme Siggy, environ 740 000 bébés sont nés en France en 2020. Un chiffre en légère baisse par rapport à l’année précédente, comme c’est le cas depuis maintenant dix ans.
« Après tout, les gens avaient aussi des enfants pendant l’Inquisition ou pendant les grandes guerres », souffle Lola, réalisatrice de 29 ans, en calant son bébé contre son sein pour l’allaiter. Elle et son copain Till, directeur de photographie de 27 ans, projetaient depuis quelques mois de fonder une famille quand l’épidémie due au SARS-CoV-2 a démarré en France. Alors que les vagues de contaminations se succèdent et que les perspectives de retrouver la vie d’avant s’éloignent, ils peinent à se projeter dans un avenir radieux pour leur premier enfant.
« Ce qu’on espère, c’est que la situation se sera améliorée quand Siggy aura l’âge de la comprendre. J’y pense parfois avant de m’endormir : devra-t-il aller à l’école primaire avec un masque sur le nez, passera-t-il son adolescence à entendre parler des nouveaux variants du Covid ? », s’inquiète Till, qui a pris son bébé dans ses bras pour le bercer après son repas. « J’ai peur que, dans quinze ans, il me reproche de l’avoir fait naître dans un monde pareil. »
Chez ce jeune père, l’inquiétude se double d’une forte dose de culpabilité. « Mes frères m’ont transmis leur intérêt pour la collapsologie, ce courant de pensée qui étudie les risques d’effondrement de notre civilisation. La crise du Covid-19 n’a fait que noircir ma vision de l’avenir de la planète. On sent de façon tangible que la catastrophe climatique arrive, que l’extrême droite est aux portes du pouvoir. J’ai toujours imaginé ma vie avec des enfants. Mais j’ai peur que leur génération connaisse une planète à la Mad Max et nous le reproche plus tard. »
Militants anti-natalistes
L’être humain est-il devenu à ce point nuisible qu’il devrait culpabiliser de vouloir se reproduire ? « Pendant des siècles, dans diverses cultures, c’est le discours inverse qui a dominé : la femme se réalisait en tant que mère », rappelle Marie Gaille, philosophe et autrice de l’ouvrage Le Désir d’enfant (PUF, 2011). « L’idée selon laquelle faire des enfants est un acte égoïste a une histoire récente, en lien avec des préoccupations environnementales. Dans les années 1970, les penseurs de l’écologie politique prônent la limitation des naissances, perçue comme le seul moyen de préserver l’espèce humaine dans son ensemble. »
Les débats de ces militants écologistes anti-natalistes, souvent affublés de l’acronyme Gink (pour Green inclination no kids), peuplent les colonnes des magazines depuis quelques années déjà. Avec l’arrivée du coronavirus dans nos vies, ils ont encore pris de l’ampleur.
« J’aurais voulu prévoir des voyages avec ma fille, mais c’est impossible. J’aimerais lui raconter des histoires merveilleuses, mais je ne trouve pas d’inspiration. C’est difficile de transmettre de l’insouciance ou de l’espoir à Nora. » Maelenn, 24 ans
Car, à l’orée de l’an II de la pandémie, les perspectives de « monde d’après » plus égalitaire et solidaire semblent toujours plus éloignées de nos réalités. « Quand je pense à l’avenir de ma fille, ça finit par devenir tellement flou que je préfère ne pas trop me poser de questions », murmure Maelenn, 24 ans, dont la fille Nora est née le 12 décembre 2020.
La thésarde en sciences sociales est tombée enceinte par accident pendant le premier confinement, alors qu’elle était isolée à la campagne avec un copain. « Ensemble, nous avons décidé de garder le bébé dans un contexte très particulier, loin de la ville, dans une maison avec un jardin. J’ai réussi à me projeter dans la maternité alors que je n’avais pas du tout formulé ce désir-là auparavant, se remémore-t-elle. De retour à Paris, avec la pandémie qui dure, c’est plus déprimant. Je ne vois pas grand-monde, j’ai l’impression d’être dans un jour sans fin. J’aurais voulu prévoir des voyages avec ma fille, mais c’est impossible. J’aimerais lui raconter des histoires merveilleuses, mais je ne trouve pas d’inspiration. C’est difficile de transmettre de l’insouciance ou de l’espoir à Nora. »
Le personnel des maternités recueille au quotidien les doutes et les angoisses des jeunes parents. Il y a, bien sûr, les incertitudes liées aux conditions sanitaires : la crainte pour les pères de ne pas pouvoir assister aux échographies voire à l’accouchement, la peur de devoir porter un masque pendant tout le travail… Mais aussi, dans un moment où les liens familiaux sont limités, un sentiment d’isolement très dur pour certaines mères.
« Je n’ai jamais vu autant de femmes traverser des dépressions post-natales. Nombre d’entre elles ne parviennent pas à se sentir à la hauteur des besoins de leur bébé », constate avec inquiétude Claudine Schalck, chercheuse et sage-femme travaillant avec la maternité des Bluets, à Paris. « J’ai entendu des femmes dire qu’elles ne feraient pas d’autre enfant, parce que dans un monde comme celui-ci, “ça ne vaut pas le coup”. Ce contexte épidémique, dans lequel on est en permanence en train de parler de mort, n’aide pas à avoir de l’espoir. Même si l’angoisse n’est, bien sûr, pas antinomique avec le désir d’enfant. »
Dans son ouvrage, la philosophe Marie Gaille n’hésite pas à qualifier le désir de « folie », d’envie impossible à rationaliser et capable d’émerger dans les moments les moins propices au développement serein d’une famille. « Je crois qu’il faut surtout le voir comme une pulsion qui a une dynamique propre et renvoie à une possibilité de se projeter vers l’avenir. Freud dit que les êtres humains sont animés en permanence par une lutte interne entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. Faire des enfants dans des circonstances tragiques, c’est justement une façon de continuer à vivre. »
Eloigner cette angoisse diffuse
De fait, la France reste championne de la natalité en Europe. Après tout, n’a-t-on pas toujours eu de très bonnes raisons de ne pas vouloir d’enfant ? La récession, et avant cela la guerre froide, les conflits mondiaux ? Comme l’explique la psychologue et psychanalyste Julianna Vamos, « l’envie de fabriquer la vie s’origine dans la toute première enfance, et elle est programmée pour faire face à toutes les vicissitudes ».
En observant les futurs parents qu’elle a accompagnés ces derniers mois, elle constate que la grossesse peut aussi aider à éloigner cette angoisse diffuse procurée par la pandémie. « La projection dans la parentalité génère une telle énergie que, bien souvent, la seule chose dont on est sûr, c’est qu’on va avoir un enfant. Le processus psychique engagé nous mobilise totalement. Un père m’a même dit qu’il avait l’impression que l’humanité entière attendait un bébé avec lui », se souvient la praticienne parisienne.
Et si, pour les parents, l’espoir pouvait justement venir des nouveaux-nés, de leurs progrès quotidiens, de leur inconscience des drames en cours ? Megane, 29 ans, assistante administrative au chômage à Bray-sur-Seine (77), a connu une grossesse difficile. Elle n’a pas pu montrer son ventre à ses parents, son copain n’était pas présent au début de l’accouchement, mais malgré cela, la naissance de son premier enfant, Malo, a totalement transformé son rapport au monde. « Puisqu’il n’a rien connu d’autre, il s’adapte très bien à la situation. Il se concentre sur les yeux et parvient à comprendre les intentions des gens. L’autre jour, à la poste, un monsieur lui faisait des grands sourires derrière son masque, et Malo riait de bon cœur avec lui. Quand je fais l’effort de voir le monde à travers ses yeux, je retrouve cette forme d’innocence qui m’aide à relativiser. »
« A la crèche, quand ils nous ont vus arriver avec les masques, ils nous ont regardés avec des yeux ronds. Mais trois jours plus tard, ils étaient habitués. Les bébés s’adaptent à tout, c’est fascinant ! » Lorène, auxiliaire de puériculture
Lorène B. (elle souhaite rester anonyme), auxiliaire de puériculture dans une petite ville de la région Midi-Pyrénées, confirme : même si on ne peut pas encore connaître les conséquences à long terme d’une petite enfance dans un monde envahi par les masques et le gel hydroalcoolique, les bébés semblent apprendre à « vivre avec » bien plus vite que les adultes. « A la crèche, quand ils nous ont vus arriver avec les masques, ils nous ont regardés avec des yeux ronds. Mais trois jours plus tard, ils étaient habitués. Les bébés s’adaptent à tout, c’est fascinant ! La mère d’une petite Léana nous a demandé si on leur donnait quand même l’amour dont ils ont besoin à cet âge-là. La vérité, c’est que c’est impossible de respecter la distanciation sociale avec des tout-petits. On aura beau avoir désinfecté tous les jouets, la minute d’après, ils auront bavé dessus et seront en train de tirer sur notre masque », s’amuse la trentenaire.
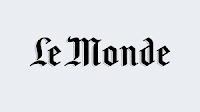




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire