Propos recueillis par Claire Legros

Dans son nouvel essai, La Clinique de la dignité (Seuil, collection « Le compte à rebours », 224 pages), Cynthia Fleury, la fondatrice de la première chaire de philosophie à l’hôpital, alerte sur la banalisation de l’« indignité ordinaire » et appelle à dépasser l’indignation pour refonder une politique de la dignité.
Vous décrivez une nouvelle sensibilité citoyenne à l’égard de la dignité. Comment s’exprime-t-elle ?
La revendication de la dignité fédère aujourd’hui plus encore que celles de l’égalité et de la liberté. On le voit dans les mouvements des « gilets jaunes », de Black Lives Matter contre le racisme, de #metoo contre les violences sexuelles ou dans les marches des fiertés LGBTQIA+. Ils n’expriment pas seulement une demande de reconnaissance, mais revendiquent l’égale valeur des vies humaines, y compris celles qui sont définies par la stigmatisation. Parce qu’ils sont souvent exclus d’un monde majoritaire qu’on leur a vendu comme universel, ces hommes et ces femmes réclament le respect inconditionnel dû d’emblée aux individus.
La revendication de la dignité est aussi au cœur des discours des soignants et des débats sur la fin de vie, où elle apparaît comme la garante ultime des conditions matérielles du soin mais aussi du respect du désir et de la liberté que chaque individu veut exercer jusqu’à la mort. La peur de « tomber » un jour dans une situation d’indignité – ou jugée comme telle – est ancienne. Mais une nouvelle angoisse se fait de plus en plus présente dans nos sociétés occidentales, celle d’être obligé de se conduire de façon indigne à l’égard d’autrui, parce que le système ne permet plus de faire autrement. On la retrouve, par exemple, chez les enfants de parents âgés qui craignent de « mal se conduire » en les mettant dans un Ehpad.
Les institutions garantes des droits et de la dignité des personnes – l’hôpital, la justice, l’école, etc. – sont paradoxalement en première ligne dans ces dénonciations…
Ce n’est pas un hasard. Depuis la fin du XXe siècle que l’on détricote consciencieusement le fonctionnement de nos services publics, nos sociétés sont devenues des fabriques systémiques de nouvelles formes de situations indignes. Les soignants, les magistrats, les travailleurs sociaux, les gardiens de prison sont nombreux à dire « ne plus pouvoir faire leur métier dignement ». Alors qu’ils se sont engagés dans ces institutions pour accompagner les individus dans l’épreuve, ils sont conduits, par manque de temps et de moyens, à participer à des situations indignes. Ils témoignent d’une même « souffrance éthique », ce sentiment de participer à un système de dupes où il n’y a d’autres choix que de se sentir mal ou de renoncer à l’empathie.
Plus largement, la montée des inégalités, les crises écologiques et leurs conséquences sur les ressources et les déplacements de populations conduisent à une multiplication et à une banalisation des atteintes à la dignité. Notre époque vit un décalage tragique entre l’affirmation d’une dignité humaine universelle et la réalité des faits qui dément ce discours.
La dignité humaine est irréductible et pourtant étroitement dépendante de conditions matérielles. Comment cette tension s’est-elle construite dans l’histoire de la pensée ?
Historiquement, la dignité n’a pas toujours été égalitaire. Elle a longtemps été asymétrique entre les individus, en fonction de leur état social et politique. Il existait, depuis le monde antique jusqu’à l’Ancien Régime, une « continuité » supposée entre le statut social – ce que l’on appelait la dignitas – et la valeur des êtres.
L’avènement des Lumières, l’idéal révolutionnaire-républicain et la concrétisation des droits sociaux ont marqué un tournant que l’on a longtemps cru irréversible, une sorte d’apothéose politique et philosophique de la dignité qui est devenue inaliénable, du moins en Occident, quel que soit le statut social. Après la Shoah, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » a été inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1948.
Mais cette dignité symbolique ne suffit pas. Elle doit s’incarner dans des conditions matérielles de liberté, d’égalité et de fraternité, transformer réellement la vie et les relations avec les autres. Il y a là un double mouvement entre le symbolique et le matériel qui fait la valeur de l’idéal républicain d’une vie digne. Tout le travail du politique est d’en accompagner la cohérence.
Face aux situations indignes, vous dites que l’indignation ne suffit pas et vous appelez à refonder la politique par le soin. Que voulez-vous dire ?
L’indignation est salutaire, mais elle peut être aussi un piège qui enferme dans la dénonciation émotionnelle et le ressentiment. Je défends une politique du soin qui est l’un des piliers de la clinique de la dignité. C’est ce que nous enseigne l’éthique du « care », cette notion mise en lumière par des philosophes féministes américaines dans les années 1980. Elles ont montré que ce qui fait « tenir » nos sociétés repose majoritairement sur les femmes et sur des catégories socio-économiques, ethniques ou professionnelles que l’on paye et que l’on considère mal. Ce sont elles qui portent le fardeau de la vulnérabilité systémique comme de l’entretien des milieux indispensables à la vie.
Une politique de la dignité consiste à réhabiliter le soin des autres et des choses en renforçant l’attention que l’on y porte collectivement et ce, jusqu’à la question fatidique de la mort. Il s’agit d’humaniser ces tâches difficiles, de valoriser le temps que l’on y passe, la qualité de la présence et de la relation, toutes ces « capacités » aujourd’hui invisibilisées en politique. Il s’agit aussi de mutualiser ce fardeau, car c’est un enjeu politique et culturel qui concerne l’ensemble de la société.
Les discours technocratiques sur l’organisation des soins, même s’ils peuvent être nécessaires, ne suffisent pas. Il faut que les corps entrent dans l’histoire, que chacun, homme ou femme, prenne sa part, engage son corps et ses affects. Il s’agit de mieux répartir les tâches, bien sûr, mais pas seulement. Cet engagement fait aussi partie d’un consentement à la démocratie qui passe par une incarnation des principes.
Cette philosophie du soin a souvent été méprisée en France. Comment l’expliquer ?
Elle est souvent mal comprise, car on la transforme en un discours superficiel de l’assistanat, relevant de bons sentiments déconnectés de la réalité. C’est une erreur ! La philosophie du « care » est au contraire une phénoménologie du politique, une prise en compte de la réalité, qui met en lumière ce que nos sociétés préfèrent habituellement glisser sous le tapis, à savoir la vulnérabilité partagée.
Elle montre qu’il n’y a pas, d’un côté, celles et ceux qui seraient autonomes et, de l’autre, les personnes vulnérables. Tout le monde est vulnérable parce que tout le monde va être malade et mourir. L’autonomie est une construction artificielle, splendide, mais, telle qu’elle est conceptualisée aujourd’hui, elle reste grandement l’enfant du patriarcat et d’une mauvaise compréhension du virilisme. Cela conduit à nier sa propre vulnérabilité, à considérer que l’on s’est « fait » tout seul, alors que l’on doit ce que l’on est pour une large part aux soins des autres. L’éthique du « care » démonte heureusement cette imposture.
A quelles valeurs notre société renonce-t-elle lorsqu’elle accepte l’indignité des conditions du soin ?
Elle renonce à l’idéal de la modernité qui, rappelons-le, est fondée sur l’éthique de la dignité des personnes : celle d’Aristote, soucieuse de la singularité du sujet, celle de Kant, qui ne peut considérer l’autre que comme une personne et une fin, celle de Ricœur, qui prend en compte les identités narratives. En lieu et place de cette singularité, notre société se prépare au grand retour de l’éthique utilitariste du tri et de la statistique, où l’on n’a plus les moyens d’accueillir ceux qui n’entrent pas dans les cases. La prise en considération de la valeur irréductible des vies laisse place aux outils de la priorisation.
C’est l’expérience que l’on a vécue avec la pandémie de Covid-19 : dans certains pays, le nombre insuffisant de masques, de respirateurs et de places en réanimation a eu pour conséquence de remettre en cause l’entrée des plus de 75 ans dans les services de réanimation. C’est aussi ce que racontent les soignants qui ne peuvent plus accueillir la spécificité de la personne. Les services publics en « mode dégradé » font mal aux individus comme aux institutions. Que le mode dégradé existe exceptionnellement, chacun peut l’entendre : qu’il soit banalisé, jusqu’à devenir dégradant, est une faillite morale et politique.
La crise climatique peut-elle être l’occasion de replacer la dignité au cœur des politiques ?
L’anthropocène s’annonce comme une clinique de l’indignité des plus retorses, avec plus que jamais ce fait inégalitaire structurel où la « vie digne » des uns s’édifie aux dépens de la « vie indigne » des autres. Il nous invite à élargir la notion de dignité au-delà de l’humain. Dans ce monde qui devient inhabitable, la dignité humaine se définit aussi par la prise en considération et le respect des autres formes de vie et du vivant en général.
Certains l’ont bien compris et s’attellent à repenser notre modèle de société, de relations, de conditions de travail, de rapport à la Terre ou de préservation des milieux de vie. Ils expérimentent de nouvelles gouvernances, comme celle des communs, réinventent leur vie individuelle et collective, et nous montrent une voie restauratrice de la dignité en action. Ce sont d’ailleurs souvent des personnes qui ont été blessées dans leur dignité ou qui ont eu le sentiment de malmener la dignité des autres.
Celles et ceux qui ont déjà fait l’expérience des effondrements et de la vulnérabilité seront sans doute, demain, les meilleurs professeurs de résilience. Parce que le réchauffement climatique ne va pas s’arrêter du jour au lendemain, que les situations pandémiques vont revenir, que les grands déplacements vont perdurer, ils sont dépositaires d’un savoir fondamental pour la société sur ce qu’est une vie digne dans des temps incertains.
C’est à une exploration méthodique et nécessaire que se livre Cynthia Fleury dans son enquête philosophique La Clinique de la dignité : traquer et éclairer les zones d’ombre de la notion de dignité, cette promesse de la modernité née des Lumières, érigée en principe éthique fondamental alors même que les inégalités – sociales, sanitaires, environnementales… – démentent chaque jour sa réalité.
On ne s’étonnera pas que, partant de ce paradoxe, la philosophe spécialiste du soin, elle-même psychanalyste, propose ce qu’elle appelle une clinique de la dignité, convoquant un collège de pensées autour des pathologies de cette idée. Côté diagnostic d’abord, les auteurs de l’approche décoloniale comme Frantz Fanon ou James Baldwin sont notamment sollicités pour saisir, au-delà d’un « universel présupposé », le rôle de la violence et de la domination dans la construction du sentiment d’indignité.
En s’appuyant sur les éthiques du « care » – qu’elle a contribué à diffuser en France au sein de la chaire de philosophie du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences –, la philosophe rappelle combien la dignité des uns repose trop souvent sur la vie indigne des autres. Alors que les crises de l’anthropocène accentuent encore ces inégalités, les voies thérapeutiques passent par la reconnaissance et le partage équitable du « fardeau » de notre commune vulnérabilité. Quatre textes de Benoît Berthelier, Claire Hédon, Benjamin Lévy et Catherine Tourette-Turgis prolongent opportunément la réflexion dans une collection pensée comme une conversation.
« La Clinique de la dignité », de Cynthia Fleury, Seuil, « Le compte à rebours », 224 p.
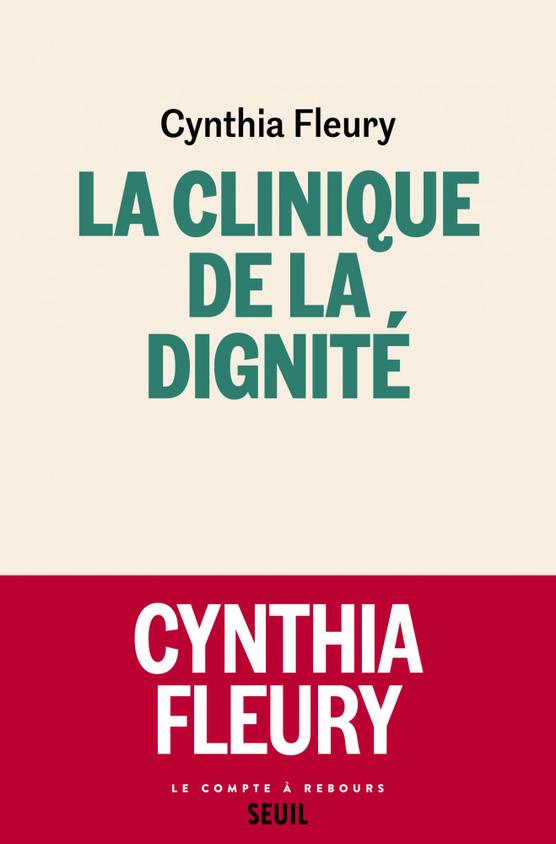

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire