Par Claire Legros Publié le 14 juillet 2023
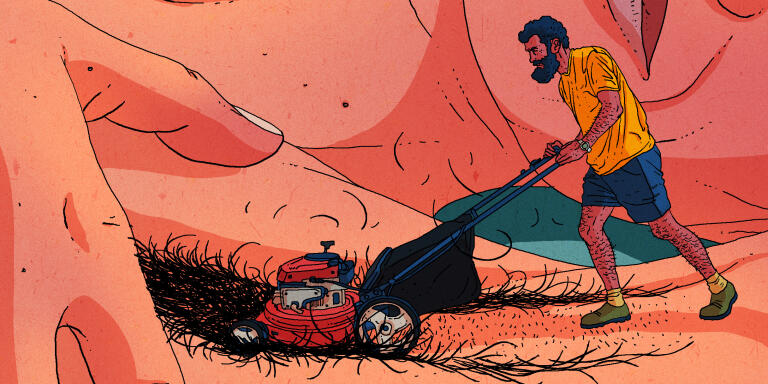
Les pratiques liées à la pilosité racontent l’adhésion à des codes, et les tabous de chaque époque, à la croisée de l’intime et de la sociabilité. Entre désir et dégoût selon les cultures, ces usages délivrent une mine d’informations sur les rapports de pouvoir, en particulier liés au genre, dans une société qui demeure profondément patriarcale.
Ce fut l’un des enseignements inattendus des confinements imposés par la pandémie de Covid-19. Pendant quelques mois, un vent de liberté a soufflé sur les duvets et les toisons. Nombreuses sont celles, notamment parmi les plus jeunes, qui ont délaissé rasoir et épilateur. Selon l’institut de sondage IFOP, plus d’un tiers des femmes de moins de 25 ans déclaraient en 2021 s’épiler « moins souvent qu’avant le premier confinement ». Avec soulagement, si l’on en croit les réactions recueillies par le collectif Liberté, pilosité, sororité créé en 2018 pour dénoncer la « norme du glabre » : « une sacrée liberté ! » ; « un gain de temps et d’argent ! » ; « la fin des douleurs » ; « une réappropriation de mon corps », témoignent celles qui ont franchi le pas.
A peine sorties de leur huis clos, elles racontent aussi sur les réseaux sociaux les quolibets, insultes et même menaces dont elles font souvent les frais. Le compte @payetonpoil, lancé en juillet 2019 par de jeunes féministes dans le sillon de Metoo, est devenu le signe de ralliement de femmes en butte aux dégoûtés de tout poil. Elles y témoignent d’une stigmatisation ordinaire qui touche particulièrement les plus jeunes. Les réflexions commencent souvent dès l’enfance, au sein de la famille et à l’école, en particulier pour les brunes. Alors qu’une poignée de stars comme les chanteuses Madonna ou Beyoncé osent braver l’interdit, la plupart des femmes renoncent à afficher leur pilosité par peur de l’exclusion. « On constate qu’elles ne peuvent toujours pas disposer librement de leur corps », observent les militantes à l’origine de l’initiative.
Le poil féminin dérange, il insupporte, il hérisse. Si le sujet déchaîne les passions, c’est qu’arborer sa pilosité est perçu, chez la femme, comme une transgression qui « heurte les traditions, mais aussi les normes contemporaines », rappelle l’historienne Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine, dans son livre Féminisme. 150 ans d’idées reçues (Le Cavalier bleu, 2020). Affiché comme un acte militant, le geste en dit long sur l’époque. Car le poil n’est pas qu’une affaire de mode ou d’esthétique, il est aussi « un révélateur subtil de l’état d’une société, de l’idée qu’elle se fait d’elle-même et des traumatismes qu’elle a subis », explique l’historienne Marie-France Auzépy, qui a codirigé une magistrale Histoire du poil (Belin, 2011, réédité en 2017).
Construction des apparences
Autour de ce minuscule attribut se déploient en effet, dans toutes les civilisations, de puissantes dimensions symboliques. « Loin d’être insolite ou marginal, le poil occupe une position stratégique au croisement des savoirs anthropologiques de tous types », assure l’anthropologue Anne Friederike Delouis dans Histoire du poil.
Cette place particulière s’explique notamment par le fait que le système pileux se renouvelle et se prête à manipulation, sans risque ou presque pour la vie humaine. S’il est utile à la régulation de la transpiration ou pour protéger du soleil, des infections ou des frottements, il n’est pas indispensable.
En grec ancien, le mot thrix désigne autant le poil que le cheveu, puisqu’ils ont la même origine biologique. La plupart des langues, d’ailleurs, ne les distinguent pas comme le fait le français. Qu’on le raille sur les jambes des filles ou qu’on l’exhibe sur les mentons des garçons, qu’on le rase sur le crâne des moines ou qu’on le voile sur la tête des femmes, il participe à la construction des apparences, « ce labeur exténuant accompli sur les corps pour les faire ressembler aux mots et aux images qui prétendent les façonner », selon les mots de l’historien Alain Corbin.
Au carrefour de l’intime et de la sociabilité, les multiples agencements de cette mise en scène de soi sont autant de messages qui racontent les dégoûts et les désirs, les tabous et les interdits, et délivrent une mine d’informations sur les rapports de domination entre humains. Car le poil est d’abord une affaire d’identité et de pouvoir.
« Par les ajustements dont ils font l’objet, poils et cheveux sont des marqueurs de différences sociales et culturelles par excellence. Ils renseignent aussi bien sur la différenciation de genre que sur le changement de statut au fil des âges, les hiérarchies sociales ou les dissidences culturelles dans une société », relève l’anthropologue Christian Bromberger, qui a raconté ses enquêtes « tricho-ethnographiques » en Iran, à Hokkaido, au Japon, et jusque dans un service de cancérologie, à Marseille, dans Les Sens du poil. Une anthropologie de la pilosité (Creaphis Editions, 2015). Autant dire que, en dépit de son apparence futile, ce phanère se révèle un objet d’étude important, au centre d’une littérature foisonnante.
« Géographie du poil »
Les premières traces de domestication pilaire apparaissent dès la préhistoire. « De tout temps, tailler poils et cheveux est un signe d’appartenance au monde des humains, une façon d’établir une frontière entre nature et culture », explique Christian Bromberger. Il s’agit de séparer le civilisé du sauvage, de « dompter la bête qui est en nous, de l’apprivoiser pour échapper à cette proximité dérangeante où la sexualité est souvent associée à la bestialité », note Denis Bruna, commissaire de la riche exposition, « Des cheveux et des poils », que le Musée des arts décoratifs, à Paris, consacre au sujet jusqu’au 17 septembre.
Cet imaginaire traverse les civilisations, mais avec de multiples variations. Car, contrairement aux idées reçues, la pilosité n’est pas uniformément partagée sur la planète. « On l’oublie souvent, mais il existe une géographie du poil, rappelle Christian Bromberger. A de rares exceptions près, seules les populations européennes et du pourtour méditerranéen, ainsi que celles du Moyen-Orient, développent une pilosité naturellement abondante. » En dehors de cette « ceinture velue » − la formule est du romancier américain Jeffrey Eugenides dans Middlesex (2002) − qui s’étend à peu près du Portugal et du Maroc à l’Afghanistan, une majorité des populations de la planète sont naturellement glabres.
Du fait de cette diversité géographique, il n’existe pas de langage universel de la pilosité ni de signification univoque. « Les dégoûts pileux occupent une place variable selon les sociétés, et sont affaire de normes civilisationnelles », souligne Christian Bromberger, qui distingue les peuples trichophobes et les trichophiles. Ainsi en Asie, le poil se fait plutôt discret, sauf chez certaines ethnies comme les Aïnous, dont le territoire, sur l’île d’Hokkaido, a été conquis au XVIIIe siècle par les Japonais. « Considérés comme la population la plus velue au monde avec les Ghiliaks de Sibérie, les Aïnous vouaient traditionnellement un véritable culte au poil, à tel point que les femmes se teignaient la lèvre supérieure avec de l’encre pour dessiner une sorte de moustache », raconte l’anthropologue. Les Japonais, naturellement imberbes, ont longtemps entretenu avec les Aïnous des relations difficiles. « Jusqu’à un proche passé, ces derniers ne pouvaient être instituteurs ni accéder à un poste à responsabilité, en raison de leur apparence pileuse. »
Frontière anthropologique
Les populations amérindiennes sont, quant à elles, pour la plupart imberbes. Et nourrissent traditionnellement un profond dégoût à l’égard de la pilosité. On imagine sans peine le trouble des Européens lors de la conquête du Nouveau Monde, en découvrant que les prétendus « sauvages » qu’ils étaient venus évangéliser s’épilaient pour certains les sourcils et les cils, et considéraient la barbe de leurs envahisseurs comme un symbole de leur sauvagerie. Le missionnaire Gabriel Sagard, premier historien religieux du Canada, rapporte dans son Grand Voyage du pays des Hurons (1632) qu’« ayans la barbe tellement en horreur (…), aussi croyent-ils qu’elle rend les personnes plus laides, et amoindrit leur esprit ».
On comprend mieux, dans ce contexte pluriel, que la pilosité soit loin d’être un marqueur de différenciation de genre universellement partagé. C’est avant tout en Occident et autour de la Méditerranée que le poil est considéré comme l’une des frontières anthropologiques essentielles entre les sexes. « Très tôt dans l’Antiquité, le lisse féminin s’est opposé au dru masculin, symbole de la virilité et de la domination patriarcale, explique Christian Bromberger. A partir de la différenciation pileuse liée à la différence hormonale s’est forgée l’idée que la femme est naturellement dépourvue de poils, ce qui est bien entendu faux. »
Faut-il s’en étonner, quand l’histoire du poil féminin est presque exclusivement écrite ou représentée par des hommes ? Il n’existe, jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, que de très rares témoignages directs sur l’épilation féminine. Dans la Grèce antique, les sculptures des déesses affichent un corps imberbe, y compris le pubis, et de nombreuses traces témoignent de pratiques dépilatoires féminines. Plusieurs coupes peintes, dont la plus ancienne date du Ve siècle avant notre ère, montrent une servante à genoux en train d’épiler le corps nu de sa maîtresse. Le poète grec Aristophane évoque différentes techniques dont l’usage d’une lampe à huile pour brûler les poils pubiens des femmes.
Au cours des siècles, les religions vont renforcer les injonctions pilaires. La peau glabre est un symbole de pureté dans les cultures hébraïque, chrétienne, islamique et les religions extrême-orientales. Les premières représentations d’Eve la dévoilent imberbe alors même qu’elle est censée évoluer dans sa naturalité originelle, tandis qu’Adam est souvent montré barbu. Au-delà de l’iconographie, les divergences pilaires entre les religions sont nombreuses. Le christianisme prône le respect de la nature, œuvre de Dieu. « On ne doit pas supprimer les poils, mais les passions », écrit au IIIe siècle Clément d’Alexandrie, l’un des Pères de l’Eglise.
Sang de chauve-souris
Pour les sociétés islamiques, au contraire, l’épilation du pubis et des aisselles est la norme pour les deux sexes. « Les poils retenant les sécrétions – sueur, sang, urine ou matières fécales – y sont considérés comme impurs, souligne Christian Bromberger. D’ailleurs, en persan, la pâte dépilatoire est appelée vâjebi, mot dont la racine est la même que celle des vâjebât, prescriptions religieuses obligatoires. »
Au Moyen Age, les croisés rapportent de leurs voyages des techniques d’épilation à la cire et au fil de soie. Jusqu’à la Renaissance, les femmes bien nées sont encouragées à s’épiler en Europe. D’étranges recettes circulent, à base de sang de chauve-souris ou d’arsenic, que l’on s’échange dans des recueils à la mode, comme celui d’Alexis le Piémontais, réédité plusieurs fois au XVIe siècle, qui détaille « le secret merveilleux duquel les grandes dames mores [maures] usent, par lequel elles font que leurs filles n’ont pas de poils sous les bras et autres lieux ».
Qu’il soit épilé ou non, le poil féminin est associé à la sexualité et se doit d’être caché. Jusqu’au XIXe siècle, dans la peinture, le corps des femmes reste aussi glabre que celui des statues de marbre. Seules les illustrations médicales et les images érotiques en font état. « Dans les archives des Beaux-Arts de Paris, les étudiants, avant 1900, dessinent les poils pubiens des femmes sur leurs esquisses, mais les effacent dès qu’ils travaillent sur l’œuvre finale », rapporte Denis Bruna.
Quand elle apparaît dans la littérature ou l’art, la pilosité des femmes est érotisée par le regard masculin. « Lorsque Nana levait les bras, on apercevait, aux feux de la rampe, les poils d’or de ses aisselles. » Et « tout d’un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l’inconnu du désir », décrit Zola dans le premier chapitre de Nana (1879-1880). Quelques années plus tôt, Gustave Courbet, chef de file du mouvement réaliste, avait suscité un certain émoi en réalisant son Origine du monde, tandis qu’Edouard Manet immortalisait la nudité lisse d’une Olympia alanguie, une chatte noire à ses pieds, sans doute le détail le plus commenté du tableau.
Comme les soins du cheveu, ceux du poil incarnent l’adhésion à des codes. S’écarter, qu’on le veuille ou non, des normes en usage se révèle lourd de conséquences. En attestent les traitements infligés jusqu’au XXe siècle aux femmes dites « à barbe », produites comme des bêtes de foire, alors qu’elles étaient souvent atteintes d’hypertrichose, maladie rare qui se manifeste par une pilosité très abondante.
Aseptisation des corps
Le XXe siècle voit l’apogée de cet « élan pilophobe » décrit par l’historien Philippe Perrot (Le Travail des apparences ou les transformations du corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, Seuil, 1984). La mode, en dénudant les corps, suscite de nouvelles injonctions. Avec l’avènement des robes courtes et sans manches, dans les années 1920, puis la généralisation du bas Nylon après la seconde guerre mondiale, l’épilation féminine des aisselles, puis des jambes, s’impose au XXe siècle aux Etats-Unis et en Europe.
A la faveur de l’engouement pour les bains de mer, puis de la banalisation des images pornographiques, elle s’attaque au pubis. L’épilation intégrale représente l’aboutissement d’une aseptisation des corps qu’accompagne le rejet des odeurs et des fluides corporels. « Au fur et à mesure que le nu se dévalue par l’inflation de sa pratique extensive, au fur et à mesure que rétrécissent les zones de la pudeur et du désir, s’accroissent celles de la surveillance sanitaire, du contrôle anatomique, de la vigilance hygiénique, du quadrillage cosmétique », note Philippe Perrot.
Mais cette nudité exposée ne signifie pas la « fin du costume », affirme Jean-Didier Urbain (Sur la plage, Payot, 1994). Ce que représentent les corps épilés sur les plages, ce n’est pas le naturel, mais un « naturel corrigé », une nudité « surréelle : plus figurée que véritable », où « être à poil » consiste justement à s’afficher sans poils, selon le sociologue. L’épilation est un habit invisible, un masque qui ne fait pas apparaître mais disparaître quelque chose. « Une femme épilée, comme une plage sans algues, est aussi un mensonge, une fiction − et cette fiction esthétique est son nouveau costume », écrit-il.
Cet hygiénisme qui semble vouloir échapper aux contingences du corps touche également les jeunes hommes, de plus en plus nombreux à bannir eux aussi toute trace de pilosité. La tendance témoigne sans doute de la fluidité de genre qui traverse l’époque. Elle ne doit cependant pas faire oublier que les injonctions restent beaucoup plus fortes pour les femmes. Ainsi le malaise suscité par la vue de poils reste quatre fois plus important pour des aisselles féminines (57 %) que masculines (15 %), selon un sondage de l’IFOP.
« Aujourd’hui, les hommes restent libres de se raser intégralement ou d’être poilus. Ce n’est pas le cas pour les dames. La pilosité féminine est résolument un sujet politique, pas cosmétique », constatent Juliette Lenrouilly et Léa Taieb, autrices de Parlons poil ! Le corps des femmes sous contrôle (Massot, 2021).
Les clichés perdurent jusque dans les salles de sport, où la transpiration masculine est « vue comme la preuve de la force (en action) », alors que, pour la femme, « la sueur est vécue comme une marque infamante, et celles qui ne s’épilent pas les aisselles sont soupçonnées de manque d’hygiène », décrit l’anthropologue Gilles Raveneau (« Suer : traitements matériels et symboliques de la transpiration », Ethnologie française, 2011).
« Exigences patriarcales »
Il faut attendre les années 1970 et la deuxième vague féministe pour qu’émerge une critique de ces normes esthétiques, notamment de l’injonction du glabre, considérée comme l’expression du contrôle exercé sur le corps des femmes et leur sexualité. Cette première rupture reste toutefois incomplète. Si elle permet alors aux femmes de conquérir la maîtrise de leur corps procréateur, elle ne remet pas « fondamentalement en cause le principe patriarcal de la disponibilité corporelle », affirme la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, autrice d’Un Corps à soi (Seuil, 2021).
Quarante ans plus tard, c’est à la faveur du mouvement Metoo, au tournant des années 2010, que le poil féminin revient dans le débat, alors qu’« enfle le tsunami de la réappropriation par les femmes de leur corps dans ses dimensions les plus intimes », souligne la philosophe dans Le Corps des femmes. La bataille de l’intime (Philosophie Magazine Editeur, 2018). En réactivant le combat contre le contrôle et l’exploitation du corps féminin dans une société qui demeure profondément patriarcale, la nouvelle génération des militantes dénonce les violences sexuelles et sexistes, s’insurge contre les tabous liés aux règles et l’inégalité menstruelle, met en lumière les violences gynécologiques et obstétricales, lutte contre l’invisibilisation du clitoris dans les manuels scolaires, dénonce les injonctions esthétiques portées par l’âgisme, la grossophobie ou la pilophobie.
Camille Froidevaux-Metterie voit dans ce « tournant génital du féminisme » une prise de conscience de la « gigantesque mystification d’un modèle unique de corporéité : blanche, mince, lisse, sans “défauts”, ferme, symétrique ». Dans cette « bataille de l’intime », il s’agit de « reprendre possession des dimensions incarnées de nos vies, jusqu’au plus intime de nous-mêmes, pour les débarrasser des normes et des exigences patriarcales qui les contraignent, et pour en transformer radicalement l’expérience en la plaçant sous le signe de la libération ».
« Une très vieille haine du corps féminin »
Renversant l’idée d’une libération des corps dénudés sur les plages, les militantes d’aujourd’hui dénoncent l’obsession du lisse comme un mythe aliénant, un nouveau support de contrôle social qui maintient les femmes dans un état d’insécurité et de subordination, première étape d’un continuum de violences. « Les féminismes des années 2010 défendent plus que jamais des corps libérés et affirment que les poils, le gras, les rides ou encore les règles sont politiques », souligne l’historienne du féminisme Christine Bard.
L’enjeu est également économique, comme l’analyse l’essayiste Mona Chollet dans son ouvrage Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine (Zones, 2012). L’élimination du poil revient cher, tout au long de la vie d’une femme. Les crèmes dépilatoires et les rasoirs sont devenus la rente lucrative de multinationales dont les publicitaires rivalisent de promesses et surfent sur ce qui est parfois appelé le « marketing de la honte ». En mettant en scène le poil comme un objet de dégoût, ils ravivent une « très vieille haine du corps féminin », note Mona Chollet.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire