Propos recueillis par Nicolas Truong Publié le 9 janvier 2023
Dans « Panique à l’université », son dernier livre, le politiste Francis Dupuis-Déri analyse les ressorts idéologiques de la critique du « wokisme » qui se répand massivement dans les médias, mais aussi chez une partie des intellectuels et des chefs d’Etat. Il explique son travail dans un entretien au « Monde ».
Né à Montréal en 1966, Francis Dupuis-Déri est professeur en science politique et en études féministes à l’université du Québec, à Montréal (UQAM). De double nationalité, canadienne et française, spécialiste de l’antiféminisme et de l’anarchisme, il a notamment publié en 2018 La Crise de la masculinité : autopsie d’un mythe tenace (Remue-Menage). Il est l’auteur de Panique à l’université. Rectitude politique, wokes et autres menaces imaginaires, paru en septembre 2022 aux éditions Lux.
Qu’est-ce qu’une « panique morale », à l’image de celle qui semble gagner une partie de l’opinion à propos du « wokisme », du décolonialisme ou de l’intersectionnalité ?
Selon le sociologue Stanley Cohen [1942-2013], les médias fabriquent une panique morale par une couverture sensationnaliste hors de proportion d’événements anecdotiques associés à une jeunesse contre-culturelle qu’on veut diaboliser. Aujourd’hui, ce sont les jeunes féministes et antiracistes qui ne respecteraient pas les bonnes mœurs universitaires, ou les spécialistes dans ces champs d’études. C’était déjà le cas aux Etats-Unis dans les années 1980, quand Ronald Reagan et les néoconservateurs étaient à la Maison Blanche et qu’on diabolisait les féministes et les antiracistes qui dominaient les campus, disait-on, et allaient détruire la civilisation occidentale.
A l’époque, des passeurs, comme l’historien François Furet et l’essayiste Alain Finkielkraut, ont importé ces polémiques en France. Aujourd’hui, ce discours est porté par des polémistes, des universitaires et des politiques. Ce qui se passe réellement à l’université les intéresse peu, mais ils l’instrumentalisent pour décrédibiliser des mobilisations progressistes comme Black Lives Matter et #metoo, et pour faire bouger les lignes entre partis, groupes médiatiques et jusque dans nos familles. Des étudiantes à l’UQAM n’osent plus dire qu’elles sont inscrites en études féministes lors de repas de famille, et le père de l’une d’elles ne veut plus la voir depuis qu’elle a choisi ce champ d’études.
Mais quand on se compare, on se console, puisque des étudiantes nous disent quitter des universités françaises où il leur est trop pénible et risqué de poursuivre leurs études en cycles supérieurs sur le racisme et le colonialisme, pour s’inscrire dans des universités canadiennes où elles trouvent une plus grande liberté pour de tels sujets. La charge contre les études sur le genre et le racisme menace la liberté académique.
Pourquoi ce que l’on appelle le « wokisme » suscite-t-il un tel vent de panique non seulement à l’université, mais aussi dans les médias et chez une partie des intellectuels comme des politiques ?
On parle aujourd’hui de « wokisme » après avoir parlé d’« islamo-gauchisme », sans justifier ce changement de termes. Ce ne sont pas des concepts analytiques, mais des mots piégés interchangeables, des épouvantails maniés pour discréditer les féministes et les antiracistes et agiter l’opinion publique. En France, on choisit des mots anglais qui semblent plus effrayants que l’équivalent français. « Woke » veut simplement dire « éveillé », comme dans « éveil des consciences ». C’est banal, puisque tous les mouvements sociaux veulent éveiller les consciences à leur cause, y compris à droite, comme le collectif français Les Eveilleurs d’espérance, qui propose des entretiens avec Marion Maréchal et Eric Zemmour. Voilà donc des wokes !
Nouveau « totalitarisme », nouvelle « religion », nouvelle forme de « puritanisme », processus d’« américanisation » : de quoi ces accusations sont-elles le signe ?
Faire référence à l’« américanisation » est un vieux truc en France pour y faire mousser le sentiment de supériorité civilisationnelle, mais ça n’explique souvent rien du tout, pas plus que les références à la « religion » et au « puritanisme », autant de clichés au sujet des Etats-Unis repris pour décrédibiliser les féministes et les antiracistes. La critique du sexisme existe en France depuis au moins le XVIIe siècle et n’a rien de spécifiquement religieux, tout comme la critique du racisme. Qualifier de « puritaines » des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles, un problème endémique, est pathétique.
Tout aussi ridicules sont les références aux pires violences de masse pour disqualifier les féministes et les antiracistes qui n’ont recours qu’à des tactiques non violentes, outre quelques statues vandalisées, et qui ne tuent personne. Je m’étonne que des médias respectés en France acceptent qu’on les associe aux camps de rééducation maoïstes et à la Terreur. On insulte la mémoire de milliers ou de millions de morts, on manipule l’histoire des révolutions française ou chinoise, et on ment au sujet de notre contexte actuel, mais tout en accusant les spécialistes du genre ou du racisme de manquer de rigueur !
Le « wokisme », combien de divisions ? Quelle est l’importance des études de genre et sur le racisme à l’université, en France et aux Etats-Unis ?
Aujourd’hui, il n’y a que quelques centaines de programmes sur le genre ou le racisme aux Etats-Unis, où on compte 4 500 établissements universitaires (plus de dix fois plus qu’en France). C’est bien peu en comparaison des centaines d’établissements entièrement consacrés à la finance et au commerce et des 1 700 programmes de MBA, sans oublier les académies militaires et les 200 universités chrétiennes. En France aussi, il y a bien plus d’écoles militaires et de business schools que de programmes sur le genre. Ces derniers se développent lentement et représentent un élargissement de la liberté académique dans l’enseignement et la recherche dont on doit se réjouir.
N’y a-t-il pas cependant des dérives dans ces mouvements ?
L’université d’origine européenne a connu des conflits et des grèves étudiantes dès sa fondation, au XIIIe siècle. Les objets du conflit changent selon le contexte, mais des jeunes ont toujours contesté, et c’est parfois difficile à gérer en tant que professeur. Mais d’autres problèmes plus graves contraignent l’enseignement et la recherche universitaires : rareté des postes de professeur et manque de personnel de soutien, classes surchargées, tâches administratives, concurrence malsaine pour les subventions de recherche, format de plus en plus standardisé pour la publication dans les revues savantes, prime à la publication en anglais, rivalités mesquines entre collègues, ingérence du privé, harcèlements et agressions sexuelles, etc.
Il est assez courant de reprocher aux néoféministes de défendre les femmes voilées en Occident et de minorer la lutte que les femmes iraniennes mènent pour se dévoiler. Comprenez-vous cette critique ?
Le contexte en Iran et en France n’est évidemment pas du tout le même, mais la France est assurément obsédée par les femmes voilées depuis les années 1980, et même avant. On pourrait alors comprendre que les féministes avancent prudemment sur ce sujet. Or en consultant les médias sociaux de personnalités et de groupes féministes, je constate surtout qu’elles dénoncent la mort de Mahsa Amini et appuient la contestation en Iran. C’est même le cas du groupe Solidarité femmes de Guadeloupe. Je retiens pour ma part de l’héritage des Lumières, de la modernité et du XXe siècle l’importance de dénoncer les régimes théocratiques, comme en Iran, mais aussi de tolérer et de protéger les minorités religieuses face au pouvoir de l’Etat et de la majorité, comme en France et au Canada.
Ces nouvelles sciences sociales qui suscitent tant de réactions sont-elles mieux connues qu’auparavant ?
Si on compare la situation d’aujourd’hui à celle d’il y a vingt ou trente ans, on peut se réjouir de voir tant de ressources sur le Web, d’interventions dans les médias et de livres sur le genre et sur le racisme. Il s’agit d’un élargissement de la liberté d’expression et de la liberté universitaire et c’est une excellente nouvelle pour la société en général, même si cela semble provoquer des cauchemars chez les conservateurs et les réactionnaires.
C’est une véritable obsession. Une focalisation qui fracture parfois les familles, divise les amis, les collègues et les générations. Une polarisation qui s’affiche à la « une » de nombreux hebdomadaires, se commente en boucle dans des émissions de radio et sur une grande partie des plateaux de télévision des chaînes d’info. Le wokisme et tout ce que ce mot charrie avec lui ne cessent d’être la cible d’un large discrédit. C’est le constat que dresse le politiste Francis Dupuis-Déri dans une analyse combative et engagée de cette « panique morale » qui déborde du cadre de l’université, des imprécations de Trump aux discours de Poutine.
« Néoféminisme », « gender studies », « études décoloniales », « intersectionnalité » ou « cancel culture » : les mots changent mais les idées restent. Dans les années 1980, c’est le « politiquement correct » qui était jugé coupable de rompre avec l’universalisme républicain et même la civilisation occidentale. Sans doute L’Ame désarmée (1987), l’essai sur « le déclin de la culture générale » du philosophe conservateur Allan Bloom (1930-1992), dont les thèses furent largement importées en France, a-t-il marqué un tournant. Dans la généalogie critique de cette « panique » qui hypertrophie et caricature les nouvelles approches des sciences sociales, Francis Dupuis-Déri relève une forme d’obscénité à les comparer au « totalitarisme » et pointe l’indécence de ses contempteurs à se prendre pour des « dissidents ». L’auteur considère ainsi que « les féministes et les antiracistes d’aujourd’hui [ont] simplement remplacé les communistes d’hier ». Pourtant, lui-même relève qu’il a connu « des tensions et des conflits en classe, déclenchés par des progressistes ou des réactionnaires ».
Mais il refuse de transformer des cas particuliers en règle générale, et s’attache en permanence à contextualiser. Le politiste rappelle notamment le faible nombre de départements et de programmes d’études de genre et sur le racisme dans les universités françaises et américaines. Et reproche à certains idéologues réactionnaires de se focaliser sur des conférences annulées, mais de taire ou de minorer des violences venues de l’extrême droite. Il s’attarde moins sur les critiques de gauche du « marxisme culturel » qui auraient troqué la lutte des classes pour la théorie critique de la race. Car, estime Francis Dupuis-Déri, l’industrie de la fabrique des idées penche nettement du côté des conservateurs, qui réalisent en pratique ce qu’ils dénoncent en théorie.
« Panique à l’université. Rectitude politique, wokes et autres menaces imaginaires », de Francis Dupuis-Déri (Lux, 328 p.).
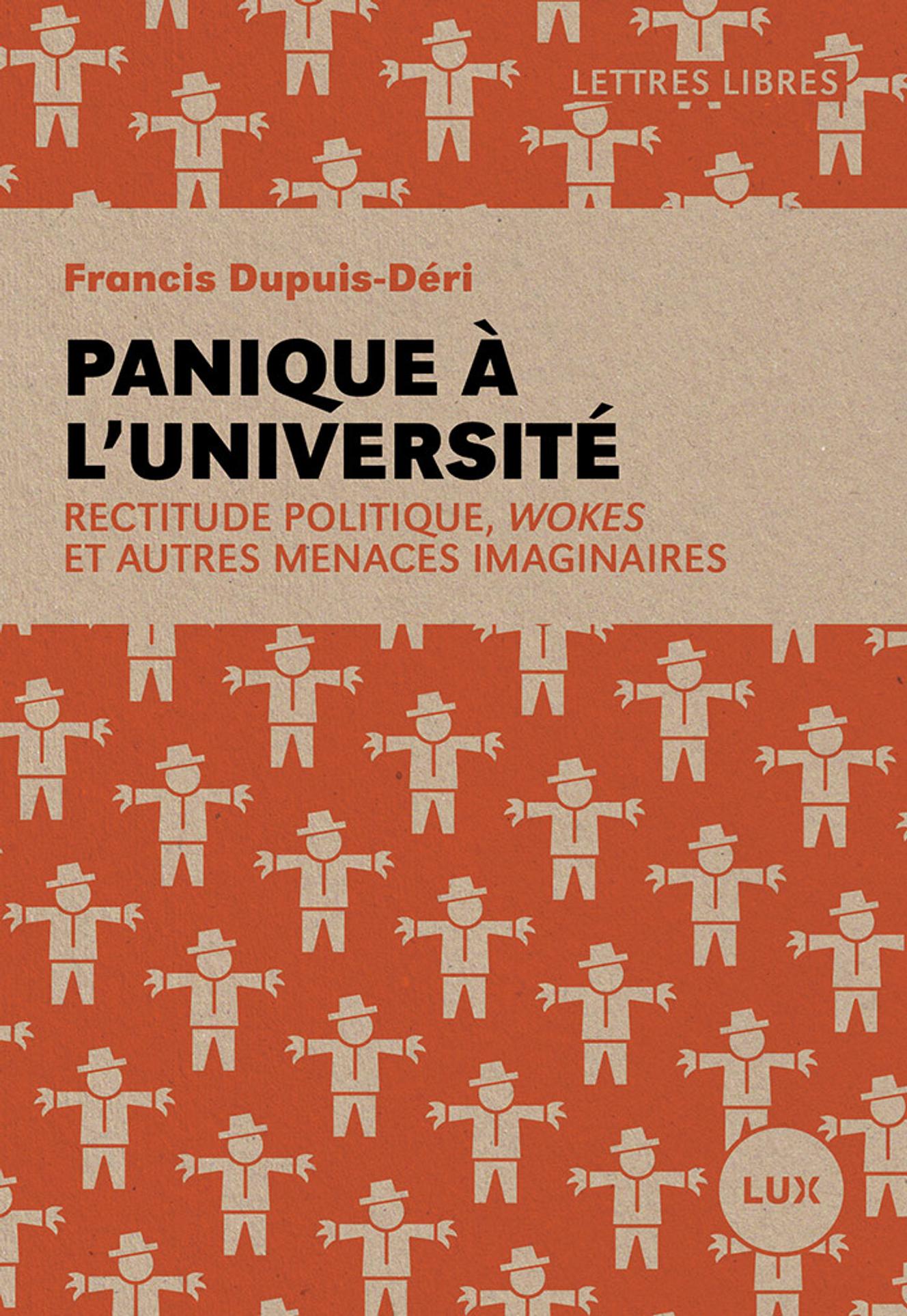

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire