Propos recueillis par Christophe Ayad Publié le 29 décembre 2021
Xavier Crettiez, coauteur d’une étude inédite sur les hommes incarcérés pour terrorisme islamiste, distingue sept profils de djihadistes français, avec certains points communs : un milieu urbain, une famille plutôt stable, la précarité économique, un niveau d’études faible et une radicalisation sur Internet.
Pour la première fois, une étude portant sur l’ensemble des hommes incarcérés pour terrorisme islamiste (TIS) en France permet de dessiner un portrait-robot du djihadisme en France. Cette étude, à laquelle Le Monde a eu accès, a été menée par le politologue Xavier Crettiez, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et coauteur avec Nathalie Duclos de Violences politiques. Théories, formes, dynamiques (Armand Colin, 288 pages, 27 euros), et par le sociologue Romain Sèze, avec l’aide de Jennifer Boirot, substitut du procureur au tribunal de Nancy. Cette étude a été commandée par la mission de lutte contre la radicalisation violente, qui dépend de l’administration pénitentiaire.
Sur quoi porte exactement votre étude ?
C’est un travail d’analyse statistique qualitatif sur ceux qu’on appelle les TIS, les gens qui sont incarcérés pour terrorisme islamiste, qu’ils soient en détention provisoire ou condamnés. Ils étaient, au 1er octobre 2021, 454 – 384 hommes et 70 femmes. Nous avons travaillé sur 353 TIS, tous masculins. Notre base de travail, ce sont les fiches de synthèse produites au sein des quartiers d’évaluation de la radicalisation [QER] par des surveillants, des binômes de soutien, éducateurs et psychologues, des agents du renseignement pénitentiaire et des médiateurs du fait religieux. Pendant deux à trois mois, ils effectuent des entretiens afin d’essayer de retracer le parcours biographique des TIS, leurs antécédents criminels, leur profil psychologique, etc., en lien avec l’affaire qui les a menés en prison. Ne sont pas compris dans cette étude les détenus de droit commun suspectés de radicalisation, qui sont environ 650 actuellement.
D’où viennent les individus que vous avez étudiés ?
Ils appartiennent à une France urbaine pour près de 60 % d’entre eux, 17 % viennent de petites villes (moins de 30 000 habitants) et 2 % de villages. On remarque l’étalement du phénomène sur l’ensemble du territoire. Quelques éléments interrogent. Par exemple, le fait qu’il y ait beaucoup de personnes résidant dans le Centre-Val de Loire, la Normandie ou la Bretagne, qui sont pourtant des zones à faible densité migratoire. A l’inverse, quelques grandes villes sont absentes, comme Bordeaux. Marseille est sous-représentée au regard de la population issue de l’immigration. Au moment de leur arrestation, il y a autant de détenus qui résidaient à Marseille qu’à Orléans.
Comment cela se passe-t-il du point de vue socio-économique ?
Il ressort une précarité économique assez nette. Une majorité d’individus (54 %) est issue de familles précaires. Eux-mêmes sont également dans la précarité : 84 % ont un niveau de revenu inférieur ou égal au smic (dont 22 % avec un niveau de vie très précaire). Seuls 16 % peuvent être décrits comme relevant des classes moyennes ou supérieures.
Cette précarité se double-t-elle d’une instabilité affective ou familiale ?
On compte 40 % de célibataires, 46 % d’hommes mariés ou en couple et 14 % de séparés. C’est une répartition plutôt égalitaire, à l’image du reste de la population à âge égal – la moyenne d’âge est de 28 ans.
En matière d’attaches familiales, les deux tiers sont issus de familles assez ou très stables. Quand il y a des fratries, elles sont plus nombreuses que la moyenne nationale. Seuls 17 % ont grandi dans des familles monoparentales. Par rapport au reste de la population française, il n’y a pas de grande singularité. Cela invalide les explications qui font la part belle à l’instabilité familiale.
Le fait d’avoir des enfants joue-t-il comme un frein ?
En matière de terrorisme en général, c’est plutôt le cas. Si on regarde les groupes qui ont pratiqué le terrorisme, que ce soit d’extrême droite ou d’extrême gauche ou les mouvements séparatistes basques et irlandais, on a souvent affaire à des hommes célibataires et sans enfants. Mais dans le cas du djihadisme il y a plus souvent des gens en couple, avec enfants. C’est un engagement total qui englobe la sphère familiale.
On a souvent parlé de l’absence de père dans les familles djihadistes.
Ce qui ressort de notre étude est plutôt la trop grande présence des mères. Cela rejoint d’autres analyses faites, notamment, par le Parquet national antiterroriste. Un tiers du corpus a un rapport qu’on peut qualifier de fusionnel à la mère. Parfois, il s’agit d’une grande sœur. Cela va de celui qui idéalise complètement sa mère à celui qui révèle des pratiques quasi incestueuses. Il y a deux explications possibles : le djihadisme peut être une façon de se viriliser auprès de sa mère, et donc de la séduire encore plus, ou il est une forme de fuite, loin de sa présence omnisciente.
Qu’en est-il des troubles psychiatriques ?
Il y a beaucoup moins de déséquilibrés qu’on ne le croit. Seuls 8 % du panel souffrent de troubles psychiatriques, c’est deux fois moins que la moyenne nationale (15 %). Toutefois, il y a un biais dans l’étude : les cas les plus graves ne sont pas en QER, on les envoie directement à l’hôpital psychiatrique. Seize autres pour cent présentent des fragilités psychologiques fortes. Là aussi, ce n’est pas notable. En général, les mouvements terroristes, quels qu’ils soient, n’aiment pas recruter des déséquilibrés.
Par contre, ce qui nous a frappés, c’est le nombre important de personnes qui présentent des signes d’addiction, soit à l’alcool, soit aux stupéfiants et, dans une moindre mesure, au sexe. Elles sont 28 %. La moyenne nationale est de 20 %. Il est possible que l’engagement djihadiste soit vécu par certains comme une voie de salut pour sortir d’une vie de péchés. On peut aussi penser que l’addiction prédispose à d’autres addictions, ici à des croyances extrêmes.
Quel est le rapport à la délinquance ?
Il y a un discours politique assez fort sur le lien entre délinquance et djihadisme, mais qui ne se vérifie pas dans nos données, puisque, sur les 353 dossiers étudiés, 245 n’ont pas de trace de passé délinquant. On se trouve le plus souvent en présence de primo-criminels et de primo-incarcérés. C’est une découverte intéressante et plutôt contre-intuitive.
Vos données sont beaucoup plus claires en ce qui concerne le niveau d’éducation.
Les deux tiers des personnes étudiées n’ont pas le baccalauréat. C’est le contraire de la moyenne nationale. Lorsqu’on passe au niveau bac + 2, seuls 23 % des djihadistes sont concernés, moitié moins que la classe d’âge nationale. Nous avons donc une population au capital culturel assez limité, du moins celui qui est certifié par des diplômes. C’est d’autant plus notable que les islamistes ont une forme d’obsession du combat contre ce qu’ils appellent l’ignorance (« jahiliya ») et révèrent le savoir religieux. La volonté de rattraper ce déficit scolaire est peut-être l’une des motivations de l’engagement dans le djihadisme, qui est une idéologie scientiste religieuse. Adhérer au djihadisme serait une sorte de substitut à la culture académique. Cela reste à vérifier, bien sûr.
Le parcours migratoire a-t-il une influence ?
La question migratoire apparaît dans les données, mais elle reste très minoritaire : 81 % de la population étudiée est de nationalité française ou de double nationalité (13,5 %). Parmi les étrangers, Tunisiens et Algériens dominent, suivis par les Russes (essentiellement des Tchétchènes), les Marocains et les Syriens. Nous n’avons pas de données sur l’ancienneté de l’acquisition de la nationalité française dans la famille. Mais il est clair que la grande majorité est issue de familles musulmanes.
La famille demeure un vecteur privilégié de transmission religieuse, mais d’un islam culturel. Il est très rare que l’entrée dans le djihadisme passe par la famille : seulement 8 % des cas. Parmi les 75 % d’individus issus de familles musulmanes, près de la moitié (31 %) se considèrent comme des musulmans « born again », dont la pratique religieuse est aussi absolue que nouvelle.
Vous dressez sept profils de djihadistes. Lesquels vous paraissent les plus dangereux ou inquiétants ?
Le profil prosélyte est tout à la fois le plus dominant et le plus inquiétant. Le prosélyte croit dans sa cause, il y est complètement engagé. Il a la pratique religieuse la plus assidue et de bonnes connaissances religieuses et géopolitiques. Il développe un fort sentiment de stigmatisation et de refus de la France ou de la République. Il est le plus souvent condamné pour des atteintes aux personnes, et pas seulement à des biens. C’est le militant le plus structuré. Il représente 19 % du corpus.
Le deuxième profil, qui me paraît aussi dangereux, mais moins important numériquement (11 %), c’est le « radicalisé délinquant ». Il est issu d’une famille précaire ou instable, a un passé criminel important, développe des addictions.
Il y a un autre profil assez dangereux : l’« indigné » (12 %), qui s’engage à la suite d’un choc moral sur Internet. Il est révolté par les atteintes à l’oumma (communauté des croyants) et se sent une proximité très forte avec les victimes. L’indignation est un sentiment très puissant, au point que ce profil est en tête de ceux qui ont fait des séjours en Irak ou en Syrie, plus encore que le prosélyte.
Ensuite, vous avez le « viriliste » (18 %) et l’« escapiste » (11 %). Ce sont des gens qui s’engagent pour changer de vie ou d’image, se grandir, s’inventer une image de guerrier d’Allah.
Enfin, le profil que l’on a nommé radicalisé « en quête de sens » est fréquent (21 %), mais peut-être le moins dangereux. C’est là qu’on trouve le plus de troubles psychiques, d’individus isolés socialement et affectivement, de précaires. Ce sont aussi les moins éduqués, à l’inverse des prosélytes. Ils s’engagent dans le djihadisme pour donner un sens à leur vie. Ce sont aussi les plus jeunes.
Quelles conclusions tirez-vous en matière de politiques publiques ?
S’il y a une préconisation forte que je ferais, c’est la surveillance des réseaux sociaux et d’Internet. Cela ne concerne pas que le djihadisme, d’ailleurs. On le voit dans le harcèlement scolaire. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable plaie pour le fonctionnement de la démocratie. Il faudrait peut-être aussi que les rôles modèles d’animateurs dans les banlieues aient une connaissance religieuse sérieuse pour contrer les discours djihadistes. Mais je ne vois pas la République s’engager sur ce chemin.



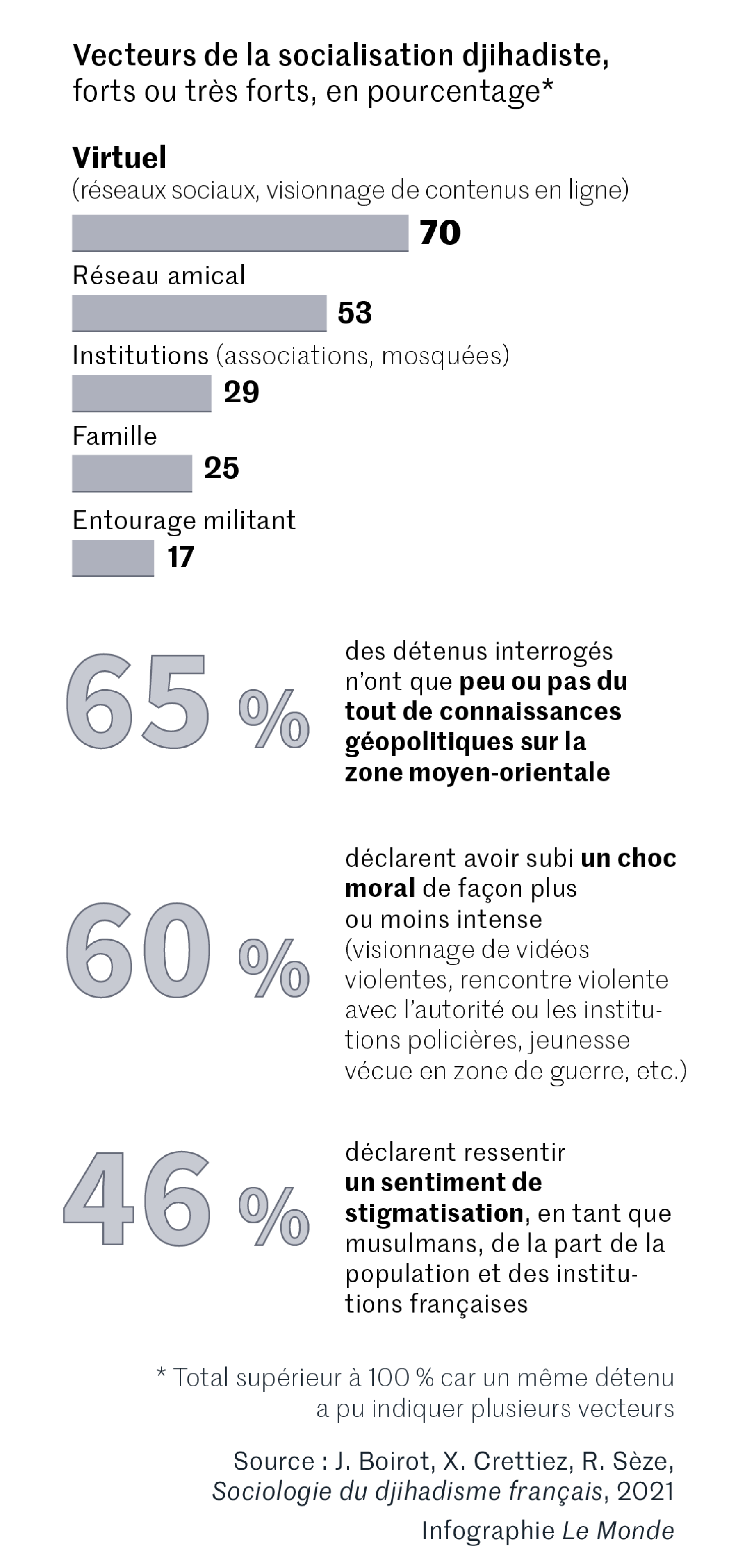
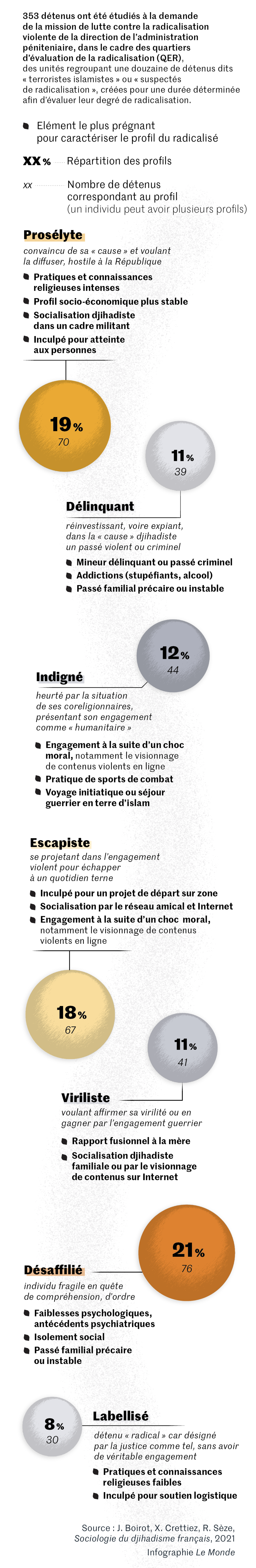
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire