Par Annick Cojean Publié le 9 décembre 2018
L’écrivaine doit recevoir, dimanche, à Stockholm, le prix Nobel alternatif de littérature, une récompense décernée par une nouvelle académie composée d’intellectuels suédois.

Maryse Condé à Paris, le 19 mars 2016. ULF ANDERSEN / AURIMAGES
Née en Guadeloupe en 1937, l’écrivaine Maryse Condé doit recevoir, dimanche 9 décembre, à Stockholm le prix Nobel alternatif de littérature, une récompense décernée par une nouvelle académie composée d’intellectuels suédois.
Une consécration internationale pour l’auteure de Ségou (Tome 1, Laffont, 1984 ; tome 2, Laffont, 1985) qui fut la première présidente du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage et enseigna pendant vingt ans aux Etats-Unis.
Je ne serais pas arrivée là si…
Vous me permettez de tordre un peu la formule ? Et même de l’inverser ? Car moi, je suis arrivée là… bien que ! Et c’est ce « bien que » qu’il m’importe de souligner. C’est ce « bien que » qui m’a paralysée pendant près de trente ans.
Vous êtes donc arrivée là, Maryse Condé, lauréate 2018 du prix Nobel alternatif de littérature, bien que…
Bien qu’on m’ait affirmé, quand j’étais petite fille, que les gens comme moi ne pouvaient pas devenir écrivains. J’avais 12 ans à Pointe-à-Pitre quand une amie de ma mère a voulu me faire un cadeau original. Elle savait que j’avais lu tout ce qui pouvait me tomber sous la main : Balzac, Maupassant, Flaubert… Alors elle a opté pour un roman d’Emily Brontë : Les Hauts de Hurlevent. J’ai d’abord pris l’ouvrage sans enthousiasme, mais dès que j’ai ouvert les premières pages, j’ai été transportée. Ce livre était extraordinaire.
Par quel miracle cette jeune Anglaise, fille de clergyman, qui vivait sur les landes balayées par le vent, pouvait-elle être si proche de moi, petite Antillaise qui vivait au bord d’une mer chaude ? Nous étions sœurs ! J’en étais bouleversée. Dès le lendemain, j’ai couru remercier la dame. Et je lui ai dit : « Un jour, moi aussi j’écrirai des livres. Je serai aussi connue et je ferai des livres aussi beaux que ceux d’Emily Brontë. » Elle m’a dévisagée avec une sorte d’étonnement outré : « Mais tu es folle ! Les gens comme nous n’écrivent pas ! »
« Ecrire était l’affaire des autres. Des Blancs. Des hommes. Des habitants de grands pays. La voie était barrée »
Que signifiait « comme nous » ?
Les femmes. Les Noirs. Les gens originaires d’un petit pays comme la Guadeloupe. Peu importe. Sa réaction m’a anéantie. Je me suis dit que le monde et le métier auxquels je rêvais m’étaient interdits. Que c’était une mauvaise voie. Que c’était même un sacrilège. Et qu’il me faudrait taire toute velléité d’écriture pour être conforme à ce qu’on attendait de moi. C’est pour cela que j’inverse votre phrase. S’il n’y avait pas eu cette réflexion, je n’aurais pas attendu d’avoir 42 ans pour publier mon premier livre. Vous vous rendez compte ?
Votre mère était pourtant instruite et aimait les livres.
Oui, mais elle aurait dit la même chose. Ecrire était l’affaire des autres. Des Blancs. Des hommes. Des habitants de grands pays. La voie était barrée.
Qu’imaginait-elle pour votre avenir ?
Un mariage. Un beau mariage avec un fonctionnaire antillais. Et beaucoup d’enfants. Lorsque j’ai commencé à vivre à Paris avec un acteur guinéen, Mamadou Condé, qui fut mon premier mari, elle a été folle de rage.
Comment décririez-vous votre milieu d’origine ?
Mes parents se présentaient avec un peu d’outrecuidance comme de « Grands Nègres ». C’était en réalité des petits-bourgeois. Ils avaient réussi à s’extraire d’origines très pauvres dont ils ne parlaient jamais et ils étaient éduqués. Ma mère était devenue l’une des premières institutrices noires de sa génération. Mon père, pupille de la nation, avait créé avec des amis une banque locale. Ils étaient imbus de leur réussite et ont élevé leurs huit enfants dans l’ignorance de la société qui nous entourait.
Notre milieu vivait replié sur lui-même. Replié sur les Antilles. Rien de blanc ni d’africain. Les Blancs, c’était les ennemis. Les Africains, on ne connaissait pas. Pas une seule fois je n’ai entendu mes parents évoquer l’Afrique, leurs origines ou l’esclavage. Pas une fois !
Ni même évoquer vos grands-parents ?
A peine. Tous deux étaient bâtards et ma mère parlait avec réticence de sa propre mère, morte environ cinq ans avant ma naissance, qui était cuisinière et se louait chez des Blancs-Pays, illettrée et ne parlant pas le français. Elle l’adorait pourtant, mais elle en avait honte et voulait protéger sa descendance. Alors quand j’ai moi-même commencé à manifester un goût pour la cuisine, moi qui étais considérée comme tellement intelligente et qui raflais tous les premiers prix, ma mère s’est désolée. C’était là un immense défaut.
Voyant sa benjamine si brillante, ne vous poussait-elle pas vers un métier qui assurerait votre indépendance financière ?
Mais je n’étais pas exceptionnelle ! Mes frères et sœurs étaient tous brillants – l’un faisait médecine, un autre fut le premier agrégé de Guadeloupe. Cela autorisait donc à ma mère de beaux rêves. Elle avait d’ailleurs affiché dans sa chambre la photo d’une famille de Noirs américains, avec huit enfants, comme nous, qui incarnaient à ses yeux la réussite : docteurs, avocats, militaires hauts gradés. Elle nous les montrait en modèle, convaincue que c’était en Amérique qu’un Noir pouvait donner toute sa mesure.
Mais la réussite passait avant tout par le mariage. Une fille non mariée, c’était un drame. Il me faudrait un homme bien de sa personne, intelligent et de bonne famille, avec un bon compte en banque. Nous devions tenir la dragée haute au reste du peuple.
« J’ai toujours été contre. Et je crois que c’est lié au silence de mes parents sur nos origines »
Quel était votre rêve à vous ?
Je n’en avais pas. Je me contentais de détester le milieu auquel j’appartenais. Et je me suis vite efforcée de piétiner consciencieusement toutes les règles qu’on m’avait inculquées et tourner le dos aux rêves qu’on m’avait présentés comme prometteurs.
Comment expliquer cet esprit de rébellion ?
J’ai toujours été contre. Et je crois que c’est lié au silence de mes parents sur nos origines. Ils ne m’ont jamais dit que nous avions été colonisés, que des ancêtres avaient été esclaves et que la Guadeloupe, qu’ils me présentaient comme le centre du monde, avait en fait une histoire douloureuse.
J’ai toujours été contre. Et je crois que c’est lié au silence de mes parents sur nos origines. Ils ne m’ont jamais dit que nous avions été colonisés, que des ancêtres avaient été esclaves et que la Guadeloupe, qu’ils me présentaient comme le centre du monde, avait en fait une histoire douloureuse.
Quand je l’ai découvert, très tardivement, grâce au père d’une amie française, Jean Bruhat, historien marxiste qui enseignait à la Sorbonne, je me suis révoltée contre ce milieu de hontes et de mensonges, et contre ma classe en tous points méprisable. J’apprenais avec fulgurance le sens des mots colonisation, colonialisme, identité, dépossession… Le mensonge initial a fait de moi une éternelle rebelle.
Une rebelle qui est allée jusqu’à saboter les études auxquelles elle était destinée en venant à Paris ?
J’avais été admise au lycée Fénelon pour préparer le concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure. Mais la révélation du passé de la Guadeloupe a brisé mon élan. Hypokhâgne, khâgne, le concours, m’ont soudain paru des pièges, et je suis devenue un cancre. J’allais au cinéma, au théâtre, au café, au concert. Surtout ne plus rien faire de ce qu’on attendait de moi.
Y avait-il au moins une perspective ?
C’est venu plus tard. Lorsque j’ai rencontré des gens qui ont orienté ma contestation et m’ont dirigée vers l’Afrique. Une rencontre amoureuse a aussi joué un rôle essentiel. Une rencontre qui fut un échec sur le plan sentimental puisque cet amant haïtien m’a abandonnée, malheureuse et souffrante, alors que je portais l’enfant qu’il m’avait fait ; mais aussi une ouverture formidable sur le monde puisque cet homme m’a éclairée sur Haïti dont je ne connaissais rien, pas même le martyre de Toussaint Louverture, et a élargi ma planète jusqu’alors si restreinte.
L’Occident, l’Afrique, la Caraïbe… Je comprenais enfin comment le monde s’était organisé. Il a parachevé mon initiation entamée avec l’historien et m’a définitivement ancrée dans le camp de la révolte.
En 1959, à 22 ans, vous êtes donc partie vivre en Afrique.
Oui, après m’être mariée à Paris avec un Africain. Au moins n’étais-je plus fille-mère, j’avais un statut et la bague au doigt. Et je m’envolais, pleine d’espoir, vers le continent chanté par Aimé Césaire, mon poète favori.
J’ai vite déchanté. Les Etats africains se cherchaient, tout comme moi. Je connaissais les méfaits de la colonisation, j’ai découvert les tares de l’ère post-coloniale.
Comment les Africains accueillirent-ils la jeune Guadeloupéenne que vous étiez ?
Mal. En tout cas, ils m’ont vite révélé que j’avais avec eux très peu de points communs. On se moquait de moi parce que je ne portais ni pagnes ni boubous, que je refusais d’apprendre les langues, que j’étais différente. Je n’avais jamais imaginé que l’Afrique pouvait être une terre hostile, et pourtant, j’y ai connu douze années de souffrance et de galère. Je découvrais que la négritude de Césaire n’était qu’un beau rêve et que la couleur ne signifie rien.
« On n’imagine pas, aujourd’hui, les efforts que les femmes ont dû faire sur elles-mêmes pour se libérer et regarder les hommes droit dans les yeux »
Vous étiez une jeune femme. Et votre autobiographie évoque de nombreux déboires avec les hommes que vous décrivez égoïstes, infidèles, souvent violents.
Attention de juger avec le regard d’aujourd’hui. Il y a cinquante ans, une femme, même intelligente, restait dépendante des hommes. Pour elle, l’homme était la partie essentielle de sa vie, et elle était prête à tout en accepter. L’homme était son maître. Elle lui était naturellement soumise. C’est Richard, mon deuxième mari, qui m’a montré qu’un homme pouvait être un égal. Mais avant lui, je croyais qu’un homme était un dieu.
Est-ce possible ?
Mais oui. Je l’ai cru très longtemps. Et je ne pensais pas qu’un homme puisse se comporter autrement que machiste, égoïste et dominateur. J’avais pourtant lu Beauvoir et beaucoup d’auteurs féministes. Mais l’égalité me paraissait improbable. J’étais dépendante et me complaisais dans la dépendance. En tout cas je l’acceptais.
On n’imagine pas, aujourd’hui, les efforts que les femmes ont dû faire sur elles-mêmes pour se libérer et regarder les hommes droit dans les yeux. Il m’a fallu un temps fou pour décider d’un sursaut. Je n’étais pas féministe, à 20 ans ! C’est à 40 que j’ai compris qu’il m’appartenait de mettre un terme à la soumission et à la galère ! Si je voulais mon indépendance et un avenir meilleur, il fallait tout recommencer. Et en passer par un retour aux études.
Alors j’ai pris une décision très dure : me séparer de mes quatre enfants qui entravaient ma liberté. J’ai demandé à leur père de les prendre avec lui quelques années, et je suis revenue à Paris, en 1970, pour obtenir des diplômes et passer une thèse de doctorat : le stéréotype du Noir dans la littérature africaine. La rencontre avec celui qui est mon compagnon depuis 49 ans a bien sûr été déterminante.
Il est d’origine anglaise… et blanc.
Eh bien oui. Ce que je n’aurais jamais pu imaginer auparavant. Mes parents m’avaient inculqué une haine des Blancs qui, chez nous, étaient les béqués. Et j’avais été horrifiée de découvrir qu’une amie au Ghana vivait avec un homme blanc. Quelle tare !
Je ne voulais aucune association, aucun lien personnel avec le monde des Blancs. Et puis voilà… Richard m’a donné la foi en moi-même qui me faisait défaut. C’est grâce à lui que j’ai pu devenir écrivain.
Quand avez-vous commencé à écrire ?
En Afrique. Mais c’était en cachette, honteusement. A Paris, le fait de travailler pour le magazine Présence Africaine, parallèlement à mes études, m’a donné plus d’audace. Il a cependant fallu toute l’insistance de Stanislas Adotevi qui dirigeait une collection chez 10/18 pour que j’ose lui confier mon premier manuscrit : Heremakhonon. J’étais encore hantée par cette phrase : « Les gens comme nous n’écrivent pas. » Les livres qui ont suivi ont beau avoir eu du succès, je n’ai cessé toute ma vie d’avoir peur et de douter. Ce prix Nobel alternatif m’enlève heureusement mes derniers doutes.
Le succès planétaire de « Ségou » et de « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » vous a valu des invitations à enseigner aux Etats-Unis. Pourquoi y êtes-vous restée vingt ans ?
J’adorais l’Amérique. Berkeley, la Virginie, Columbia… C’est l’endroit où tout peut arriver, tout peut être inventé, tout peut être remis en question, contrairement à la France qui s’est fossilisée dans des traditions, des modèles et des idées toutes faites.
New York est la seule ville dont je continue de rêver, bruyante, fatigante, mais ô combien stimulante et fabuleuse. On y vit comme on veut, dans l’indifférence générale. Tout le monde s’en fout ! C’est idéal ! On peut donc s’y chercher à loisir et s’y trouver. C’était d’ailleurs mon message à mes étudiants d’origines multiples : Exercez pleinement votre liberté ! Questionnez, inventez, rejetez cadres et modèles ! Il n’y a pas de voie sacrée. Mes livres ne cessent d’interroger le monde sans jamais proposer de solution.
Aviez-vous noué des liens avec les intellectuels noirs américains ?
Non. Ils ne s’intéressaient pas à moi. Ils se vivaient essentiellement comme descendants d’esclaves revendiquant des droits et ne remettant rien en question. Leur histoire ne correspondait pas à la mienne et notre couleur ne nous rapprochait pas. Leur combat était politique, le mien était personnel : je cherchais à savoir qui était Maryse Condé. Frantz Fanon, mon maître, disait : « Je ne veux pas être esclave de l’esclavage. » A chacun son histoire et sa quête personnelle. J’y avais très peu d’amis noirs.
Que pensez-vous du mouvement #metoo ?
Je suis partagée. Je ne voudrais pas qu’après avoir été si longtemps minorées, les femmes deviennent trop exigeantes ou dominantes et qu’elles piétinent les fragilités des hommes.
Une division entre les sexes serait dramatique. Attention à ne pas prendre la place des maîtres et répéter leurs travers. C’est Fanon, encore, qui disait : le colonisé est un envieux. Tout ce dont il rêve, c’est de prendre la femme du colon et la baiser. Je ne voudrais pas que les femmes se réfugient dans une position de dominantes qui les satisfasse, et qu’elles cessent de mettre le monde – et elles-mêmes – en question.
N’est-il pas paradoxal que vous soyez davantage célébrée en Amérique qu’en France ?
N’est-il pas surtout paradoxal que la France ne m’ait jamais donné de grand prix littéraire ? Cela veut sans doute dire que je n’y ai pas ma place, que j’y suis une étrangeté, que ma voix n’y plaît guère. Si j’habite désormais dans le Lubéron, c’est pour des raisons liées à ma maladie, et les soins remarquables dont on bénéficie dans ce pays. Mais je ne m’y sens pas en harmonie. J’y ai zéro reconnaissance. Tant pis.
Votre vie, votre boulimie de voyages, et votre œuvre témoignent-elles d’une quête de bonheur ?
Non, pas de bonheur. Je ne cherche pas à être heureuse, ce serait bien naïf. On connaît des instants de joie, mais il y a aussi tant de moments de doutes et de souffrances. Et tout est bénéfique. Je parlerais plutôt d’équilibre, de paix avec moi-même et les autres. Je crois que j’y arrive doucement. Mais c’est une marche infinie.
Derniers ouvrages : « La Vie sans fards » (JC Lattès, 2013), « Mets et merveilles » (JC Lattès, 2015), « Le Fabuleux et Triste Destin d’Ivan et Ivana » (JC Lattès, 2017).
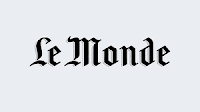
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire