Entretien avec Thierry Baubet, Pr de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris 13, membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise, dite « Commission Sauvé ».
WUD : Peut-être pouvons-nous d’abord rappeler la genèse de cette Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (CIASE) ?
Thierry Baubet : La genèse, c’est l’affaire Preynat / Barbarin [Bernard Preynat est ce prêtre condamné en 2020 pour agression sexuelle d’enfants entre 1972 et 1991 ; Philippe Barbarin est l’ex-archevêque de Lyon, condamné en 2019 pour ne pas avoir dénoncé ces abus sexuels, puis relaxé en 2020, NDLR], provoquée par la naissance d’une prise de parole de victimes, avec la création de l’association « La parole libérée » (je vous conseille l’excellent film de François Ozon, « Grâce à Dieu », pour découvrir son histoire). C’est cette association qui a contraint, d'une certaine manière, l'Église à faire un point sur la situation. La Conférence des évêques de France (Cef) et la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) ont alors donné une lettre de mission à Jean-Marc Sauvé, dans laquelle il lui était demandé de composer une commission pour faire la lumière sur l'ampleur des violences sexuelles commises au sein de l'Église sur des mineurs depuis les années 1950.
WUD : C’est Jean-Marc Sauvé qui vous a demandé d’en faire partie ?
T.B. : J'ai été approché directement par le président, oui. Il avait toute latitude pour composer sa commission. Il a fait appel à moi au titre de mes connaissances sur les questions de traumatisme psychique des victimes.
WUD : Plusieurs médecins faisaient partie de la CIASE, notamment Florence Thibaut, qui a beaucoup travaillé sur les prédateurs sexuels…
T.B. : Tout à fait. Et nous pouvons également citer Sadek Beloucif, qui apportait une compétence sur l’éthique.
WUD : Comment le groupe s'est-il mis au travail ?
T.B. : Nous avons commencé par nous rencontrer lors de journées plénières, ces réunions mensuelles de travail. Étaient invités à ces journées différents experts, et en premier lieu les représentants des associations de victimes, mais également des personnes qui avaient publié des recherches sur ces questions. Le premier temps consistait à nous fabriquer une culture commune, à prendre connaissance des travaux réalisés, en France et à l’étranger. Nous avons ensuite écouté les points de vue des théologiens, des magistrats. Ce fut un premier temps d’échange, avec nos regards décalés. Et puis nous avons pu, après cette première phase, élaborer une méthodologie qui devait nous permettre de répondre aux questions qui nous étaient posées, et qui étaient assez précises.






:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BBYHQGHK4FCLVMSONRNNQYEUMM.JPG)





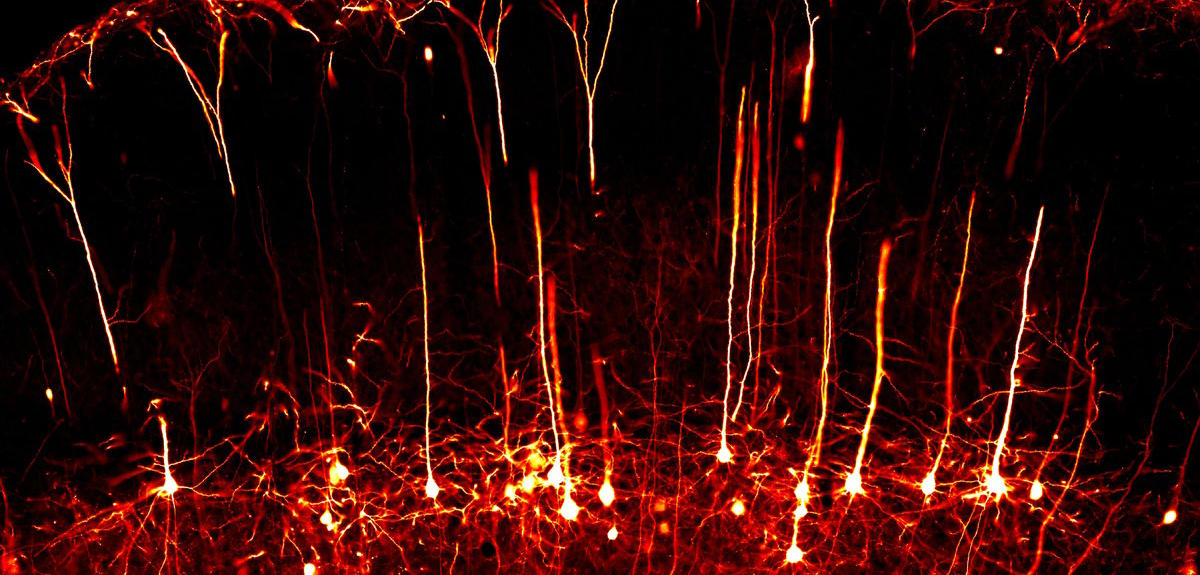
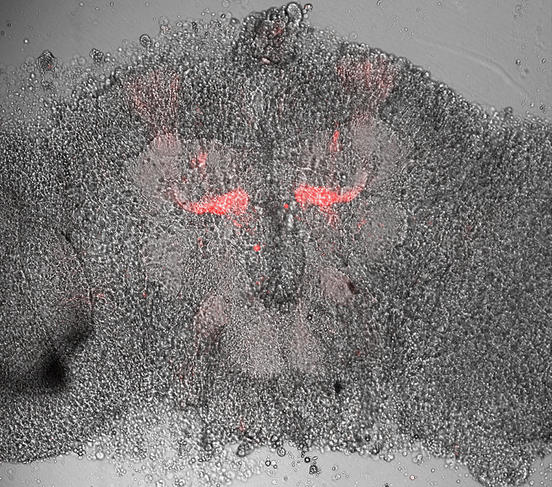











:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/QQY4QRCDTVBMLGVC7AGBKJZ5KY.jpg)


